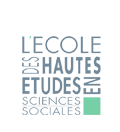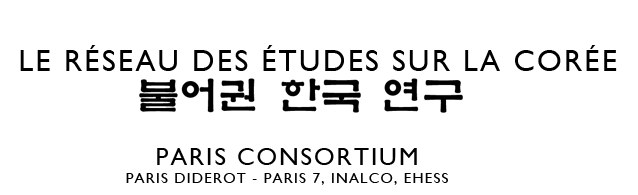Actualités
Actualités
Dans le cadre du nouveau Master Etudes coréennes de l’UFR de Sciences Économiques et de Gestion (UFR SEG) au sein de l’université Félix Houphouët Boigny (UFHB) d’Abidjan, Côte d’Ivoire, a été mis en place un partenariat avec l’université Paris Diderot – Paris 7 (UPD), impliquant la participation de deux enseignants chercheurs de la section d’études coréennes de l’UFR LCAO (Langues et Civilisations d’Asie Orientale) dans la maquette des cours.

Photo 1. Vue panoramique de l’UFR SEG de l’université FHB ; source : © www.ufrseg.ci
Se déployant sur deux années, la formation prévoit 1500 heures de cours combinant, de manière équilibrée et dense, des aspects autant disciplinaires que linguistiques et culturels, et aboutissant à un stage en Corée du Sud. Précurseur en Afrique francophone, l’UFHB ambitionne ainsi de voir aboutir la première promotion de jeunes diplômé(e)s ivoiriennes et ivoiriens en études coréennes dont l’activité répondra à des besoins nouveaux en phase avec la politique de coopération bilatérale impulsée depuis 2014.
La mise en place d’une telle formation a été rendue possible par une volonté politique mobilisant plusieurs partenaires institutionnels sud-coréens (KF, KOICA, KOTRA), mais également grâce au dynamisme des acteurs locaux et en réponse à l’intérêt croissant de la jeunesse ivoirienne pour la péninsule coréenne. Deux porteurs de projets de l’UFR SEG, les professeurs Assi J.C. Kimou et Nestor T. Tito, assistés de leur collègue sud-coréen envoyé par la Fondation de Corée depuis 2015, Hwang Hee-Young, bénéficient, depuis la fin 2016, et ce pour un période de 31 mois, d’une subvention du « Programme des jeunes pousses » en études coréennes (« Seed Programm for Korean Studies ») du KSPS (Korean Studies Promotion Service) de l’Académie des Études Coréennes (AKS).
C’est dans ce contexte que j’ai eu l’occasion de donner un cours de niveau première année d’« Histoire ancienne et médiévale de la Corée » (24h) et d’« Arts et culture de la Corée » (12h), bien conscient de la responsabilité et de l’honneur que peut représenter la participation à ce projet pionnier. Pour des raisons de calendrier, les cours, ainsi que leur évaluation, ont été concentrés sur deux semaines entre le 19 et le 30 juin 2017, constituant des conditions assez éprouvantes pour les étudiants à raison de cinq heures par jour.
Le public de ce nouveau programme de masteurants était constitué de quinze étudiants sélectionnés de façon compétitive (par appel à candidature, test, écrit, entretien, projets..) et provenant de différents UFR (UFR de Sciences économiques, d’Histoire, de Langue et Civilisations étrangères, de Sciences Politiques, de Philosophie) de l’université, certains étant déjà en possession d’un master. Interrogés au départ sur leurs aspirations et projets professionnels, une partie d’entre eux répondait envisager de devenir entrepreneurs, tandis qu’une autre partie aspirait à briguer les fonctions d’enseignant chercheur, ou bien de diplomate ou encore, et plus généralement, de travailler dans les relations entre la Corée et l’Afrique.

Photo 2. La salle de cours dans le bâtiment de Coopération internationale de l’UFHB.
Le site sur lequel se sont déroulés les enseignements était une salle sise au deuxième étage du bâtiment MAI (Master des Affaires Internationales), à proximité du Jardin botanique de Cocody, disposant de matériel de projection ainsi que du Wifi et de l’air conditionné. La logistique était assurée par le professeur Hwang Hee-Young, enseignant sud-coréen de sciences économiques et francophone, qui apportait tous les jours le matériel (et me transportait par la même occasion). La bonne tenue de la salle de cours et la communication entre étudiants et enseignants était assurée par le délégué du cours, Fulgence Kouakou, spécialisé en langue coréenne.

Photo 3. Photo de fin de cours avec les étudiants ainsi que les professeurs Kimou (à gauche) et Hwang (à droite).
La plupart des étudiants, fraîchement initiés à l’étude de la langue coréenne, étaient déjà rompus à la manière coréenne de l’étude, au point d’avoir forgé en nouchi (argot ivoirien mais en passe d’être « créolisé »), le verbe « hwanguer » pour signifier « étudier en faisant tous ses efforts (bosser dur) », construit à partir du patronyme du professeur. Pendant plus de dix jours, les étudiants ont ainsi dû hwanguer pour assimiler en un temps record des contenus tels qu’aspects de l’archéologie des Trois Royaumes, éléments de l’histoire dynastique du Koryŏ, ou pour mémoriser certains « trésors nationaux » kukpo du patrimoine nord ou sud-coréens. En dépit de la densité des cours et de la nouveauté que constituait la plupart des informations et connaissances transmises, les étudiants se sont montrés particulièrement assidus et intéressés, posant fréquemment des questions, permettant ainsi à l’enseignant de jouer pleinement son rôle.

Photo 4. A la fin du cours d’histoire de la Corée prémoderne, le mercredi 28 juin 2017, en présence du professeur Kimou.
L’évaluation comportait deux parties ; la première consistait à rédiger une synthèse d’articles en langue française ou anglaise provenant des ressources en ligne du site web du RESCOR ; la seconde, en un devoir sur table faisant office de contrôle final et comprenant questions de cours, analyse de document et mini-dissertation. Les étudiants ont obtenu de bons résultats et, grâce au dévouement des enseignants de l’UFR SEG, notamment des professeurs Hwang et Kimou, ils auront (ou ont déjà eu au moment où ce billet est publié) l’occasion de mettre rapidement en pratique les connaissances acquises par la réalisation de séjour d’étude, de stage linguistique, ou par l’obtention de bourses d’études gouvernementales, en Corée du Sud.

Photo 5. Quelques étudiants en études coréennes et leur professeur d’histoire de M1, au sortir d’un cours sur le campus de Cocody à l’UFHB.
À ce stade et pour le futur, à partir de 2019, la question de la formation linguistique en coréen à l’UFHB est en effet cruciale car elle détermine en partie l’avenir professionnel de cette première promotion, ainsi que les possibilités de mobilité dans le cadre d’échanges académiques avec la Corée du Sud et la France. Pour ne parler que de Paris Diderot, l’entrée en Master d’études coréennes requiert un niveau linguistique équivalent à celui de fin de Licence. Il sera intéressant de voir pour quels choix opteront les autorités académiques de l’UFHB afin de résoudre l’obstacle linguistique de manière efficace. Peut-on, par exemple, imaginer de voir un jour éclore un enseignement de langue et civilisation coréennes au sein de l’UFR des Langues, Littératures et Civilisations (UFR LLC), à côté de l’allemand, du portugais, de l’anglais, de l’espagnol, et comme première langue d’Asie Orientale ?
Quoi qu’il en soit, les études coréennes s’implantent dans les locaux universitaires avec, outre le bureau des enseignants chercheurs déjà existant (bureau n°23) à l’UFR SEG, dont la permanence est assurée par un assistant, un projet d’installation d’un espace d’études et de documentation dans le même UFR, où le fonds documentaire constitué de plusieurs centaines d’ouvrages, pourra être pleinement utilisé. Notons que le RESCOR, de manière encore symbolique et modeste, a contribué par un don d’ouvrages en langue coréenne et française, à l’enrichissement du catalogue. Rappelons que dans le domaine de la recherche, et hors financement extérieur, l’UFR demeure en pointe grâce au séminaire « Innovation et transformation sociale : étude comparative Afrique subsaharienne – Corée » dont les activités ont commencé depuis en mars 2017. Ainsi se consolide une capacité d’expertise locale sur la Corée du Sud.
Vu de l’extérieur et comme on peut le pressentir, la clé de la pérennisation d’études coréennes à l’UFHB réside d’abord, au niveau local, dans une volonté politique de développer les échanges avec la Corée du Sud – mais celle-ci existe comme l’atteste le soutien durable des doyens de l’UFR SEG qui se sont succédés – , ainsi que dans la coopération internationale dont la collaboration avec l’UPD est une étape susceptible de donner de nombreux fruits. Cette dernière mérite d’être largement soutenue, non seulement par l’engagement et la disponibilité des enseignants chercheurs de LCAO mais aussi, éventuellement, des étudiants de l’UPD (en mobilisant les tuteurs et en proposant, par exemple, un service de correspondants linguistiques), mais aussi par les moyens humains et matériels, même limités, du RESCOR et de l’AFPEC (Association Française pour l’Etude de la Corée). Nul doute que l’engagement, l’inventivité et le dynamisme de l’équipe enseignante de l’UFR SEG, à commencer par les responsables du Master d’études coréennes, les professeurs Kimou et Tito, recevant l’aide précieuse du professeur Hwang Hee-Young, continueront d’être mis à contribution. Pour l’UPD, la prochaine étape est la venue de Mme Kim Jin-Ok pour donner un cours de grammaire du coréen en début 2018.
Puisqu’il s’agit ici d’un retour d’expérience, que l’on permette que mon propos comporte également des éléments subjectifs et individuels. L’expérience abidjanaise a illuminé mon année universitaire 2016-2017. J’ai d’abord été sensible à la qualité de l’accueil des collègues ainsi que du directeur de l’UFR SEG, M. Zié Ballo, que je remercie. Le sérieux et l’engagement des étudiants m’ont également impressionné et j’ai la conviction qu’avec leur motivation et leur capacité de travail, leur avenir professionnel s’annonce sous les meilleurs auspices. Comme première expérience africaine, le séjour a été intense et dépaysant à plus d’un titre, exigeant adaptation pédagogique, en raison des contraintes de temps, et écoute d’un public nouveau pour lequel la formation antérieure et les enjeux professionnels étaient différents de celui que je côtoie ordinairement à l’UPD. Au début, j’ai été quelque peu déstabilisé par le fait que les étudiants portent fréquemment le sac de leur professeur comme signe de respect. Les étudiants parisiens peuvent en prendre de la graine, mais qu’ils se rassurent, je n’attendrai pas d’eux un tel effort une fois de retour à Paris !
Bien que la majeure partie de mon temps ait été dédiée aux cours, ma tropicalisation balbutiante a consisté à découvrir la culture culinaire locale, ce que j’ai fait sans difficulté, appréciant, pendant les pauses de la mi-journée, de recourir à la cantine locale privée des enseignants de l’UFHB pour y déguster poissons, viandes, couscous, pascalis, foutous accompagnés de « sauce graine » ou « sauce feuille » ou gouagouassou, et parfois d’une tonique purée de piments.

Photo 6. Déjeuner au restaurant des enseignants de l’université FHB en compagnie (de gauche à droite) des professeurs Tito, Cho, Hwang et Kimou.
Le professeur Hwang Hee-Young a également grandement contribué à mon initiation en me faisant découvrir de nouvelles saveurs, comme le goût inimitable et exquis du corossol, mais aussi en me partageant de nombreux aspects de sa grande connaissance de la culture et de la société ivoiriennes, ainsi que de l’université d’accueil. Par ailleurs, j’ai pu, grâce à lui, rencontrer de nombreux membres de la petite communauté sud-coréenne locale et accueillante (moins de 200 personnes sur tout le territoire), ou encore visiter certains quartiers d’Abidjan peu fréquentés par les étrangers. Je lui en suis infiniment reconnaissant. C’est également grâce à lui que, peu de temps avant mon départ, j’ai eu la joie de découvrir le Jardin botanique de Cocody, dans l’enceinte de l’université, remarquable par ses trésors de biodiversité.

Photo 7. Le Jardin botanique de l’université FHB à Cocody.
De retour à Paris et en ce début de premier semestre 2017-2018, je remercie le professeur Assi Kimou qui m’honore de son amitié et qui a été la cheville ouvrière de ce projet. Je souhaite également à tous les masteurants en études coréennes de l’université Félix Houphouët Boigny mes vœux les plus sincères de réussite académique et professionnelle. Je leur assure de mon soutien personnel et de celui du RESCOR, et les invite à devenir acteurs du Réseau. Ils représentent, j’en suis persuadé, l’avenir des études coréennes en Côte d’Ivoire et en Afrique francophone. Je formule des vœux pour que les futurs chercheurs acquièrent une visibilité et reconnaissance internationales par leur participation à de grands colloques comme celui de l’Association des Etudes coréennes en Europe (AKSE), dont la prochaine édition est prévue à Rome en 2019.
La collaboration entre l’UFHB et l’UPD en études coréennes, qui ne fait que commencer, représente un beau et promoteur résultat de coopération internationale entre universités francophones en études coréennes. Elle est aussi le fruit du patient travail de construction d’un réseau à l’échelle mondiale entrepris par le RESCOR depuis 2010, jouant ainsi un rôle unique et exemplaire.
 Yannick Bruneton
Yannick BrunetonProfesseur des universités à l’Université Paris Diderot

ISBN : 978-2-7073-4431-1
Chang Kyung-sup, Choi Mikyung, Alain Delissen, Valérie Gelézeau, Benjamin Joinau, Jean-Noël Juttet, Kim Kyung-mi, Lee Ki-Sang, Lim Jie-hyun, Patrick Maurus, Philippe Pons, Bernard Sénécal
Entretien avec la romancière Han Kang
La Corée est trop souvent réduite à quelques stéréotypes, « royaume ermite » ou « pays du Matin calme ». Des voyageurs, séduits ou effrayés, répètent sur le Sud ou le Nord de sempiternels clichés. Le présent numéro de Critique voudrait rompre avec ces clichés. Coordonné par Laurent Jeanpierre et Benjamin Joinau, il associe quelques-uns des meilleurs spécialistes français de la Corée à plusieurs grandes figures de la scène intellectuelle coréenne, pour offrir de ce pays multiplement divisé une vision diffractée et complexe. Écrivains, historiens, philosophes ou chercheurs en sciences sociales, les auteurs ici réunis retracent l’histoire coréenne du dernier demi-siècle pour éclairer les enjeux politiques les plus brûlants : prolifération nucléaire, division territoriale le long de la « zone démilitarisée », nationalisme, multiculturalisme ; mais aussi les questions sociales et culturelles qui en sont indissociables : modernisation, place des femmes ou de la famille, avatars du bouddhisme, permanence ou rémanences d’une sensibilité et d’un ethos proprement coréens. Leurs contributions documentent les subtiles ou souterraines transformations du régime et de la société au Nord, et analysent, au Sud, les revers de la croissance accélérée et le réveil de la conscience critique.
La Corée n’est pas figée, sinon dans le regard morne que nous avons trop longtemps porté sur elle ; et c’est donc ce regard qu’il faut commencer par changer. Pour plus d’informations, voir le site de l’Atelier des Cahiers.

l’AFPEC a le plaisir de vous convier au premier événement 2018 de l’association :
Conférence: « Péninsule coréenne : le calme après la tempête? »
Par Antoine Bondaz, Fondation pour la recherche stratégique.
Date : Vendredi 2 février 2018
Horaires : 15:30 à 17:00
Lieu : Maison de l’Asie (22, avenue du Président Wilson 75116 Paris)
La conférence sera suivie par la cérémonie de remise du prix de thèse de l’AFPEC 2017, et du prix de thèse AFPEC – Choi Seung-Un.
Les réjouissances se clôtureront autour d’un cocktail, auquel vous êtes tous conviés !
En espérant vous y retrouver nombreux !

L’année 2017 a été une année fructueuse pour les études coréennes en France sur plusieurs plans.
D’abord au niveau des publications, l’Institut d’études coréennes du Collège de France, dirigé par Alain Delissen, a lancé la nouvelle collection « KALP’I – études coréennes ». Deux ouvrages sont déjà parus en 2017 dans cette collection : celui de Yim Eunsil, Être Coréens au Kazakhstan : Des entrepreneurs d’identité aux frontières du monde coréen, suivi de celui de Maurice Courant, Une amitié pour la Corée : Cher Monsieur Collin de Plancy. Deux autres ouvrages importants sont également sortis durant le dernier trimestre : Urbanités coréennes. Un spectateur des villes sud-coréennes, publié à l’Atelier des cahiers, dirigé par Valérie Gelézeau et Benjamin Joinau, et La Forteresse de Kaesong. Exposition sur les recherches et les fouilles archéologiques conjointes France, RPD de Corée, sous la direction d’Élisabeth Chabanol (ÉFEO) et Ro Chol Su (NAPCH).
L’année 2017 a vu deux nouveaux maîtres de conférences en études coréennes, recrutés à l’INALCO et à l’UPD, Yim Eunsil, anthropologue de la diaspora coréenne (UPD) et Choi Jiyoung, spécialiste de la linguistique formelle et expérimentale (INALCO). À l’université, deux séminaires spéciaux ont été ouverts en master cette année, animés par deux professeurs coréens accueillis à l’UPD : M. Chang Seok Heung de l’université Kookmin qui a fait cours sur les mouvements d’indépendance coréens, et M. Kim Hyun Cheol de l’université nationale de Séoul, qui anime actuellement un séminaire sur l’architecture. L’année passée, le RESCOR s’est élargi comme le montrent les cours donnés par Yannick Bruneton à l’université Félix Houphouët Boigny à Abidjan, et un partenariat universitaire s’est renforcé, notamment avec l’université Bordeaux Montaigne.
L’association AFPEC a une première femme présidente, Valérie Gelézeau, ce dont nous nous réjouissons. De plus, une nouvelle association LĪBERTĀS a été inaugurée fin 2017 à UPD : elle rassemble des chercheurs travaillant sur les mouvements d’indépendance coréens. Le RESCOR continue à offrir des bourses aux étudiants et neuf rapports peuvent être consultés sur le site. Au niveau culturel, l’UPD a lancé les « Rencontres mensuelles du cinéma documentaire coréen » en partenariat avec le festival documentaire coréen, DMZ Docs.
L’année 2018 sera marquée par l’Atelier 2018 qui nécessite un grand travail d’organisation. Parallèlement, on commencera à mettre en ligne des interviews d’étudiants et d’enseignants, projet sur lequel on travaille depuis un an et demi. Le partenariat avec d’autres universités francophones continuera cette année par l’enseignement donné par Kim Jin-Ok à Abidjan.
Toute l’équipe du Réseau vous souhaite une excellente année 2018 !
Maître de conférences à l’UPD
31
Journée « Atelier de didactique du coréen »
1er juin 2018, Université Paris Diderot
Le coréen attire de plus en plus de jeunes en France. Pour faire face à cette demande grandissante, différents acteurs de l’éducation tentent de mettre en place des dispositifs adéquats. Dans ce contexte, afin de mener des réflexions didactiques du coréen, la section d’études coréennes de l’université Paris Diderot propose une première journée « Atelier de didactique du coréen », en partenariat avec le Réseau des études coréennes (RESCOR). Le but de cette journée est de permettre aux enseignants de coréen travaillant dans l’enseignement supérieur en France de partager leurs expériences pédagogiques ainsi que leurs réflexions didactiques sur le coréen, et de discuter ensemble des problèmes et difficultés rencontrés.
L’atelier s’organisera autour des méthodes d’enseignement utilisées dans divers types de cours visant différentes compétences en langue : grammaire, compréhension écrite, production écrite, utilisation de documents authentiques, compréhension et production orales. Après présentations de leurs expériences, les participants discuteront librement et réfléchiront ensemble à des propositions d’amélioration des enseignements et à diverses méthodes efficaces et innovantes. Les langues de travail seront le coréen et le français.
Tous ceux qui enseignent la langue coréenne dans un établissement d’enseignement supérieur en France peuvent participer à cette journée en envoyant rempli le formulaire ci-joint à l’adresse ci-dessous.
– Journée : 1er juin 2018
Email : atelier.didacoreen@gmail.com
NB : Aucun financement de transport et d’accommodations n’est fourni.
Kim Bokyung, Université Paris Diderot
Je me suis toujours sentie concernée par le sort des plus défavorisés ainsi que par la condition des femmes. Issue d’un milieu non académique, j’ai eu l’expérience étant plus jeune du bouleversement qu’a représentée en Corée du Sud la modernisation à marche forcée de l’économie, à laquelle s’est greffée l’émancipation des femmes. Je n’ai jamais oublié le privilège de pouvoir mener des études supérieures. J’y ai appris le français et la culture francophone. Aussi, lorsque la chance m’a été donnée de mener une thèse à Paris, ai-je saisi celle-ci pour mieux comprendre les forces et les faiblesses de notre société coréenne. La ligne très sensible en Corée à laquelle je me suis consacrée, est de comprendre la précarité des femmes sur le marché de l’emploi, parce que l’économie reste le moteur de l’émancipation. Cette thèse soutenue m’a fait beaucoup mûrir. J’ai tenté de tirer profit de la méthode comparative enseignée à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris. En effet, comme je m’en suis rendue compte à travers le travail académique et le traitement des données, mais aussi dans la vie quotidienne, pour l’organisation de la cité, l’art de la conversation, Corée du Sud et France se ressemblent (population et richesse comparables, situation géopolitique avec quelques points communs, arts et culture sophistiqués) tout en étant fortement dissemblables, dans les comportements au quotidien, dans l’expression des émotions, dans les rapports à l’autorité, dans la conciliation entre vie de famille et travail, dans le sort préparé aux aînés. Pour ne pas commettre l’erreur de prendre la France pour l’arbitre des mœurs occidentales, il me fallait une autre perspective, alors que, ma thèse terminée, j’avais compris l’importance pour le proche avenir de la question du bien vieillir et de la santé des personnes âgées. C’est pourquoi mon projet postdoctoral est providentiel1.
En ce moment, je m’intéresse aux ressorts du « partir à la retraite ». En Corée, cela n’est pas automatique. Les personnes susceptibles de partir doivent souvent faire face à de grosses charges financières (immobilier, entretien de proches) mais aussi, du fait de la grande longévité coréenne combinée à une forte fécondité au moins jusque dans les années 60, aux soins de leurs parents âgés. L’étiolement du confucianisme a aussi accompagné la désagrégation de la famille, de sorte que de nombreuses femmes se retrouvent seules avec des métiers précaires et avec des parents dépendants financièrement, voire dépendants en terme de santé.

Une travailleuse âgée qui travaille dans un restaurant à Seoul. Photo prise par mon ami R. Kwon en 2017.
Sur le chemin qui me conduit chaque jour de mon bureau au centre de recherche en démographie, je ressens vivement ces questions dont la tentative de réponse m’ouvre chaque jour des compréhensions insoupçonnées : la vie, la mort, la famille, la santé, le lien social, notre fragilité d’humains. En tentant, par les moyens que l’éducation m’a offerts (analyse des données, modélisation des comportements, psychologie sociale), je crois participer à la volonté de savoir, et quelque part, je voudrais bien servir les autres. Le vivre-ensemble des gens en société, à la fois si proches et si différents, me questionne. Je crois que les sciences sociales pourraient avoir la mission de nous faire progresser. Pensons aux transformations de la société depuis cent ans ! Qu’une femme puisse s’affranchir de son rôle purement voué à la reproduction a résulté d’une révolution technique, économique, mais aussi liée aux mentalités, chaque facette agissant sur l’autre.
 Younga KIM
Younga KIMPost-doctorant du RESCOR en 2016
- Merci à la bourse postdoctorale du RESCOR, courant de septembre à décembre 2016, de m’avoir permis d’entreprendre cette recherche, merci à la bourse postdoctorale « Move-in Louvain » à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, courant de 2017 à 2019, de m’avoir permis de mener ce projet

L’Association LIBERTAS, spécialisée dans l’étude des mouvements d’indépendance coréens, a le plaisir de vous convier à une conférence concernant l’indépendantiste Sŏ Yŏng-Hae, connu aussi sous le nom de Seu Ring Hai, intitulée :
1930-40년대 임시정부 파리 외교 특파위원 서영해의 독립운동
(Le mouvement d’indépendance de Sŏ Yŏng-Hae, envoyé spécial de la délégation diplomatique du Gouvernement provisoire coréen à Paris dans les années 1930 et 1940)
qui sera donnée par le Professeur Seok-Heung Chang (장석흥) de l’Université Kookmin, actuellement en congé de recherche à l’Université Paris Diderot, ancien directeur du Centre de recherche sur l’Histoire du mouvement d’indépendance coréen du Independance Hall of Korea, et, entre autres, vice-président de l’Association LIBERTAS,
(METRO : ligne 6 (Trocadéro) ; ligne 9 (Iéna) – BUS : lignes 63, 92, 32)
Rappel : Sŏ Yŏng-Hae (Seu Ring Hai, 서영해, 徐嶺海, 1902~1949 ?) a séjourné assez longtemps en France, étudiant dans le secondaire à Beauvais, puis à Paris à l’université et à l’École de journalisme, avant de devenir journaliste et écrivain. Il est l’auteur de nombreux articles de journaux en français et en particulier l’auteur de deux ouvrages littéraires publiés en français :

Seu-Ring-Hai, Autour d’une vie coréenne, Agence Korea, 1929, 189 p. (On trouve dans ce roman qui décrit la vie d’un indépendantiste coréen, Bac Sontcho, une traduction en français de la déclaration d’indépendance du 1er mars 1919)
Seu-Ring-Hai, Miroir, cause de malheur ! et autres contes coréens, Editions E. Figuière, 1934. (Contes coréens édités pour la première fois en 1934 en France et en français. Réédition en 1977 en Corée : So Yong-hae 서영해, Miroir, cause de malheur ! Et autres contes coréens, Saemunsa 새문사, collection d’Est en Ouest dirigée par Frédéric Boulesteix et Jean-Noël Juttet).

Le Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, sans doute le plus important et le plus populaire des festivals français de cinéma asiatique (quelque 90 films présentés et plus de 30,000 spectateurs à chaque édition) promeut, depuis sa création en 1995, toutes les cinématographies d’Asie et contribue notablement, par le biais du cinéma, au dialogue interculturel.
Le festival sélectionne chaque année des films coréens souvent inédits et invite régulièrement des personnalités coréennes du monde du cinéma : cinéastes, acteurs, producteurs….
Lors de cette édition 2018, le cinéma coréen sera une nouvelle fois à l’honneur et représenté au sein du festival, avec quatre excellents films :
Mothers de Lee Dongeun et A Tiger In Winter de Lee Kwang-kuk,
présentés en première internationale (le premier en présence du réalisateur), concourront pour le Cyclo d’or en compétition « Longs métrages de fiction ».
Canards mandarins de Han Kyung-mi, projeté en première mondiale en présence de la réalisatrice, sera présenté dans la section compétition « Documentaires ».
La Caméra de Claire d’Hong Sang-soo, participera à la compétition « Avant-premières » pour le prix des exploitants.
Le catalogue papier du festival sortira le 12 janvier 2018 et sera également en ligne à partir de cette même date.
Renseignements sur le programme, les lieux et horaires du festival « Cinémas d’Asie »
www.cinemas-asie.com
festival.vesoul@wanadoo.fr
FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CINÉMAS D’ASIE – FICA
25, rue du docteur Doillon
70000 Vesoul
Tél. 03 84 76 55 82 ou 06 84 84 87 46

The North Korea Challenges, Regional Order and International Security
With the following contributions:
- International Sanctions on North Korea: Analysis of UN Security Council Resolutions – by Dr. Ko Sangtu ; Professor, Graduate School for Area Studies, Yonsei University
- North Korea’s Nuclear-missile Development Strategy and its Effects on East Asia Regional Order– by Dr. Lee Seunghyun ; Senior Researcher, Foreign Affairs and National Security Team, National Assembly Research Service
- Deterring who, what, and how: Searching for Adaptability of the Israeli Experience with Deterrence to South Korea– by Dr. Kim Juri ; Research Professor, CARIFS, Yonsei University
- The latest Developments of Japan’s Defence Policy in Reaction to the Situation in North Korea– by Dr. Guibourg Delamotte ; Lecturer, Inalco / Associate Fellow, Asia Centre
- Crisis Management on the Korean Peninsula, a European Perspective– byDr. Mathieu Duchâtel ; Senior Policy Fellow and Deputy Director of the Asia and China Programme, European Council of Foreign Relations (ECFR)
A conference proposed by Pr. Minjeoung Kim, Ph.D (Dept. of International Relations, University of Seoul) and Florence Biot (Advisory board, Asia Centre)
Conference will be in English, chaired by Jean-Yves Colin.
The Débats Asie were created in 2006 with the purpose of sharing the experience and expertise of business leaders, academics, media, institutional and key civil society representatives from Europe or Asia.
Compulsory registration: contact@centreasia.eu
Pages