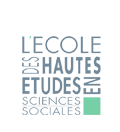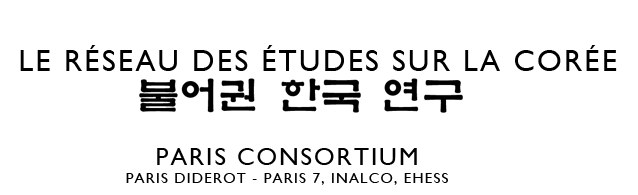Actualités
Actualités

Quatre émissions sur la Corée ont été diffusées sur France Culture du 12 au 15 février 2018, auxquelles ont participé certains membres du Réseau.
1. « Au-delà des JO : la péninsule coréenne (1/4) : Séoul – Pyongyang : l’impossible réconciliation ».
-
Dorian Malovic, chef du service « Asie » au quotidien La Croix, spécialiste de la Chine et ancien correspondant à Hong Kong pour le journal.
-
Valérie Gelézeau, maître de conférence en géographie à l’EHESS, spécialiste de la Corée.
-
Steven Denney, politologue à l’Université de Toronto, spécialiste des réfugiés nord-coréens en Corée du sud.
2. Au-delà des JO : la péninsule coréenne(2/4): Du Nord au Sud : développer pour mieux régner.
-
Juliette Morillot, spécialiste des deux Corées, rédactrice en chef adjointe d’Asialyst.
-
Jean-Raphaël Chaponnière, chercheur associé à Asia Center et Asies 21.
-
Farid Ben Malek, triple-champion de France de jeu de go et chargé d’enseignement à l’université Paris Dauphine.
-
Stanislas Roussin, directeur de SERIC-Seoul, Senior Researcher au Seoul-ASEM Institute.
-
Arnaud Vojinovic, consultant en management interculturel spécialisé sur la Corée, rédacteur pour le site Les influences.
-
Florence Galmiche, anthropologue, maître de conférence à l’université Paris 7 – Diderot.
-
Benjamin Joinau, anthropologue, enseignant chercheur à l’université de Hongik à Séoul rattaché à l’EHESS, animateur et chroniqueur gastronome.
4. Au-delà des JO : la péninsule coréenne(4/4) : Deux Corées, combien de cultures ?
-
Patrick Maurus, chercheur à l’INALCO.
-
Antoine Coppola, professeur de cinéma à l’université Sungkyunkwan de Séoul et réalisateur.
-
Elisabeth Chabanol, archéologue, responsable du centre de l’école française d’Extrême-Orient de Séoul, directrice du chantier de fouilles de Kaesong en Corée du Nord.

|
Steps
|
Schedule
|
Remarks
|
|
1. Application Period
|
2018. 2. 19.(MON)~
2018. 3. 20.(TUE) 17:00
|
Send your application documents by post mail or by visiting GSKS in person
|
|
2. Document Screening
|
2018. 3. 26.(MON)
|
|
|
3. Announcement of applicants chosen for an interview
|
2018. 3. 28.(WED) 18:00
|
Announcement will be posted
on the GSKS website (http://intl.aks.ac.kr/english – Notice)
|
|
4. Interview
|
2018. 3. 30.(FRI)
|
Applicants who stay in abroad will take the Skype interview
|
|
5. Final Selection Result Announcement
(NIIED)
|
2018. 6. 19.(TUE)
|
Announcement will be posted
on the NIIED website (http://www.studyinkorea.go.kr)
|
3) Application forms (prescribed)
Avatars modernes des Paradis artificiels chers à Baudelaire, les techno-réalités sont perçues comme une menace aux relations humaines dans la « vraie vie », notamment lorsqu’elles touchent au domaine de l’affect. Ces produits à semblance humaine se multiplient pourtant : épouse domotique, boyfriend pour écran tactile, compagne holographique, fiancée pour lunettes de réalité virtuelle, partenaire interactif à télécharger, personnages d’otome games et bishōjo games… en attendant le développement des ami.e.s en Hololens. L’essor de ces dispositifs, dont le marché est appelé à dépasser des centaines de milliards d’euros en 2021, génère des réactions de rejet. Les individus qui s’adonnent à la consommation de simulacres numériques affectifs doivent donc faire face aux attaques : il est mal-vu de s’attacher à une créature qui n’existe pas. Le fait d’interagir émotionnellement avec un partenaire numérique fait l’objet d’une réprobation, par opposition au fait de fonder une famille (une unité de reproduction). Comment expliquer qu’en dépit du stigmate qui les frappe un nombre croissant d’hommes et de femmes, à travers le monde, utilisent des dispositifs de simulation amoureuse ?
De façon révélatrice, ces dispositifs sont principalement commercialisés au Japon et en Corée, deux pays en voie de dépeuplement qui s’offrent à voir comme des véritables « laboratoires du XXIe siècle » (Dumont 2017) : les laboratoires du vieillissement de la population au Nord comme au Sud. Alors que ses espaces urbains rétrécissent et que ses espaces ruraux se désertifient, le Japon est en effet devenu le premier producteur mondial de créatures de synthèse et d’humanoïdes destinés à combler le vide, suivi de près par la Corée qui enregistre aussi des taux record de dénatalité. Ces simulacres, dans leur grande majorité, visent d’ailleurs le marché très porteur des célibataires, tenus pour principaux responsables de la chute démographique. Pour quelles raisons une part croissante de la population s’inscrit-elle à contrecourant de la norme ?
C’est sur ce point, précisément, que les rares travaux jusqu’ici publiés échouent à rendre compte du phénomène : s’appuyant sur des modèles d’analyse socio-cognitifs, ces études (Dela Pena 2006 ; Taylor 2007 ; Pettman 2009 ; Pellitteri 2010 ; Tanikawa 2013) établissent que les simulacres permettent à leurs utilisateurs de s’évader du monde réel et de se réapproprier une image positive de soi. Pour intéressantes qu’elles soient, ces explications – qui assimilent l’usage des simulacres à des comportements escapistes ou compensatoires – restent cependant insuffisantes. Ainsi que le soulignent plusieurs chercheurs japonais (Azuma et al. 2003 ; Honda 2005 ; Saitō 2007), l’usage des simulacres affectifs peut tout aussi bien correspondre à un comportement ironique, dans la mesure où ces produits sont volontiers conçus au second degré, dans un esprit de conformisme parodique.
S’appuyant sur ce constat – que les simulacres se font volontiers les complices de stratégies obliques ou de détournements – nous poserons le postulat que la préférence affichée pour des personnages fictifs relève d’une attitude provocatrice au regard des standards culturels ambiants. Serait-il possible, pour aller plus loin, d’analyser ce phénomène comme une forme de dissidence : la dissidence matrimoniale ? Et si les simulacres étaient le signe d’une adhésion à un autre style de vie, un autre modèle de société ou d’autres formes d’engagements relationnels ? Cet axe de recherche mettrait en lumière le simulacre comme miroir inversé des injonctions sociales, révélateur d’une fracture individuelle et plurielle dont il faudra également questionner, dans un esprit comparatiste, les manifestations culturelles : comment s’articulent, en France par exemple, les pratiques d’un simulacre affectif conçu au Japon ? De quels clivages spécifiques son usage témoigne-t-il ?
En étudiant la conception et l’usage des simulacres numériques affectifs, ce colloque se propose d’en faire le baromètre des normes et des idéaux des sociétés qu’ils contribuent à contester autant qu’à remodeler. L’ambition de ce colloque sera d’identifier les processus en jeu dans la création et l’utilisation des simulacres, afin de comprendre comment les groupes humains réélaborent – dans différents contextes et à différentes échelles – des modèles citoyens, des rapports familiaux, des formes de parentés et des standards masculins/féminins. Dans le cadre de sociétés qui voient leur pyramide des âges s’inverser à grande vitesse, le questionnement portera plus spécifiquement sur le rapport à la mort et au patrimoine. Quelles traces laisser de soi lorsqu’on « fait couple » avec une créature numérique ? Suivant quels processus les simulacres affectifs permettent-ils de se confronter à la perspective de mourir seul.e et/ou sans descendance ?
Pour les sciences humaines et sociales, ce phénomène constitue un objet de recherche privilégié, offrant la possibilité de penser ensemble des notions clés telles que la gestion du stigmate, le rapport à l’invisible, les constructions identitaires et la marchandisation de l’affect.
1. La fabrique du simulacre (Conception du simulacre).
Comment et par qui sont conçus les personnages de jeu de simulation ou de Réalité Virtuelle ? Sur quels modèles sont déclinées les interactions (dialogues, activités, partages) proposées aux utilisateurs-ices ? Quels sont les rôles assignés aux hommes et aux femmes dans ces dispositifs ? Quelles performances de genre leur fait-on jouer ? Suivant quelles logiques les relations s’y développent-elles ?
Qui sont les consommateurs et consommatrices et suivant quel parcours en viennent-ils et elles à utiliser ces dispositifs ? Quels paramétrages et scénarios sont mis au point pour rendre le simulacre plus « efficace » ? Quelles négociations économico-sexuelles sont engagées avec le personnage fictif ? La remise de soi réciproque est-elle possible avec un simulacre ?
Quels rôles les simulacres jouent-ils dans le processus de réhabilitation identitaire et de légitimation des utilisateurs-ices ? Dans quels contextes l’usage des simulacres affectifs est-il respectable ou au contraire moteur d’exclusion ? Quelles stratégies sont mobilisées par les utilisateurs-ices pour refouler le stigmate qui les frappe ? Quelle identité construisentils collectivement pour surmonter le discrédit ? À quel régime de représentations et de pratiques collectives font-ils appel pour reconquérir une estime sociale ?
En quoi les usages et les représentations des simulacres affectifs sont-ils comparables à des rituels religieux ? Quelles activités de dévotion sont encouragées, voire orchestrées par les fabricants ? S’agit-il pour les consommateurs de légitimer ainsi leur célibat ? La « pratique » du simulacre s’offre-t-elle à voir comme une forme de résistance au matérialisme ?
De quels conflits culturels ou quelles stratégies d’ingérence les ersatz affectifs sont-ils les vecteurs ? Dans quelle mesure les simulacres permettent-ils de défendre le territoire national (politique anti-migratoire) et de conquérir des territoires étrangers (soft power) ? Comment les utilisateurs s’ajustent-ils aux objets qui manifestent leur origine étrangère ?
Agnès Giard et Philippe Combessie (Laboratoire Sophiapol)
Dates : 14-15 juin 2018
Lieu : Université de Paris Nanterre, Bâtiment Max Weber, salle Séminaire 2.
Comité scientifique
Modalités de participation
Cet appel est ouvert aux chercheurs en anthropologie, sociologie, linguistique, game studies, gender studies, cultural studies, etc.
Les propositions (sur une ou deux pages, avec les affiliations des auteurs) sont à envoyer à Agnès Giard : aniesu.giard@gmail.com avant le 15 avril 2018.
Une réponse sera donnée par mail le 30 avril 2018.
Site internet : https://sophiapol.hypotheses.org

Le Réseau des Études sur la Corée a le plaisir de publier l’interview avec Damien Peladan, doctorant en études coréennes et japonaises à université Paris Diderot, prise le 17 juin 2016.
© Le Réseau des Études sur la Corée & l’université Paris Diderot

Mis en service depuis 2012, le carnet de recherche du Réseau des Études sur la Corée (RESCOR) constitue un espace d’expression, de diffusion et de mise en valeur d’informations scientifiques liées aux activités du RESCOR, réseau francophone des ressources numériques des études coréennes. Depuis 2012, ont été publiées bon nombre d’annonces d’événements académiques au niveau local, national ou international, mais aussi de présentations de travaux et de programmes de recherches, de présentations d’universités francophones où les études coréennes sont représentées et actives, de comptes rendus d’activités diverses dans le domaine des études sur la Corée en sciences humaines et sociales.
Avec la mise en ligne d’entrevues vidéos avec des coréanologues de différentes générations relatant leurs activités (doctorants, chercheurs confirmés, chercheurs d’expérience à la retraite), leurs projets et leurs itinéraires particuliers – parfois représentatifs mais souvent singuliers – le blog connaît une nouvelle étape de son développement. L’élaboration de ces nouveaux matériaux, réalisés entièrement par l’équipe du RESCOR, constitue, à notre connaissance, une démarche rare sinon inédite en études coréennes. À l’instar de la mise en valeur des fonds donnés par des coréanologues confiés au RESCOR, le Réseau prend des initiatives dans lesquelles une institution particulière hésiterait à se lancer. En cela, le RESCOR joue pleinement son rôle, un rôle original contribuant à créer du lien au sein de réseaux et à construire une mémoire ouverte dans le domaine des études sur la Corée sinon une identité et un patrimoine, susceptible de devenir objet d’étude pour les futures générations.
Puisse les utilisateurs du blog tolérer avec bienveillance les quelques imperfections techniques pouvant encore subsister dans ces vidéos en les mettant sur le compte d’une expérience à consolider. Les premiers bénéficiaires (sinon les « victimes ») de ces tentatives ont été Damien Peladan (doctorant en histoire de la Corée à Paris Diderot), Marc Orange (ancien directeur de l’Institut d’études coréennes du Collège de France et chercheur au CNRS à la retraite), Alexandre Guillemoz (directeur d’études de l’EHESS à la retraite), Li Jin-Mieung (professeur de l’université de Lyon III à la retraite), Sem Vermeersch (enseignant chercheur au Centre d’Études du Kyujanggak à l’université nationale de Séoul). La palette des profils concernés par ces entrevues a vocation à s’élargir à l’avenir. Nous formulons donc des vœux pour que le RESCOR puisse continuer à fonctionner dans la durée sous de formes renouvelées.

Entrevue avec Alexandre Guillemoz © Le Réseau des Études sur la Corée & l’université Paris-Diderot
Terminons en remerciant toutes les personnes intervenues au cours des différentes étapes du projet, de la conception à la finition (par ordre alphabétique) : Elena et Yannick Bruneton (UPD), Choi Jiyoung (INALCO), Choi Misook (UPD), Florence Galmiche (UPD), Kim Sohee (UPD), Mylène Laclé (UPD), Jean-Claude Navarro, Julia Poder (INALCO), Isabelle Sancho (EHESS).
Bon visionnage !
L’équipe du Réseau des Études sur la Corée
Cet article se trouve aussi dans les Ressources numériques de notre site.
Le RESCOR vous souhaite une belle année 2018 !

꿈과 희망이 가득한 무술년을 보내시길 바랍니다.
Au cours de sa très médiatisée tournée asiatique de Novembre, Donald Trump s’est vu accueilli en grande pompe par la Chine de Xi Jinping, selon un protocole que Yang Jiechi, le Kissinger chinois, a qualifié de « State visit + ». Comme les enfants et les diplomates le savent très bien, les cadeaux, et surtout les plus spectaculaires, ne sont jamais gratuits. Cette visite d’État devait en effet être l’occasion pour Donald Trump d’évoquer avec son homologue chinois divers sujets assez épineux, dont notamment la question du nucléaire nord-coréen qui divise beaucoup Pékin et Washington. Si la stratégie coréenne des États-Unis est encore très difficile à évaluer, faute de cohérence manifeste, la présente administration américaine semble convaincue de la pertinence des sanctions économiques pour dénucléariser la République Populaire et Démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord). Les États-Unis n’ayant pas ou peu de relations commerciales avec Pyongyang (sous embargo américain depuis 1950), c’est essentiellement en direction de la Chine, premier partenaire économique et commercial nord-coréen, que s’active la diplomatie américaine pour que cessent ces échanges commerciaux qui, selon Washington, alimentent la course nucléaire de Kim Jong-un. Lire la suite sur le site du GIS Asie / Réseau Asie & Pacifique.

« Médias coréens »
organisée à l’occasion du premier jour du nouvel an coréen !

Pages