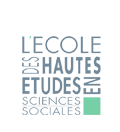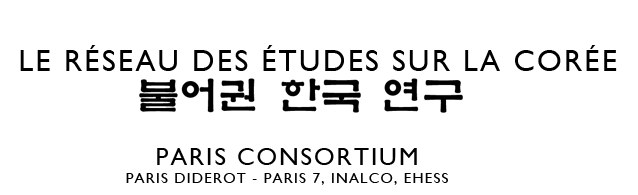Actualités
Actualités

La section d’études coréennes de l’université Bordeaux Montaigne (UBM) a accueilli Mme Okyang Chae-Duporge, qui enseigne actuellement l’histoire de l’art coréen à l’Inalco et à l’université Paris Diderot, pour une conférence sur Les arts de la Corée à travers l’histoire – évolutions et particularités le 27 novembre 2017.
La conférence a été introduite par Stéphane Couralet, responsable de la section d’études coréennes à l’UBM. Comme le titre l’indique, toutes les périodes de l’art coréen ont été parcourues et la conférencière s’est focalisée sur les arts les plus représentatifs de chaque période. Elle a insisté sur l’importance de reconnaître certaines influences des arts étrangers sur l’art coréen pour pouvoir ensuite éclaircir l’évolution propre à la Corée. Tout au long de sa présentation, la conférencière nous a invités à élargir notre regard sur l’art coréen en adoptant une approche comparative avec l’analyse parallèle de l’art chinois, japonais et indien pour une même typologie des œuvres d’art. Cette approche nous a permis de mieux saisir les influences mais aussi les spécificités de l’art coréen.

En déroulant un fil rouge chronologique, Mme Chae-Duporge a proposé de partir de l’étude des sites coréens actuels officiellement inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, en englobant bien sûr, les deux sites répertoriés en Corée du Nord. La conférencière a débuté son exposé par l’examen minutieux des sites datant de l’âge de bronze, en attirant notre attention sur la riche culture dolménique coréenne. Puis, après une présentation des gravures rupestres de Bangudae à l’époque du néolithique, elle nous a aidés à comprendre comment les objets rituels de cette période lointaine, une fois mis au jour lors des fouilles successives, nous permettent aujourd’hui de saisir la force créatrice des peuplades de l’époque et leur aptitude à s’exprimer en réalisant des objets artistiques qui font désormais partie des oeuvres incontournables de l’art coréen. La conférencière en a profité pour évoquer avec nous une question nouvelle et fondamentale : celle de l’origine de l’art coréen.
Mme Chae-Duporge a ensuite présenté l’art funéraire des Trois Royaumes : l’évolution de la peinture murale de Goguryeo ; les découvertes fortuites et surprenantes de la tombe de Muryeung ainsi que celles du grand encensoir de Baekje dont nous avons pu apprécier la finesse des ornements ; enfin les objets découverts lors des fouilles des tumuli de l’époque Silla, principalement des couronnes en or dont nous avons pu mesurer non seulement la beauté artistique mais également la fonction sociale à l’époque. Mme Chae-Duporge a souligné l’importance de considérer les visions taoïstes et chamaniques incarnées dans chacune des réalisations artistiques de l’époque.

Cette approche a ensuite été complétée par l’analyse de l’art bouddhique.
Mme Chae-Duporge a illustré cette partie de son exposé en citant en premier lieu l’exemple du temple de Bulguksa et de la grotte de Seokguram du Grand Silla en les considérant comme des représentations concrètes de la vision bouddhique du monde, sublimée par une grande qualité artistique et une maîtrise des techniques impressionnante pour l’époque. Nous avons découvert parmi les autres réalisations celle à son apogée, de la sculpture bouddhique en Corée, qui résulte en droite ligne de l’épanouissement du style Gupta indien transmis par l’intermédiaire de la route de la soie. A cet âge présenté comme « classique » pour la sculpture bouddhique, a succédé la peinture bouddhique de Goryeo qui reflète les goûts de la cour de l’époque, de la noblesse et du clergé bouddhiste.
Les céladons, un autre art représentatif de cette période, est décrit en comparaison avec la porcelaine blanche de la dynastie suivante, celle de Joseon, qui témoigne d’un fort contraste. Celui qui distingue une esthétique de sophistication et de subtilité durant l’époque Goryeo et celle de la sobriété des lettrés de Joseon, période profondément marquée par les thèses confucianistes.

Pour la peinture de Joseon, Mme Chae-Duporge a surtout insisté sur la présence de la peinture de la couleur (chaesaekhwa) qui englobe deux catégories de peinture réalisée à la fin de cette dynastie : la peinture de cour (gunjunghoehwa) et la peinture populaire (minhwa). Malgré la grande différence des statuts sociaux des commanditaires, leur point commun est l’utilisation prononcée de la couleur et leur utilité décorative. La conférencière a souligné que ces peintures, restées pendant longtemps dans l’ombre de la peinture des lettrés et de leur vision sino-centrée, devaient retrouver leur place dans l’histoire de l’art coréen.
Mme Chae-Duporge n’a pas négligé l’art moderne et contemporain. Elle a consacré la dernière partie de sa conférence à un rappel chronologique de l’art du 20e siècle souvent inspiré par l’art occidental, en s’attardant sur l’un des mouvements artistiques les plus marquants des années soixante-dix, la peinture monochrome coréenne (dansaekhwa). Ce mouvement illustre à sa manière un aspect essentiel de la coréanité, et ce, malgré l’influence indéniable du minimalisme américain. On peut dire que ce mouvement jouit incontestablement d’une grande attention sur la scène artistique internationale actuelle.
Durant cette conférence, Mme Chae-Duporge nous a offert un moment de découverte de l’histoire de l’art coréen, en ponctuant sa présentation d’anecdotes et de réflexions sur la perception de cet art coréen sous des visions croisées, coréennes ou non. En deux heures à peine, nous avons plongé dans des siècles d’histoire de l’art coréen, sautant d’illustrations en illustrations projetées au tableau à une cadence régulière ininterrompue. Nombreux étaient les étudiants de toutes les formations de notre université à avoir fait le déplacement pour assister à cette conférence qui nous a unanimement surpris par sa densité. Beaucoup d’entre nous n’avions jamais eu l’occasion de nous intéresser à l’art coréen. Grâce à cette conférence, nous avons pu découvrir l’éventail très large et la richesse des œuvres coréennes. Les nombreuses photos prises par Mme Chae-Duporge sur place en Corée ou dans des musées internationalement connus, nous ont permis d’apprécier, comme si l’on y était, le raffinement des productions artistiques coréennes.
Mme Chae-Duporge a élargi notre culture générale et stimulé notre curiosité sur l’art de la Corée. Après cette présentation captivante, beaucoup d’entre nous avons posé des questions sur des points particuliers de l’art coréen. Nous avons également pu consulter les beaux ouvrages sur l’art coréen que M. Couralet avait rapportés de la bibliothèque universitaire pour accompagner cette conférence. Cela a été également le moment de découvrir qu’il y avait des ouvrages magnifiques à ce sujet sur les étagères de la petite bibliothèque consacrée en partie à la Corée.
Merci infiniment à Mme Chae-Duporge pour sa présentation passionnante et à M. Couralet pour avoir organisé cette conférence qui nous donne envie d’en savoir plus !
 Marie Dugay
Marie Dugay
The Jangseogak Archives at the Academy of Korean Studies is accepting applications for 2018 Jangseogak Hanmun (Classical Chinese) Summer Workshop, a three-week intensive on-campus language course from 2nd July to 20th July, 2018. We welcome application from undergraduate students, graduate students or advanced degree holders of Korean Studies and/or East Asian Studies. Applicants must have studied at least one year of Classical Chinese or completed comparable course in Asian Studies.
The workshop will run for 6 hours from Monday to Friday for three weeks (morning lectures and afternoon practicum for translation), and will also include field trips to explore historic sites related to the reading materials addressed in the workshop.
The workshop aims at creating a global knowledge-building community of Korean studies. All lectures and discussions at the workshop will be conducted in English; at the same time, it will require translation of the original sources into English. Apart from the translation project, each participant will write a no more than ten-to fifteen-page introductory article on one primary source of his/her own choice from a list of fifty texts derived from the Archives (to be completed within six months from the completion of the workshop). The fifty texts will be carefully selected by the scholars of the Archives in consideration of the participants’ expertise and interests. The authorship of each translated piece and article will be accredited to the individual contributor; however, both the translated sources and the introductory articles will belong to the public domain of Korean studies and be published online for academic purposes.
The Academy of Korean Studies will provide the participants with round-trip airfare (no more than 1,800 USD), tuition, and board and lodging.Undergraduate and graduate students are required to submit a letter of recommendation from their advisors.
Deadline: February 14th, 2018 (6pm Korean Standard Time)
The application results will individually be notified by March 7th, 2018
Please send the following materials in single PDF file to hanmun@aks.ac.kr (email application only)
- Current CV (including language proficiency)
- Statement of Purpose (no more than five pages, double spaced). Please include the following
- Academic background and interests
- Previous experience in East Asian Languages
- Objectives and expectations for attending the workshop
- Description of how the study of hanmun and/or Joseon (Chosŏn) source materials will contribute to your research
- an unofficial transcript OR a copy of your institutional certificate/degree certificate
Undergraduate and graduate students only: One confidential recommendation letter addressing the importance of hanmun to your study should be sent directly by the referee by February 14th, 2018 to hanmun@aks.ac.kr.
Questions may be directed to hanmun@aks.ac.kr.

organisé par Anne Castaing (CNRS/CEIAS) et Benjamin Joinau (Hongik University/CRC)
La « communauté imaginée » qu’est la nation mobilise les symboles les plus archétypaux pour se représenter dans les arts et les médias populaires et ces symboles sont le plus souvent genrés – que l’on pense à la Marianne de la jeune République française. En plus d’être l’écho du genre grammatical des valeurs de cette république dont elle est l’allégorie, Marianne est la figure de l’Alma Mater, à la fois nourricière et protectrice, qualités essentielles d’un Etat-nation ou d’un régime politique. Mais comment se pense une nation divisée politiquement par une partition ?
Allemagne, Inde-Pakistan-Bangladesh, Irlande, Corée, Vietnam, Israël-Palestine, Yougoslavie – les cas de figure sont divers, couvrant jusqu’aux décolonisations, mais montrent que la partition renvoie spontanément à des représentations polarisées autour de relations genrées et hiérarchisées. De manière allégorique, celle-ci peut prendre la figure du frère et de la sœur, de la mère et du fils, même si le plus souvent, l’image du couple marié ou amoureux cherchant à se réunir est prédominante. Cependant, le binôme à (ré)apparier n’est pas le seul mode de symbolisation genrée de la division nationale. La partition, en tant que processus même, génère des violences, qui sont fondamentalement structurantes des rapports homme-femme aussi bien au niveau des pratiques que des représentations. En particulier, les femmes, porteuses et garantes de l’identité ethnique, sont couramment l’objet de violences sexuelles. Le viol, l’humiliation, la souffrance, le deuil (mari, enfants) infligés aux femmes et aux hommes en situation de partition en font le symbole non plus seulement d’une partie, mais du tout de la Nation divisée. Les femmes sont ainsi souvent investies d’un enjeu symbolique où se jouent, en plus des identités genrées, les identités collectives et leurs représentations. Ces dernières sont rarement monolithiques et font elles-mêmes l’objet de combinaisons variées et concurrentes, révélant la dynamique qui se joue au niveau de l’imaginaire d’une communauté quand elle est confrontée à une division interne. Plus que des symboles isolés, ce sont des mises en récit complexes que nous devons appréhender dans leur diversité narrative. Pour plus d’informations, voir le site de l’EHESS.

Séminaire sur l’architecture coréenne
La section d’études coréennes de l’UFR LCAO de l’Université Paris Diderot a le plaisir de vous informer de la tenue d’un séminaire exceptionnel intensif en master études coréennes. Les auditeurs libres sont les bienvenus.
* * *
Séminaire exceptionnel 2017-2018, Master Études coréennes (M1, M2)
(université nationale de Séoul)
« Histoire comparative de l’homo architectus européen versus l’homo architectus coréen »
Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris
Dans ce séminaire, on conçoit l’architecture comme une activité artistique et culturelle. En comparant des œuvres architecturales européennes et coréennes reconnues comme chef-œuvres, de la préhistoire à l’époque contemporaine, on abordera la problématique de la spatialité et de l’ordre architectural.
Contact : Kim Jin-Ok (jin-ok.kim@univ-paris-diderot.fr)

La section d’études coréennes de l’UFR LCAO de l’Université Paris Diderot a le plaisir de vous convier à la deuxième séance des Rencontres mensuelles du cinéma documentaire coréen, qu’elle organise en partenariat avec DMZ Documentary Film Festival (DMZ Docs). Le film de décembre est « Family in the Bubble » (Corée du Sud, 2017, 77mn). La projection sera suivie d’une discussion animée par Mme KIM Jin-Ok, maître de conférences à l’Université Paris Diderot.
Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris
Entrée libre
Contact : Mme KIM Jin-Ok (jin-ok.kim@univ-paris-diderot.fr)
 Dans les années 80, les parents de Ma Min-ji se sont rapidement enrichis en profitant du boom du marché de l’immobilier. Mais la crise financière de 1997 fit éclater la bulle et se volatiliser leurs rêves d’ascension sociale. Ayant perdu tous leurs moyens, ils refusent de quitter leur modeste appartement de Gangnam, quartier le plus huppé de la Corée du Sud, dont ils n’arrivent plus à acquitter le loyer. Ils attendent toujours de remporter le ‘jackpot’.
Dans les années 80, les parents de Ma Min-ji se sont rapidement enrichis en profitant du boom du marché de l’immobilier. Mais la crise financière de 1997 fit éclater la bulle et se volatiliser leurs rêves d’ascension sociale. Ayant perdu tous leurs moyens, ils refusent de quitter leur modeste appartement de Gangnam, quartier le plus huppé de la Corée du Sud, dont ils n’arrivent plus à acquitter le loyer. Ils attendent toujours de remporter le ‘jackpot’.
Pages