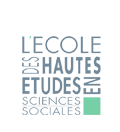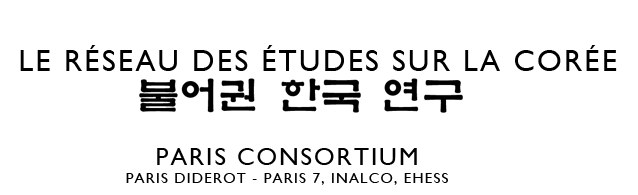Actualités
Actualités

Éduquer en Asie
Mixité, égalité des sexes et enjeux spatiaux
Ce numéro 276 des Cahiers d’Outre-Mer propose d’interroger l’effectivité de la mixité et de l’égalité des sexes dans les systèmes scolaires des différents pays d’Asie. Une approche multidisciplinaire avec des démarches ascendantes ou descendantes permettra de mettre en valeur les différents acteurs de ces espaces. À travers une approche comparative qui inclut la diversité des trajectoires nationales et la circulation transnationale des idées et des savoirs, il s’agira de montrer dans quelle mesure la mixité et l’égalité des sexes définissent des dynamiques et des enjeux spatiaux dans lesquels évoluent des individus comme des groupes, rattachés aux institutions comme aux politiques.
Axes thématiques
Ce numéro vise à identifier la prise en compte de la mixité dans le système scolaire selon plusieurs réflexions :
- la fréquentation des espaces et des équipements scolaires
- les mesures éducatives et les espaces de mixité
- les enjeux de ces espaces de mixité
- de la mixité à l’égalité
Les auteur(e)s peuvent aborder selon différentes disciplines ces sujets. L’espace central d’étude est l’Asie, avec de préférence un focus sur l’éducation pré-primaire et primaire, relativement peu traitées en comparaison avec l’éducation supérieure. Les analyses multi-scalaires ainsi que les études de cas précis et illustrés par des données de terrain récentes sont les bienvenues.
Calendrier et consignes
- Les auteurs ont jusqu’au 30 juillet 2017 pour envoyer les textes complets (50 000 signes maximum comprenant la bibliographie, les résumés, mots clés et présentation du/des auteurs) à : emilie.ponceaud@yahoo.fr et aline.henninger@free.fr
- Les consignes de présentation sont disponibles sur le site de la revue (https://com.revues.org/).
- La publication du numéro est prévue fin décembre 2017.
- L’article inclut votre nom, votre institution de rattachement, vos adresses postale et électronique.
- Format de l’objet du courriel : COM, date (mois+jour), votre nom (en majuscule), le titre de l’article.
- Envoyer en .doc ou .docx
Lire l’annonce complète sur le Calendrier des lettres et sciences humaines et sociales
Le vendredi 19 mai après-midi, dans les Salons de la Maison de l’Asie, Laurent Quisefit, post-doctorant du RESCOR, chercheur associé de l’Equipe Corée de l’UMR 8173, a présenté une conférence sur le thème des Français au service de la Corée à travers l’exposé de ses recherches sur l’association « Les Amis de la Corée » (1921).

Laurent Quisefit et Valérie Gelézeau
L’intervention a démarré par un rappel du colloque « Le mouvement d’Indépendance coréen et la France à l’époque de la colonisation japonaise » qui s’était tenu à Paris-Diderot le 11 avril 2016 avec la participation, notamment, du Mémorial de l’Indépendance (독립기념관), et dont l’organisation avait conduit à l’examen des archives de Louis Marin conservées aux Archives Nationales, qui, malheureusement, n’a pas donné lieu à de grandes découvertes.
Laurent Quisefit est d’abord revenu sur l’histoire de l’association « Les Amis de la Corée » qui fut fondée dès l’arrivée de la délégation coréenne à la Conférence de la Paix de Paris en 1919, pour laquelle elle ne reçut pas d’accréditation. Les activités multiples de la délégation étaient gérées par le Bureau d’Information Coréen sis au 38, rue de Châteaudun, Paris 9e art., qui périclita dès 1920, par le manque de moyens du gouvernement provisoire à Shanghai.
L’intervenant a dès lors insisté sur la relève des activités de l’association par Félicien Challaye et Scie Ton Fa (franco-chinois dont on ignore la transcription exacte du nom). Ces deux derniers assurèrent, dès mai 1920, la publication de la revue La Corée Libre (dont deux volumes sont disponibles à la BULAC). C’est dans le numéro 10 que l’on a d’ailleurs retrouvé un appel pour une initiative visant à fonder une ligue des amis de la Corée puis une liste des personnes pressenties. La Corée Libre, dont la publication s’arrêta en mai 1921, laissa ainsi sa place à « Les Amis de la Corée » un mois plus tard.

Laurent Quisefit a retrouvé une annonce de la création de l’association dans le journal La Presse en date du 21 juin 1921. Après la séance inaugurale au Musée Social le 23 juin, placée sous la présidence de Louis Marin, les quelques lettres lues par Scie Ton Fa ce jour-là furent reprises dans le journal XIXe Siècle, le 24 juin. Il a souligné l’intérêt des profils des personnes présentes à cette réunion constitutive (entre autres, Ferdinand Buisson, Julien Godart, Pierre Mille, Marcel Sembat), des hommes politiques mais aussi hommes de lettres, enseignants, publicistes, etc., pour beaucoup membres de la Ligue des Droits de l’Homme, qui avait elle-même coopéré dès 1920 avec la délégation coréenne. Cette variété de profils, bien que remarquable, montre la complexité et la multiplicité des parcours, qui mettent elles-mêmes en exergue un problème certain d’éparpillement qui a pu nuire à l’association. En effet, après l’été, alors que la délégation coréenne avait quitté Paris, elle ne semble pas avoir repris ses activités.
Laurent Quisefit s’est également penché sur la vie de Scie Ton Fa et de Félicien Challaye. Il ressort de son enquête un problème fondamental : celui du temps qui passe dans la recherche en histoire et qui entraîne, bien souvent, la disparition des archives au sens large, c’est-à-dire la disparition de témoins directs, la non transmission du nom par dissolution familiale ou encore l’absence de versement systématique aux Archives Nationales. Il est à noter qu’on ne sait toujours pas si Louis Marin se débarrassa ou non des documents relatifs à l’association dans la mesure où il n’y a aucune trace officielle de sa dissolution.
Ce premier travail de recherches ouvre de nouvelles pistes comme l’exploitation des archives de la Ligue des Droits de l’Homme, de la succession de Félicien Challaye, des archives de la famille Fa ou Xie à Taïwan où repartit Scie Ton Fa… Il révèle aussi l’intérêt de faire financer et de publier en Corée, tant qu’il est encore temps, le recueil des témoignages des anciens de la Corée où une majorité de chercheurs coréens travaillent uniquement à partir de sources secondaires.
Laurent Quisefit est l’auteur d’une thèse publiée en 2006, intitulée « Le rôle de la France dans le conflit coréen (1950-1953), contribution à une histoire diplomatique et militaire des relations franco-coréennes », et poursuit actuellement ses recherches tout en enseignant à l’université.
 Julia Poder
Julia Poder

Établie en 1999, l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né du regroupement de l’École Nationale d’Ingénieurs de Belfort et l’Institut Polytechnique de Sevenans. Elle s’investit dans la formation d’ingénieurs rapidement opérationnels en s’appuyant sur des activités de recherche et sur la valorisation. Ainsi, plusieurs parcours sont proposés aux étudiants, en alternance ou en formation initiale : l’informatique, le génie mécanique et la conception, l’ingénierie et le management des systèmes industriels, l’énergie, l’ergonomie, le design et l’ingénierie mécanique. L’université accueille environ 3000 étudiants de la licence au doctorat dont près de 600 étudiants internationaux.

Étudiants du cours de coréen pratique (2017)
Au sein de la formation d’ingénieur, le département des humanités offre une ouverture significative sur les sciences humaines. Elles représentent 30% des enseignements sur les cinq années de formation d’ingénieurs. L’objectif assigné à ces enseignements est double : permettre l’acquisition de compétences spécifiques utiles à l’exercice du métier d’ingénieur et favoriser l’acquisition par les étudiants d’une solide culture générale, notamment par le biais d’un apprentissage de langues étrangères.
Ainsi, le pôle langues étrangères et communication propose des cours de coréen qui sont ouverts chaque semestre à tous les étudiants sur plusieurs niveaux : coréen vrai débutant, coréen niveau 1, coréen pratique et préparation au TOPIK. Le pôle culture générale offre quant à lui deux cours qui s’inscrivent dans les études coréennes : Regards croisés sur l’Asie et Comportement culturel et relations humaines.

Étudiants coréens en échange et professeur invité à l’UTBM lors du repas de fin de semestre chez la professeure Jung Sook BAE
La professeure Jung Sook BAE, aidée par deux intervenants extérieurs, est responsable de ces cinq unités de valeurs. Docteur en phonétique et en psychologie, elle est affiliée au laboratoire RECITS, lui-même rattaché à l’université. Ses recherches portent sur les problèmes interculturels entre l’Asie et l’Europe, et leur impact pratique. Elle s’intéresse notamment au perçu psycho-historique de l’occupation étrangère, en particulier sur la mémoire et la perception de l’occupation japonaise en Corée et de l’occupation allemande en France.
Deux ouvrages ont d’ailleurs paru au Pôle éditorial multimédia de l’UTBM :
- Regards interculturels vers l’Asie, Jung Sook BAE, 2007 (ISBN 978-914279-34-5)
- Corée-France, Regards croisés sur deux sociétés face à l’occupation étrangère, Robert BELOT, Woo Bong HA et Jung Sook BAE, 2013 (ISBN 978-914279-67-3)
La langue et la culture coréennes sont enseignées à l’Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 1983. Diverses formations ont été dispensées depuis plus de trente ans, tant en formation initiale qu’en formation continue.
Grâce à l’ouverture en 2014 de la licence LEA anglais-coréen et à celle du master en 2017, la faculté des langues de Lyon 3 offre un parcours complet en enseignement de langue coréenne, unique dans le Sud-Est de la France.

Les formations en coréen délivrent un ensemble de connaissances linguistiques, culturelles et historiques sur la Corée. L’apprentissage de la langue est associé au contexte socio-économique. L’accent est mis sur le fonctionnement de la société coréenne moderne et contemporaine, sa complexité et sa diversité.
Le Département d’Études coréennes propose un diplôme national et un diplôme d’université :
La filière LEA (Langues Étrangères Appliquées Anglais-Coréen) : de la Licence au Master (parcours ouverts : Langues et gestion, Commerce international, Communication internationale des entreprises et des administrations), une approche des langues vivantes tournée vers l’entreprise, avec l’apprentissage de 2 langues étrangères de même niveau dont l’anglais.
Diplôme Universitaire Langue et culture coréennes : Un diplôme universitaire d’apprentissage de la langue à trois niveaux dont les cours sont organisés en soirée complète la formation. Les cours de DU Langue et culture coréennes peuvent également être suivis au titre d’une Unité d’Enseignement d’Ouverture (UEO) d’un diplôme national (licence LEA ou licence LLCER).
L’université Jean Moulin Lyon 3 a noué depuis plusieurs années des liens institutionnels et académiques avec les universités sud-coréennes suivantes :
– Busan University of Foreign Studies (부산외대, Pusan)
– Dongeui-University (동의대, Pusan)
– Dongguk University (동국대, Séoul)
– Hankuk University of Foreign Studies (한국외대, Séoul)
– Inha University (인하대, Incheon)
– Pusan National University (부산대, Pusan)
– Sogang University (서강대, Séoul)
– Sookmyung Women’s University (숙명여대, Séoul)
– Sungkyungkwan University (성균관대, Séoul)
Les étudiants en troisième année de licence et en master ont la possibilité d’effectuer une partie de leur cursus dans une des universités partenaires ou d’y effectuer un stage d’immersion de courte durée.

Depuis trois ans, le Département d’Études coréennes organise chaque année au sein de l’université ce test de niveau de langue coréenne.
Créée en 2015, cette association accueille les étudiants du coréen de la Faculté des Langues de l’université. Elle vise à faire découvrir le patrimoine et les traditions coréennes à travers de nombreux évènements pédagogiques et culturels (présentation de tenues traditionnelles, projections de films, rencontres, dégustations, soutien scolaire…), afin de renforcer les connaissances de ses membres sur la langue et la culture coréenne dans un cadre amical et agréable.
La Faculté des Langues organise l’année de la Corée de septembre 2017 à juin 2018 pour rendre plus visible le dynamisme de l’enseignement de coréen à Lyon 3. Un programme précis mentionne l’ensemble des événements qui auront lieu parmi lesquels on trouve des différentes dates à mentionner dans l’agenda.
À l’occasion de la parution de sa nouvelle revue, Asia Centre a organisé une table ronde dans les locaux de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) le vendredi 9 juin avec la participation de l’hebdomadaire Courrier International. L’objectif de cette rencontre était donc de présenter Asia Trends : L’Asie à la Source – Key Insights & Analysis, bulletin semestriel bilingue et interdisciplinaire ayant pour ambition de s’inscrire dans les dynamiques des réalités locales de la région Asie-Pacifique.

Animé par Eric Chol et Agnès Gaudu, respectivement directeur de la rédaction et chef du service Asie à Courrier International, le rendez-vous a débuté par une prise de parole du président d’Asia Centre, Jean-François Di Meglio. Après être revenu rapidement sur l’activité de ce centre (cf. http://parisconsortium.hypotheses.org/3130), il a détaillé les démarches de la création de cette nouvelle édition qui se veut au plus près des sources, à l’écoute des évènements asiatiques, pour une vision plus intégrée, plus globale et interdépendante de l’Asie. Il a également remercié le Ministère de la Défense pour son soutien apporté dans l’élaboration de ce nouveau bulletin.
Asia Centre publiait précédemment trois revues spécialisées : China Analysis et Japan Analysis depuis 2005, ainsi que Korea Analysis de janvier 2014 à octobre 2016. Elles laissent donc leur place à Asia Trends, qui étend son champ de recherche aux pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud tels que l’Inde ou l’Indonésie.
Cette nouvelle publication a pour projet d’exposer à chaque numéro un angle majeur d’approche et des analyses plus focalisées selon les pays. Ainsi, ce premier bulletin traite du défi terroriste à travers l’Asie et se penche ensuite, sous la forme de dix articles, sur des questions d’actualité en Chine, au Japon, et en Corée notamment. À ce sujet, deux d’entre eux pourront nous intéresser : celui de Jean-Raphaël Chaponnière à propos des enjeux économiques de la nouvelle présidence en Corée du Sud, et celui de Léonie Allard et Sulmi Park relativement au débat sino-coréen sur l’implantation du THAAD (système de missiles antibalistiques américain) sur le sol sud-coréen.
 Julia Poder
Julia PoderDans le cadre du séminaire pluridisciplinaire d’études coréennes de l’EHESS placé cette année sous la direction du professeur Alain Delissen, une série de quatre conférences a été tenue dans les locaux de Paris-Diderot et de la Maison de l’Asie les 5, 11, 12, et 19 mai 2017.
L’intervenant, le professeur Hwansoo Kim, diplômé de Harvard, enseignant à la Duke University en Caroline du Nord, et invité par l’EHESS, a focalisé depuis plusieurs années ses recherches sur l’histoire du bouddhisme coréen, notamment pendant la période de l’annexion de l’empire de Corée par l’empire du Japon (1910-1945). Les conférences présentées ont ainsi été conçues autour de son thème de recherche de prédilection, en proposant plusieurs angles d’approche, abordant successivement la question des cultes, des sources, des acteurs et enfin de l’espace politique et social du monastère, le tout dans une perspective transculturelle recourant à des sources multiples dans plusieurs langues d’Asie Orientale, en particulier la presse.

Le professeur Hwansoo Kim
La première conférence intitulée « A Buddhist Christmas: The Buddha’s Birthday Festival in Colonial Korea » a porté sur la reconfiguration des cérémonies célébrant l’anniversaire du Bouddha, entre 1928 et 1945 sous la forme « modernisée » de la « Fête des Fleurs » organisée en grande pompe avec « lâchers de fleurs » par avion au-dessus de Séoul, et de manière conjointe par les bouddhistes japonais et coréens avec la bénédiction du gouvernement général qui cherchait à unir les deux communautés qui, jusqu’alors, fêtaient séparément l’événement. Ce faisant, ces derniers s’inscrivaient dans un mouvement de renouveau du bouddhisme international prenant sa source au Sri Lanka, susceptible de faire pendant à la fête de Noël tout en s’inspirant des techniques prosélytes chrétiennes, en créant une nouvelle la conscience d’une identité bouddhique à la fois nationale et transnationale, et en instaurant un nouveau rapport de force dans le paysage religieux de la péninsule. Après la Libération, la fête, dont la structure avait été élaborée à l’époque coloniale, s’est perpétué jusqu’à nos jours sous le nom de « fête des Lanternes », et inscrite comme trésor culturel par la ville de Séoul au titre de fête coréenne « traditionnelle ».
La conférence du jeudi 11 mai, « Building a Buddhist Empire: The Reprinting and Distribution of the Koryŏ Canon in and beyond Colonial Korea (1910-1945) », a porté sur le canon bouddhique, et plus précisément sur la gravure du canon réalisée à l’époque du Koryŏ (918-1392 ; connu aussi sous le nom de Tripataka Koreana et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, conservé au monastère de Haein sous la forme de plus de quatre-vingts mille planches gravées), comme élément de cristallisation d’un capital symbolique, politique, religieux et diplomatique réactualisé et réinvesti à l’époque de domination du gouvernement général du Chosen. À l’époque du Chosŏn, déjà, des représentants d’autorités japonaises avaient à maintes reprises réclamé ce trésor à la cour coréenne, qui en utilisait des copies (plus ou moins complètes) comme dons à des fins diplomatiques (mais aussi comme objet de recherche). Affirmant avoir « découvert » l’édition xylographiée de la période médiévale coréenne, les autorités coloniales lancèrent deux vastes et couteux projets d’éditions, respectivement en 1915 et 1938, destinées notamment à l’empereur Taisho puis à l’empereur Puyi comme cadeau diplomatique de l’empire nippon au Mandchoukouo (1932-1945). La réaction des Coréens fut un mélange de colère et de fierté vis-à-vis de ce canon devenu trésor national et reconnue internationalement en Asie Orientale. Après la Libération, une des copies de 1938 fut récupérée par la Corée du Nord et traduite en coréen en 1980. En 2011, pour fêter le millénaire de la fabrication du canon bouddhique coréen, une impression partielle fut offerte à Kim Jeong-il par le Sud comme symbole de réunification, montrant ainsi son importance renouvelée à l’époque contemporaine.
« Competing Transnational Buddhisms: Yu Guanbin’s Contribution to Taixu’s Buddha-ization Movement in 1920–30s Shanghai » a été le titre de la troisième conférence de Hwansoo Kim, le 12 mai. Elle a consisté dans le récit relatant la vie pour le moins étonnante et peu connue du Sino-coréen Yu Guanbin (cor. Oak Kwanbin ; 1891-1933), entrepreneur établi à Shanghai au milieu des années 1920. Ce dernier collabora avec Taixu (1890-1947), le leader du renouveau du bouddhisme en Chine, pour la promotion d’un bouddhisme transnational sous le nom de « Mouvement de Buddhisation » (fohua yundong). Il fut à cette époque l’un des représentants du mouvement de modernisation du Bouddhisme est-asiatique. Il fut extrêmement intéressant de constater l’asymétrie entre les identités multiples de ce personnage à la fois Coréen et Chinois, multilingue, habile en affaires, nationaliste coréen puis musulman et, enfin, bouddhiste. Il échoua toutefois dans sa tentative de reconstruction du monastère Gaolisi (cor. Koryŏsa), fondé au XIe siècle à Hangzhou.

Dans les locaux de l’EHESS à la Maison de l’Asie
Pour sa dernière intervention (« A Modern Buddhist and Colonial Monument: Manufacturing the Great Head Temple T’aegosa in 1938 Downtown Seoul »), le professeur Kim a analysé le processus de fondation du monastère de T’aego au centre de Séoul, pendant la période coloniale, dans un contexte de centralisation accrue des institutions monastiques, monastère actuellement dénommé Chogyesa, siège et centre administratif de l’ordre bouddhique sud-coréen de Jogye. À la fin des 1930, le coût de la construction fut considérable et nécessita des collectes internationales de fonds. Le bâtiment récupéra les matériaux de construction d’un ancien temple (le pavillon Sibil) du mouvement religieux millénariste du Poch’òngyo, situé dans l’actuelle province du Chŏlla du Nord, notamment les colonnes faites dans un bois importé de Mandchourie. On y déposa des statues fabriquées six siècles auparavant et conservées à Mokp’o, tout en invoquant le patronage illustre (et symbolique) du moine T’aego Po’u de la fin du Koryò, en rapport avec une de ses fondations, alors désaffectées, dans la banlieue de Séoul. Le T’aegosa incarna en son temps une institution centralisée et modernisée du bouddhisme coréen, sous la coupe du pouvoir colonial, perpétuant une longue tradition de relations privilégiées avec l’État.
À travers ce cycle de conférences, le professeur Hwansoo Kim a mis en évidence, à l’époque coloniale, les stratégies politiques adoptées par les autorités du bouddhisme coréen : autant d’efforts de réinvention et de modernisation de l’ancienne religion d’État déchue de son statut et de son rôle à l’époque du Chosŏn. Ainsi, la période coloniale ne doit pas être considérée d’un point de vue manichéen : les bouddhistes coréens surent, jusqu’à un certain point, utiliser le système pour asseoir leur pouvoir, le centraliser, le réguler et se distinguer d’autres courants religieux en renforçant leur identité nationale. Parallèlement, il est intéressant de constater les multiples tentatives de collaboration transnationale et d’unification des bouddhistes de différents pays d’Asie Orientale sous l’Empire japonais. C’est en recourant à une approche toujours transnationale que Hwansoo Kim a annoncé la préparation et la publication prochaine d’une deuxième monographie. Gageons qu’à l’instar de son Empire of the Dharma: Korean and Japanese Buddhism, 1877-1912, publié en 2013 aux presses du Harvard University Asia Center, il saura renouveler de manière stimulante le discours historiographique dominant produit en Corée du Sud à propos du bouddhisme pendant la période d’annexion.
 L’équipe du RESCOR en collaboration avec Julia PODER (stagiaire du RESCOR 2017)
L’équipe du RESCOR en collaboration avec Julia PODER (stagiaire du RESCOR 2017)Pages