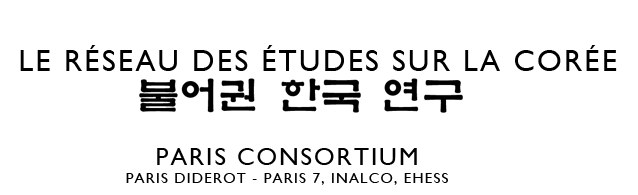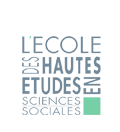En guise de propos introductif, il me semble important de souligner le rôle du RESCOR dans ma trajectoire personnelle. L’atelier « matériaux pour l’enseignement sur la Corée » à Aix-en-Provence (mai 2013) fut l’occasion pour moi d’entrer dans la sphère des études coréennes francophones. Depuis, les membres, les événements et le support du RESCOR m’ont aiguillé dans mon parcours académique, mes axes de recherche et m’ont donné accès à un très grand nombre de ressources. Je remercie donc le réseau et ses membres pour leurs initiatives et leur action !
Le texte qui suit et les remarques qu’il contient sont issus de mes carnets de recherche où j’ai consigné sur une base quotidienne mes trouvailles, idées et impressions. Mon séjour en Corée du Sud de juin à septembre 2016 avait pour objectif de rassembler des documents de première main, dans divers lieux de conservation d’archives. Le sujet initial, situé dans le domaine de l’histoire de l’éducation, portait sur les cursus d’instituteurs à partir d’une école primaire à Jinju, dans le sud du pays, afin d’analyser les mobilités de ce groupe professionnel (entre 1895 et 1938). L’imagination autour du sujet n’a pas entièrement résisté à la réalité des archives, ce que je décris plus bas. Avant mon arrivée sur place, j’avais identifié et opéré des choix de lieux à visiter absolument, répartis entre Séoul, Jinju et Changwon. Le choix s’est principalement fait à partir du nombre d’archives disponibles et de la proximité géographique ou administrative des lieux avec mon sujet. Séoul regorge de ressources administratives sur la période coloniale, sur le Gouvernement général de Corée et ses organes éducatifs, notablement à la Bibliothèque nationale de Corée. Changwon est le centre archivistique de la province du Gyeongsang du Sud (Kyŏngsangnam–do) en histoire de l’éducation. Enfin, Jinju est la ville que j’ai décidé d’explorer pour mon sujet. Plus précisément je me suis intéressé à une de ses écoles primaires qui figure parmi les plus anciennes de Corée (1895) et à l’école normale qui y est fondée pour former des maîtres en 1923. Mon temps s’est réparti entre les trois villes de la façon suivante : une semaine à Jinju et trois semaines à Changwon en juillet, les deux mois restants à Seoul.
Au cours de mes visites dans les lieux choisis, j’ai eu le loisir d’observer des politiques de conservation et d’accueil différentes, ce qui constitue une des expériences les plus enrichissantes de mon séjour. Les archives de Changwon, les premières auxquelles je me suis rendu, ont déroulé un véritable tapis rouge : accueil chaleureux, visite guidée du centre, don d’ouvrages généralistes sur l’éducation dans le Gyeongsang du Sud, accès au listing papier de toutes les archives, discussion sur les pistes possibles, numérisation en haute qualité des sources choisies, contact permanent et rapide, encore récemment. Le centre est situé dans les locaux d’une école primaire de la ville, en périphérie urbaine, son taux de fréquentation est de ce fait très variable, ce qui permet une prise en charge des visiteurs personnalisée. Inversement, le musée de l’Université normale de Jinju est situé au sein d’un important complexe, le Centre pour la culture éducative (Kyoyuk munhwagwan). Le personnel est donc réparti entre une multitude de tâches, la partie archivistique n’étant pas la plus importante. L’accueil y fut excellent mais la consultation d’archives plus procédurale, de l’obligation logique de porter des gants à celle de donner une multitude d’informations privées en plus des informations sur le sujet de recherche. Le temps disponible pour consulter les archives et la possibilité de prendre des photos firent aussi l’objet d’une procédure écrite. Cependant, un hasard de lieu et de calendrier m’a fait rencontrer le directeur du centre, alors que je visitais le musée de l’université. J’ai bénéficié d’une visite guidée personnalisée et d’un entretien informel d’une trentaine de minutes, riche en pistes de réflexion sur la moralité de l’instituteur, aujourd’hui comme il y a quatre-vingts ans. Si cela n’était pas déjà le cas, j’ai pu constater la part que joue le hasard dans une recherche. La Bibliothèque nationale de Corée se situe quelque part sur l’axe procédural entre ces deux institutions : il suffit de prendre le temps d’une inscription initiale avec la possibilité de choisir entre une carte à la journée et une carte à l’année avant de faire une demande électronique de consultation d’un ou plusieurs documents depuis les ordinateurs ou l’application mobile, récupérable à la banque du rez-de-chaussée en principe. Outre les centres cités, mes recherches m’ont mené vers d’autres structures de taille variable, des archives de la bibliothèque centrale de l’Université nationale de Séoul et de son département de formation des instituteurs à des archives privées chez des particuliers qu’il m’aura fallu appeler et rencontrer avant que ceux-ci ne m’ouvrent leurs portes. Les sources ne se trouvant pas toujours (voire souvent) à l’endroit souhaité, il est facile de s’éparpiller par nécessité ou « gourmandise » et il m’a donc semblé important de consigner scrupuleusement le lieu de conservation de chaque document, dans le but de ne pas en perdre la trace.
Le traitement des listes d’archives disponibles à Changwon a orienté le reste de mes recherches. Comme évoqué précédemment, il s’agit du centre régional pour la collecte des archives liées à l’histoire de l’éducation de l’ensemble de la province, ce qui en faisait un point de référence pour créer une topographie du type de sources disponibles. Force fut de constater qu’il m’aurait été difficile de traiter le sujet initial centré sur une étude des cursus et des carrières des instituteurs : il existe un déséquilibre général entre la quantité d’archives concernant les étudiants (facilement organisables en corpus et nombreuses) et celle sur les instituteurs (disséminées et peu nombreuses). J’emploie le terme difficile et non pas impossible car c’est l’éparpillement, plutôt que le faible nombre de documents qui a influencé l’adaptation de mon sujet. J’ai dû et pu m’adapter assez rapidement puisque j’ai découvert parmi les sources disponibles à Changwon et traitant des instituteurs un type de document intéressant, des mémento (pimangnok) imprimés par l’Ecole normale de Chinju entre 1941 et 1944, de la taille d’un petit carnet (such’ŏp). Ces mémentos dont la taille varie entre trente et deux cent pages traitent de sujets difficiles et vagues (l’unité de la Corée et du Japon) et de considérations plus techniques et/ou normatives sur le travail d’instituteur, du port de l’uniforme à la conservation du matériel de classe en passant par le salaire et les avantages de la fonction. Des informations renseignées par leurs propriétaires me permettent d’établir qu’il s’agit de documents distribués par l’École normale à ses élèves. Après avoir exploré les sommaires, j’ai tenté de vérifier sinon la représentativité, du moins la récurrence de ce type de document dans d’autres fonds d’archives : j’ai trouvé des documents similaires au musée de l’École normale de Jinju, mais aucun dans les centres d’archives visités à Séoul, ce qui pourrait indiquer un ancrage local de ce format « mémento ». En revanche, j’ai pu trouver dans tous les centres d’archives un grand nombre de documents sur le thème général de mon nouveau corpus, la morale, plus précisément la rectitude attendue de la part des instituteurs dans l’exercice de leur travail. L’ensemble du corpus de sources primaires en japonais, concernant la péninsule, ne me permet pas de traiter des trajectoires professionnelles des instituteurs sur le long cours mais il autorise une analyse de l’exercice du métier d’instituteur sur la base d’aspects variés (tenue d’une classe, activités, règlements de la profession, philosophie générale du métier). Cette adaptation du sujet a exercé une influence sur la bibliographie, la méthode d’analyse — je passe d’une approche prosopographique à une étude qualitative restreinte à quelques documents — et laisse des questions en suspens, notamment sur la situation des instituteurs japonais en métropole ou bien encore le respect des règles édictées dans certains mémentos, en somme l’éternel rapport entre normes et pratiques.

師道 (사의 도, saŭi to): La rectitude du maître, 1943, École normale de Jinju. ©Jean-Baptiste ALARY
À titre d’ouverture pour de futurs bénéficiaires de la bourse RESCOR en études coréennes, trois choses me paraissent importantes lors d’un séjour de recherche et j’ai essayé de les mettre en application durant mes trois mois en Corée : mieux vaut trop noter que pas assez. Prendre des notes plutôt que de faire confiance à sa mémoire est donc un investissement judicieux. Ensuite, la recherche une fois sur place puis le maintien de contacts sont indispensables pour assurer la viabilité de la recherche de documents ou d’entretiens. L’usage du mail étant souvent insuffisant, le téléphone voire le contact visuel sont essentiels, quitte à se montrer insistant. Enfin, rencontrer de nouvelles personnes, sortir du cadre de sa recherche, profiter de son séjour pour (re)découvrir d’autres sujets d’intérêt laissés sur le côté est un « oxygène » nécessaire au bon déroulement de la recherche ! Cela fut mon cas à Changwon où je fus logé par un pasteur local et grâce à qui j’ai pu découvrir à travers les prédications chaque dimanche un micro univers – celui d’un temple protestant – absolument passionnant.

Jean-Baptiste ALARY
Étudiant à l’EHESS en M2 Asie Méridionale et Orientale
Boursier du RESCOR 2016