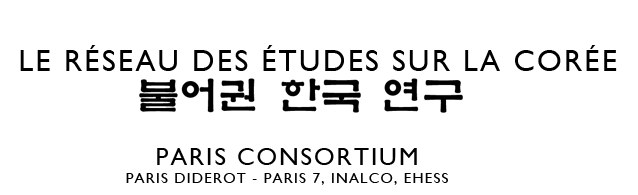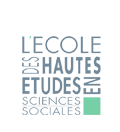Le néoconfucianisme, devenu principe organisateur de la société coréenne pendant la période Chosŏn (1392 – 1897), a instauré un système assujettissant les femmes aux hommes. La société sud-coréenne actuelle a partiellement hérité de ce système et le pays demeure très en retard sur les questions d’égalité homme-femme1. Aujourd’hui encore, dans une société caractérisée par un phénomène de « passions esthétiques »2, les femmes sud-coréennes sont bien souvent réduites à leur apparence physique. Depuis une vingtaine d’années en effet, l’apparence physique occupe une place primordiale dans les relations interpersonnelles et dans la société sud-coréenne en général. Les individus, sans distinction de genre, recourent à divers moyens afin de faire correspondre leurs corps aux idéaux de beauté. Parmi les méthodes employées, la chirurgie esthétique est certainement la plus radicale.
Pourtant, celle-ci se banalise, tant dans les représentations que dans les pratiques. Les cliniques de chirurgie esthétique se regroupent dans des quartiers spécialisés que nous appelons dans cette étude des quartiers de chirurgie esthétique. Le quartier le plus emblématique qui a accueilli les premières implantations de cliniques dans les années 1980, est la zone autour de la station Apgujŏng, dans l’arrondissement huppé de Kangnam. Mis à part l’arrondissement Kangnam à Séoul, où sont regroupées près de la moitié des cliniques du pays, les plus grandes agglomérations ont le monopole pour le reste de la Corée : Pusan, suivie de Taegu et Taejŏn. Notre démarche croise études urbaines et études de genre afin de comparer les quartiers de chirurgie esthétique de Séoul et Pusan.

Figure 1 : Répartition des cliniques de chirurgie esthétique – La « Beauty Belt » de Kangnam. La « rue de chirurgie esthétique d’Apgujŏng » est cerclée de vert (Capture d’écran issue du site daum.net, 01/08/2016, Marine Ganier)
Il est plus aisé de comparer la situation dans ces deux villes si l’on resserre la focale uniquement sur le quartier de chirurgie esthétique établi à Séoul autour de la station Apgujŏng, au nord de Kangnam (cerclée de vert sur la figure 1) et sur la Seomyeon Medical Street établie à Pusan autour de la station Sŏmyŏn, au centre de l’arrondissement Pusanjin. Ces deux quartiers ont ainsi fait l’objet d’une enquête plus approfondie, tout en veillant à éviter la fresque monographique en se cantonnant par exemple uniquement à des limites administratives. En août, une enquête exploratoire lors de laquelle deux entretiens ont été menés, a permis un premier contact avec le terrain. La véritable enquête a été conduite à Pusan les trois premières semaines de septembre (du 1er au 22) suivies de trois semaines à Séoul (du 23 au 12 octobre). Le 10 septembre, la Convention internationale du tourisme médical de Pusan nous a permis de prendre contact avec des professionnels exerçant à Pusan.
Les deux quartiers présentent de fortes similarités au niveau de leur morphologie et de leur processus de formation. Bien que Séoul ait une longueur d’avance sur Pusan, ils se sont tous deux développés sous l’impulsion donnée par la création du métro3 dans les années 1980 suivie par l’implantation de grands magasins4. La ressemblance du plan urbain est assez troublante : les grands magasins jouxtent le côté sud-ouest de chaque station de métro.

Figure 2 : Une portion de la Seomyeon Medical Street, avec à gauche des cliniques dentaire et esthétique, au centre un alignement de p’ojangmach’a (restaurants ambulants qui servent de la cuisine de rue) et à droite, l’entrée Est du grand magasin Lotte. Pusan, 06/09/2016, Marine Ganier
En revanche, dans les représentations des Coréens interviewés, Kangnam et ses sous-arrondissements Apgujŏng et Sinsa sont bien plus associés à l’activité de chirurgie esthétique que Sŏmyŏn. L’activité est également plus hétérogène à Sŏmyŏn (figure 3). En effet les cliniques dentaires et les cliniques de médecine traditionnelle coréenne y sont quasiment aussi nombreuses que les cliniques de chirurgie esthétique, ce qui peut justifier en partie l’appellation choisie par la mairie de Pusan: « medical street »5. L’activité commerciale prime, avec la présence du grand magasin Lotte, une galerie marchande souterraine et un marché alimentaire. L’arrondissement de Kangnam et ses sous-arrondissements jouxtant le fleuve Han sont en revanche des beaux quartiers, associés au luxe, à la mode et aux célébrités. Le sous-arrondissement d’Apgujŏng est aussi depuis les années 1990 un lieu privilégié d’introduction de cultures étrangères en Corée du Sud. Un peu plus d’une dizaine d’entretiens longs ont été réalisés lors de l’enquête, majoritairement auprès de jeunes femmes (20 à 30 ans) mais aussi auprès de professionnels de l’industrie de la beauté et de l’industrie de la chirurgie esthétique dont notamment un chirurgien esthétique, un responsable des relations publiques et des k’odineit’ŏ (de l’anglais « coordinator »), c’est-à-dire des employés chargés de faire passer une première consultation aux patients et parfois rémunérés en fonction du nombre de personnes convaincues. Ce mode de fonctionnement intégrant publicité, relations publiques et relation client illustre un système profondément commercial, loin d’un établissement de santé « classique ».

Figure 3 : Une jeune femme marche en observant la devanture luxueuse d’une clinique, à quelques mètres de la station Sinsa, Séoul, 06/10/2016, Marine Ganier
La « rue de la chirurgie esthétique d’Apgujŏng » (apkujŏng sŏnghyŏnggŏri), comme elle est parfois surnommée dans la presse coréenne, génère beaucoup plus de revenus que Sŏmyŏn à Pusan. Sur le terrain, on constate que le coût de la vie y est beaucoup plus cher6. Le coût des opérations chirurgicales y est aussi plus élevé qu’à Pusan. Pour les personnes enquêtées à Séoul comme à Pusan, plutôt jeunes, ce coût constitue généralement un investissement et s’est révélé un élément important lors du choix de recours ou non à la chirurgie esthétique. Il est parfois dissuasif et l’aspect symbolique de la chirurgie esthétique comme un signe extérieur de richesse semble encore bien présent, malgré la tendance à la banalisation. Les femmes sont les principales consommatrices dans ces quartiers. Ce sont aussi les plus nombreuses à recourir à des opérations de chirurgie esthétique, en grande majorité la chirurgie des paupières (blépharoplastie) mais l’ensemble du corps et du visage sont concernés, de la réduction de la taille des mollets aux implants capillaires en passant par la correction du menton (génioplastie), etc. Les interventions non-invasives (sans effraction de la peau) sont très populaires, telles que les traitements dermatologiques au laser et les injections de botox ou acide hyaluronique (en coréen p’illŏ, de l’anglais « filler »). Le ratio de clients hommes/femmes généralement avancé par les employé-e-s en entretien est de 90% de femmes contre seulement 10% d’hommes. Il en va de même pour les salons de beauté et de manucure. Pour autant, l’espace public dans ces quartiers ne semble pas de manière flagrante plus occupé par les femmes que par les hommes. Certains espaces demeurent même majoritairement masculins, comme c’est le cas de la petite place située au niveau du coin sud-est du Grand Magasin Lotte à Pusan où, au moyen de comptages, nous avons observé une proportion d’hommes largement supérieure (plus des trois quarts), ce qui traduit spatialement la réprobation du tabagisme chez les femmes qui persiste dans la société. Aussi, les hommes et les femmes n’ont ni la même approche, ni la même expérience vis-à-vis du recours à la chirurgie esthétique. Les interventions auxquels ils choisissent de recourir sont peu variées, majoritairement la rhinoplastie, la blépharoplastie et la greffe capillaire qui est une intervention typiquement masculine. Ils ont moins tendance à multiplier les opérations et visitent rarement plusieurs cliniques avant de prendre une décision, comme le font les femmes.
Une des caractéristiques communes à ces deux quartiers est la quasi omniprésence de sollicitations à la fois visuelles et auditives liées à l’industrie de la chirurgie esthétique ou de la beauté. La publicité extérieure est en effet très présente, sous des formes variées : affiches publicitaires, panneaux lumineux, flyers, annonces dans les transports en commun, etc. Celle-ci cible principalement les femmes (figure 4). Il est difficile pour les passants de ne pas remarquer les affiches publicitaires pour des cliniques de chirurgie esthétique qu’arborent les murs des stations de métro Sŏmyŏn et Apgujŏng (figure 4). Les arrêts de bus et l’intérieur des rames de métro sont aussi des lieux où l’on rencontre fréquemment ces publicités. Avec la proximité des instituts de soutien scolaire privés (hagwŏn) dans les deux quartiers, les plus jeunes sont très tôt confrontés à des publicités qui, d’ailleurs, les prennent parfois spécifiquement pour cibles au moyen de promotions spéciales. Ces publicités, où figurent en majorité des photos de femmes, véhiculent très souvent une vision stéréotypée, si ce n’est sexiste, des femmes. Elles semblent banaliser davantage la présence de l’industrie de la chirurgie esthétique dans le paysage urbain et renforcent l’injonction sociale à la beauté pour les filles et les femmes. Elles présentent la chirurgie esthétique de manière très positive, en remède miracle, occultant largement les risques et dérives qui mettent pourtant en danger les patient-e-s, ce que nous ont confirmé plusieurs témoignages de la part d’ancien-ne-s patient-e-s et employé-e-s que nous avons interviewé-e-s.
Il semble qu’à Séoul comme à Pusan, des efforts conjoints des cliniques et des pouvoirs publics visent au développement de l’industrie de la chirurgie esthétique (pour les premières par le marketing et les seconds par la dérèglementation et les efforts pour attirer des touristes étrangers). Ceux-ci se matérialisent dans l’espace public par la présence de fortes sollicitations qui ciblent principalement les femmes, par ailleurs principales consommatrices d’interventions à visée cosmétique.

Figure 5 : Une employée conseille une patiente dans la salle d’attente d’une clinique, Seomyeon Medical Street, Pusan, 22/09/2016, Marine Ganier
 Ganier Marine
Ganier MarineBoursière du RESCOR 2016
Cet article se trouve aussi dans les Ressources numériques de notre site
- Rapport de l’OCDE 2012 sur les inégalités de genre : http://www.oecd.org/gender/Closing%20the%20Gender%20Gap%20-%20Korea%20FINAL.pdf
- GELÉZEAU Valérie, « Les passions esthétiques sud-coréennes », Korea Analysis, n°3, juin 2014, p. 44-49.
- À Séoul le 18 octobre 1985 et à Pusan le 19 juillet 1985, avec la création de la ligne 1.
- Le grand magasin Hyundae ouvre à Séoul le 1er décembre 1985 et à Pusan le Lotte ouvre le 18 décembre 1995.
- http://www.smsmeditour.go.kr/kor/?menu=s3&menu2=2&menu3=1
- Pour exemple, un café americano coûtera 1000 wons dans un café à Sŏmyŏn contre 3000 wons à Apgujŏng.