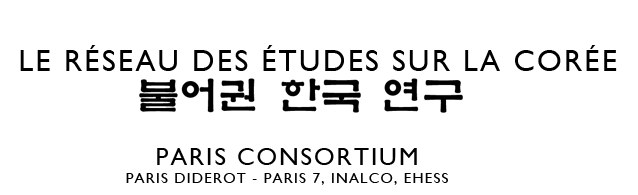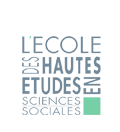« Y a-t-il une coréanité ? Influences, réceptions et inventions de l’art coréen »

Sous le thème de « coréanité » dans l’art coréen, la deuxième journée d’études du département d’études coréennes réunit le vendredi 4 mai 2018 à l’Auditorium de l’Inalco les spécialistes francophones en histoire de l’art coréen ainsi que plus de deux cents étudiants non seulement de l’Inalco mais aussi d’autres institutions de la France intéressés par cet art. Les participants sont Pierre Cambon (musée Guimet), Stéphanie Brouillet (Mobilier national), Kim Daeyeol (Département d’études coréennes, INALCO), Francis Macouin (ancien conservateur au musée Guimet), Maël Bellec (musée Cernuschi), Hwang Ju-Yeon (EHESS) et Okyang Chae-Duporge (Département d’études coréennes, INALCO) ; Comité scientifique Francis Macouin et Marc Orange (ancien directeur de l’institut d’études coréennes du Collège de France) et les discutantes Mme Leggeri-Bauer Estelle (Département d’études japonaises, INALCO) et Mme Riboud Pénélope (Département d’études chinoises, INALCO).
A 9h30, la journée commence par une introduction de Mme Okyang CHAE-DUPORGE, enseignante en Histoire de l’Art coréen à l’Inalco et organisatrice de cet événement, qui rappelle que cette journée a été organisée dans le but d’avoir un échange constructif entre chercheurs francophones en histoire de l’art pour envisager la réalisation d’un outil pédagogique, un livre de l’histoire de l’art coréen en français. Elle remercie le Conseil scientifique de l’INALCO qui a validé ce projet et qui a accepté de le cofinancer avec le soutien de RESCOR.

Elle laisse ensuite la parole à M. Marc ORANGE, ancien directeur de l’institut d’études coréennes du Collège de France, pour un mot d’ouverture. Après un rappel de son parcours qui ne le destinait pas à une carrière de coréanologue (études de droit et chinois), il finit par étudier le coréen avec Charles HAGUENAUER sous la direction duquel il s’intéressera à la littérature classique coréenne du 17ème et 18ème siècle. A l’époque, il y a peu de spécialistes de l’art coréen, on lui propose donc de donner un cours sur l’Art coréen à l’université Paris IV-Sorbonne. Selon M. ORANGE, évoquant de rares travaux, ce domaine est quelque peu négligé par les chercheurs. Pendant toute sa présentation, M. ORANGE a mis en avant le lien entre la Chine et la Corée tant au niveau historique, géographique, philosophique, littéraire et artistique. Il conclut donc qu’il est judicieux de s’initier à la langue chinoise pour aborder l’art coréen.

Le premier intervenant de cette journée est M. Pierre Cambon, conservateur du musée Guimet. Son propos porte sur « Chonsu gwaneum posal, Avalokitesvara à mille bras, de la peinture au bronze doré, la version coréenne d’un thème chinois ». Pierre CAMBON pose le problème de la datation des œuvres de l’art bouddhique en offrant une comparaison des peintures chinoises de Dunhuang avec les deux seules statues d’Avalokitesvara à mille bras en bronze doré coréennes de Koryô (10e – 14e siècle) ; la première conservée au musée Leeum (Samsung Museum of Art) à Séoul et la seconde, rapportée par Charles VARAT en 1888, au Musée Guimet à Paris. Par l’analyse de l’iconographie, il essaie de montrer les processus de traduction et de transfert de la thématique du bouddhisme ésotérique entre la Chine et la Corée. Il explique que les deux statues présentent des traits typiques des dynasties Tang (début de l’époque Koryô) et Yuan (fin de l’époque Koryô) mais qu’il est assez difficile de déterminer avec précision et assurance la datation de chacune des œuvres. La statue de Paris se rapprocherait du style plus réaliste et ancien des Tang, la plaçant au début de la période Koryô. Quant à celle de Séoul, plus stylisée, elle daterait de la fin de la période Koryô, voire début du Chosôn. Il conclut son intervention en mettant en avant que, malgré la difficulté d’apporter une datation claire, l’apogée de l’art bouddhique à Koryô se situerait au 13e siècle, après les invasions mongoles. Si les œuvres subissent des influences Yuan, elles suivent une tradition héritée des Tang avant de poursuivre progressivement vers une « coréanisation », comprise comme spécificité locale, de l’iconographie.

La discutante, historienne de l’art chinois, Mme Pénélope RIBOUD, insiste sur l’intérêt de cette approche méthodologique de datation qui consiste à situer chronologiquement une œuvre par comparaison à d’autres œuvres, déjà datées, et traitant la même iconographie. Pierre CAMBON explique que s’il existe des artefacts et de la documentation pour la Chine et le Japon, la Corée est, quant à elle, une « page blanche » où ce genre de support de datation n’existe pas, ou ne nous est pas parvenu. Elle l’interroge ensuite sur l’existence d’autres voies de circulation que celles via la région de Dunhuang ; elle fait notamment référence au sud-ouest de la Chine où il y a des figures similaires à celles des statues présentées. Il mentionne l’utilisation des voies maritimes en plus des voies terrestres. Une autre question porte sur l’affiliation des statues à des cultes particuliers et identifiés. À cela, Pierre CAMBON répond que s’il y a des spécificités locales, le bouddhisme ésotérique s’inscrit dans une mouvance transnationale se traduisant par une persistance des thèmes et de l’iconographie avec des traitements spécifiés au niveau local. La géographie est un élément important de la datation. Dans la question de la coréanité, il ne faut pas être piégé par l’isolationnisme, d’où l’importance de replacer la Corée dans son contexte géographique au moment du travail de datation.

La seconde intervention de la matinée est assurée par Stéphanie BROUILLET, inspectrice des collections au Mobilier National et ancienne conservatrice en charge des collections extra-européennes au musée national de la céramique de Sèvre. Elle nous parle des « Buncheong, témoins de l’inventivité des potiers coréens ». En effet, si les céladons ont été produits un peu partout en Asie, les Buncheong, céladons poudrés, n’ont été produits que pendant les deux premiers siècles du Chosôn en Corée. D’abord destinés à la cour, qui y appose le sceau de l’administration, partie intégrante du décor final, ils sont peu à peu supplantés par les céramiques blanches plus proche des valeurs néo-confucéennes de Chosôn. Les potiers, alors affranchis de la rigueur de la cour, se permettent plus de fantaisies dans les formes et les décors, laissant cours à plus de spontanéité, de vivacité et d’humour grâce au développement de différentes techniques. Les motifs de poisson et de vagues sont inédits ailleurs. Les irrégularités, les défauts (coulure, emprunte de feuille…) deviennent des motifs à part entière. Après l’invasion nippone au 16ème siècle, ces céramiques connaissent un grand succès au Japon où ont été envoyés des potiers. La rusticité et la sobriété de certaines pièces sont particulièrement prisées des maîtres du thé japonais qui les utilisent lors des cérémonies. Cet art du Buncheong donne lieu au mouvement Mishima qui en imite le style. Parallèlement, en Corée, la production des Buncheong est interrompue à la fin du 16ème siècle et tombe dans l’oubli jusqu’à après la libération de la péninsule coréenne en 1945. Lors de fouilles, d’anciens fours sont découverts et certains artistes s’attachent à retrouver les techniques, devenues biens culturels intangibles. Les artistes sont alors chargés de transmettre leur savoir-faire. Des potiers contemporains sont élevés au rang de trésor nationaux vivants, témoignant ainsi de la modernité des Buncheong.
En mentionnant la découverte de quelques tessons incrustés retrouvés en Chine, Mme CHAE-DUPORGE s’interroge sur l’origine de la technique des céladons incrustée étant connu largement comme une invention coréenne. Pour l’instant, il n’y a pas de plus amples informations sur le sujet mais elle affirme que c’était en Corée que cette technique a été largement diffusée. Elle s’interroge également sur le goût inhabituel des japonais au 15e et 16e siècle, d’habitude plutôt attirés par des objets plus élaborés et sophistiqués. Qu’est-ce qui explique l’engouement des japonais pour des objets plus rustiques et spontanés comme le Buncheong ? La discutante japonologue, Estelle LEGGERI-BAUER, répond qu’un article récemment paru explique que le changement de goût serait la conséquence d’un changement de regard, notamment des maitres du thé. La dernière question interroge l’importance de l’héritage chinois et des fours du nord de la Chine pour les céladons coréens. L’intervenante précise que même si les échanges de techniques entre potiers sont certainement passés par les fours du nord de la Chine, les Buncheong se sont développés au niveau local dans un climat difficile et instable au niveau politique et économique en Corée.

KIM Daeyeol, directeur du département d’études coréennes à l’INALCO, clôt la session du matin par le « portrait d’un amateur des objets à Séoul au 18ème », analysant une peinture de KIM Hong-Do avec un regard d’historien, et non d’historien d’art. Il utilise ce tableau pour montrer « l’esprit de l’époque » et l’attitude paradoxale d’une partie de la société de Chosôn : les gens du milieu. Le paradoxe évoqué ici décrit la frugalité des lettrés confucéens détachés de la mondanité par rapport à une certaine prodigalité et un attachement vis-à-vis des objets de collection. Dans la peinture de KIM Hong-Do montre un personnage, pieds nus, aux attributs de lettré sans poste (coiffe et vêtement), étonnamment entouré d’objets divers. Monsieur KIM explique que les livres, les plantes ou les antiquités sont des objets de contemplation pour les lettrés, et démontrent un certain raffinement et un refus des mondanités. Par ailleurs, un texte en caractères chinois vient prôner les valeurs néo-confucéennes. Cependant, KIM Hong-Do dépeint autour du personnage plusieurs objets venus de Chine et illustre ainsi la ferveur des gens de l’époque pour les collections. Ce paradoxe entre frugalité confucéenne et goût frénétique pour les collections est une conséquence du contexte socio-culturel de l’époque. En effet, le développement économique après les invasion mandchoues implique des changements dans la structure sociale où apparaissent des nouveaux riches et permet une certaine mobilité sociale. Le remplacement de la dynastie Ming par celle des Qing bouleverse les relations diplomatiques dans toute l’Asie. D’abord quelque peu hostile, les coréens poursuivent leur rapport tributaire avec les Qing et les relations s’apaisent, les échanges se stabilise et se développe comme jamais auparavant. La Corée importe plus d’œuvres et est mise en contact avec l’occident. Le développement de cette classe du milieu, dont KIM Hong-Do fait partie, relativement libre de l’idéologie d’Etat, est au cœur de cette nouvelle frénésie économique. Ils allient à la fois les anciennes vertus confucéennes avec ce goût immodéré et revendiqué pour les collections s’affirmant de plus en plus comme un nouveau capital culturel.

La discutante Mme RIBOUD remarque que cette peinture de KIM Hong-Do montre moins la collection, en faisant apparaître un unique objet par type, contrairement à une peinture, plus tardive, Chaekgado de bibliothèque rassemblant de nombreux objets de la même sorte. De plus, le tableau est complètement décontextualisé, la composition étant laissée sur fond blanc. La discutante s’interroge sur la coréanité de cette oeuvre. KIM Daeyeol répond que la coréanité résiderait dans ce paradoxe traduisant l’esprit de l’époque et les mutations socio-culturelles ayant cours au 18ème siècle. L’important n’étant pas tant ce qui est collectionné que le fait de collectionner des choses précieuses, critère d’identification à une certaine coréanité.

L’après-midi débute avec Francis MACOUIN, ancien conservateur au Musée Guimet, qui s’intéresse aux « portes à flèches rouges (hongsalmun) », un élément annexe dans les bâtiments de l’architecture coréenne du Chosôn. A la fin du Chosôn, le paysage était abondamment marqué par la présence de ces portiques, construction simple, composée de deux mâts verticaux reliés par deux traverses sur lesquelles étaient fixés des barreaux, et couverte d’un vernis rouge. Elles servaient à dignifier l’entrée d’un bâtiment ou marquer l’entrée d’un lieu sacré. Ce genre d’installation est assez commune en réalité et on peut en retrouver ailleurs dans le monde. En Chine, par exemple, il en existe des monumentales (en bois, en pierre, en brique ou en marbre) avec plusieurs arches et des toits. Au Japon, il y a une similarité notoire avec les torii, portiques qui marquent l’entrée des temples shintô (en bois ou en pierre), sur lesquelles on note l’absence de « flèches » (barreaudage). En Corée, ces portes ont souvent disparues au 20e siècle, celles à l’entrée des tombes des rois sont emblématiques. Le mot « hongsalmun » apparait pour la première fois au 17e siècle, auparavant il n’y avait mention que de « hongmun » (porte rouge). Dans divers livres illustrés montrant des hongmun ou chŏngmun qui était une distinction royale, Les barreaudages ne font leur apparition qu’au 18e siècle où l’on trouve une cohabitation des deux styles avec et sans « flèche ». Il faut attendre le 19e siècle pour ne plus avoir que des portes rouges à flèches. L’hypothèse qu’émet M. MACOUIN en guise de conclusion propose qu’avant le 17e siècle les portes n’avaient pas de flèches, et qu’ils se rapprochaient plus des torii japonais que des formes chinois. Il y aurait donc une évolution particulière de ces portiques en Corée à partir du17e siècle au plus tard.
Différentes questions sont posées sur l’architecture et l’utilisation de ces portes, telles que : l’emploi du mot hongsal (flèches rouges) qui est en fait un terme technique d’architecture auquel Francis MACOUIN préfère le mot barreaudage ; puis sur la possible dimension codifiée des portes qui dépendrait plus du contexte et s’adapterait à l’espace à occuper ; enfin, l’existence de portes éphémères qui semble difficile à prouver outre celles, connues, installées temporairement pendant la période des funérailles du souverain et retirées ensuite pour ne laisser que la porte principale face à la chapelle.

Mael BELLEC, conservateur du Musée Cernuschi, parle de la difficulté de définir la coréanité dans l’art parce qu’on joue ici sur des subtilités. Il rappelle que l’identité s’affirme moins en termes de similitudes que de différences. Pour tenter d’apporter une réponse à cette question, il choisit de comparer la Chine, le Japon et la Corée dans leur assimilation et leur traitement des modèles occidentaux. Avec l’arrivée au 16e siècle des premiers missionnaires, parmi lesquels Matteo RICCI, on assiste aux premiers contacts. En effet, les missionnaires se font accepter à la cour des Ming puis des Qing grâce à leurs qualités scientifiques plus qu’ecclésiastiques. Il s’opère alors un transfert de techniques, notamment artistiques, puis à une diffusion hors de la cour. Il prend l’exemple du traitement de la perspective à point focal unique. Chacun à leur manière, les trois pays produisent des illusions de perspective, comme le montrent trois exemples : une peinture chinoise structurée sur plusieurs lignes de fuite, une œuvre coréenne créant un effet d’optique en réduisant les lignes horizontales sans changer la dimension des personnages, et une œuvre japonaise dans laquelle sont employés deux points de fuite placés très proche l’un de l’autre pour créer la profondeur. Le vocabulaire artistique est similaire, le traitement est différent. Qu’est-ce qui peut expliquer ces divergences ? La manière dont ces vocabulaires ont été mis en contact est un élément de réponse : soit de manière direct par la rencontre et la formation des artistes à la cour comme en Chine et au Japon ; soit de manière indirecte via les émissaires envoyés à la cour de Chine par la Corée qui ramènent avec eux des objets. Cette diffusion est une conséquence d’un nouveau rapport au monde et au savoir plus pragmatique et naturaliste. Il remarque que la Corée ne cherche pas la cohérence dans le traitement de l’espace car elle préfère traduire la hiérarchie des personnages lors des cérémonies plutôt qu’une vision réaliste de la scène, exception faite des peintres de paysage qui, eux, cherchent la cohérence et le réalisme.
Une question de la salle interroge le fait que le regard sur l’art coréen, et l’art asiatique, est biaisé par notre regard occidental. M.BELLEC répond qu’on fait des choses que l’on comprend. En effet, s’il y a une continuité dans l’art des trois pays, c’est qu’ils partagent, du moins en partie, le même regard et le même vocabulaire. En guise d’exemple, il fait référence à la technique occidentale de l’ombrage déprécié dans les trois pays et qui vont chercher des techniques venues de l’art bouddhique pour faire apparaitre la profondeur et les reliefs au niveau des visages notamment. L’oeil est éduqué. Le souci des artistes est de faire passer dans un langage entendu par son public le message ou l’idée qu’il cherche à y mettre, d’où la nécessité d’un vocabulaire compréhensible et donc adapté au point de vue local. Cette adaptation crée les divergences et témoigne de l’identité propre à chaque pays. La définition de son identité a rarement été un problème aigu pour la Chine, contrairement à la Corée, et le Japon a créé son propre vocabulaire. Cela a pour conséquence une différenciation locale dans le traitement d’un vocabulaire partagé.

Ensuite, Mme. HWANG Juyeon retrace l’histoire et la pensée de KO Yu-Sǒp (1905 – 1944), «à la genése conceptuelle de la ‘beauté coréenne’». Né sous le protectorat japonais, il grandit et étudie pendant la colonisation japonaise. Il étudie à la faculté de lettre et de droit sous l’égide de professeurs japonais dès 1927, et obtient plus tard un poste de conservateur au musée préfectoral de Kaesǒng. Il est alors l’un des seuls coréens à occuper un poste dans une institution japonaise en Corée. Il a l’ambition de retracer l’histoire de l’art coréen de l’antiquité à 1910. Il écrit plus d’une centaine d’articles reprenant les idées sur l’esthétisme venues d’Allemagne. Il propose une définition conceptuelle de l’art des Trois Royaumes. Il tient une place particulière dans les théories d’histoire de l’art et de l’esthétique en Corée. Il est, en effet, le premier à donner une définition de la beauté coréenne en essayant, par une corrélation entre art et beauté, de définir ses valeurs et son sens en Corée. Il fait polémique entre les historiens d’art, d’un côté, qui voit dans sa pensée le biais du regard colonisateur japonais par lequel il a été formé et pour qui il travaille ; et de l’autre côté, les esthéticiens qui voit en lui la genèse de l’esthétique coréenne. Il a une conception phénoménologique hégélienne de l’art qui incarne la conscience et la valeur de la société. L’art est une émergence. Il n’est pas complètement séparé de la vie quotidienne d’un peuple qui vit en harmonie avec la nature. Influencé par les théories de son professeur, spécialiste de l’esthétique, UENO Naoteru, qui lui enseigne une vision de l’esthétique comme l’expérience phénoménale du beau différent de la perception sensible d’un objet pouvant être naturel ou artificiel. Le mot misul, qui signifie aujourd’hui l’art, désigne alors le produit humain qui exprime le beau, et mihak, l’étude du beau transcrit dans l’art. Dans sa conclusion, Madame HWANG explique, reprenant les idées de KO Yu-Sǒp, que la coréanité tiendrait dans la transcription dans l’objet d’art d’une objectivation sensible de la conscience et des valeurs esthétiques spécifiquement coréennes.

L’ultime intervenante de la journée, Mme. Okyang CHAE-DUPORGE, confronte la coréanité au prisme du mouvement artistique coréen Dansaekhwa (peinture monochrome coréenne) apparu dans les années soixante-dix. Dansaekhwa a longtemps été considéré comme le Minimalisme coréen et partage certains points communs avec celui-ci. Mais en réalité, il existe un grand écart stylistique entre l’art minimal et Dansaekhwa. Pendant cette période de modernisation sous la dictature de Park Jeonghee, les artistes s’acharnaient à trouver une expression moderne. Mais dans leur autocritique d’avoir suivi avec aveuglement l’art occidental (à l’époque synonyme de modernité), ils cherchaient également à marquer leur propre tradition dans l’œuvre, attitude encouragée par le gouvernement. Les artistes coréens ont essentiellement conçu cet espace pictural comme un lieu de pratique ascétique ou de méditation pour atteindre à la spiritualité. Chaque artiste trouve sa méthode bien spécifique : par exemple, Park Seo Bo traces des lignes continues au crayon, Ha Chong Hyun fait affleurer la peinture à travers les fibres depuis l’arrière de la toile, Kwon Young Woo presse, perce et déchire le Hanji (papier coréen), chung Sang Hwa répète collage et décollage, Chung Chang Sup applique du Tak, fibre du mûrier, Yun Hyong Keun et Kim Guiline jouent de la superposition des couches de peinture. Lee Ufan, qui était le théoricien du Monho-ha, mouvement artistique japonais de la fin des années soixante, a également participé à ce mouvement tout en résidant au Japon. Sa théorie a été décisive dans la formation de la vision de ce groupe. Pour lui, l’homme a eu tort de se mettre au centre du monde et de la création artistique. L’art doit être un lieu ouvert où advient la fraîche rencontre entre l’homme et le monde. L’artiste ne vise pas la fabrication d’une œuvre car l’intérêt ne réside pas dans l’objet lui-même, mais dans l’interaction entre l’homme et la toile, ou plus largement l’espace. C’est ainsi qu’on mesure l’importance du geste dans le Dansaekhwa dans les coups de pinceau ou les projections de couleurs sur la toile. Tout en respectant la planéité, ils réinventent cet espace plane comme un champ de rencontre entre le sujet et l’objet à travers leur action. Cette aspiration à éprouver l’unité avec le matériau est héritée d’une vision orientale du monde qui tend plutôt à amener les choses à se manifester qu’à les contrôler ou les manipuler. Dans les années quatre-vingt, le Dansaekhwa est attaqué par les représentants du mouvement Minjung sur le silence observé face à la dictature en Corée mais les artistes de Dansaekhwa se défendent en mettant en avant le fait que ce silence est justement leur manière de résister.

La journée se termine par une représentation de la pièce « Les quatre esquisses de l’amour » en coréen sur le thème comment définir l’amour ; mise en scène par HONG Sora, lectrice au département d’études coréennes à l’INALCO, et interprétée par une dizaine d’étudiants de première et deuxième année de LLCER Coréen.
Compte-rendu rédigé par Pauline Naillon
Photos prises par Emilie Nahas sauf les photos 1, 6, 13 prises par Doriane Svizerra
Toutes trois étudiantes de L1 dans le département d’études coréennes à l’INALCO.
Pour le Réseau des Études sur la Corée