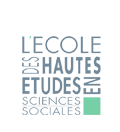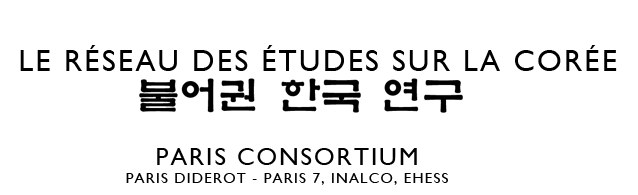Actualités
Actualités
Invitation à la rencontre-apéro organisée ce mardi, le 25 septembre, à partir de 18h30 aux Puf (60 rue Monsieur le Prince 75006 Paris), à l’occasion de la sortie de l’ouvrage collectif Une journée dans une vie. Une vie dans une journée. Des ascètes et des moines aujourd’hui coordonné par Adeline Herrou. Cet ouvrage comporte plusieurs chapitres concernant l’Asie et un sur la Corée.


Puf, août 2018, 440 pages.
Présentation de l’éditeur
Des ethnologues nous emmènent à la rencontre de moines et d’ascètes de différentes traditions religieuses et culturelles : des chrétiens, des bouddhistes, un lama tibétain, un yogi hindou, un jain, un fakir, un taoïste. À travers la description de leurs pratiques et de leurs préoccupations, ils explorent la condition de ces femmes et de ces hommes qui ont en commun de mener des expériences extrêmes afin d’atteindre les sphères les plus élevées de la connaissance et du sacré.
Marcher dans les pas de ces ascètes habituellement peu accessibles, voire secrets, nous permet d’accéder à une part de leur intimité et de leur histoire personnelle. En les suivant dans leurs activités journalières, cet ouvrage donne à comprendre les efforts faits pour percer les mystères de l’existence et devenir des êtres bons, tout en composant avec la trivialité du quotidien. Par là même, il nous interroge sur ce qu’est une journée dans nos existences : une juxtaposition de situations qui s’enchaînent souvent sans transition et qui procurent parfois ce sentiment d’avoir plusieurs vies, tout en restant une même personne. De ce fait, le tableau d’une journée dans une vie est aussi celui d’une vie dans une journée.
Contributeurs : Bénédicte Brac de La Perrière, Charles Ramble, Emma Aubin-Boltanski, Catherine Choron-Baix, Michel Boivin, Ji Zhe, Séverine Gabry-Thienpont, Véronique Bouillier, Ayako Itoh, Laurent Denizeau, Marie-Claude Mahias, Francesca Sbardella, Nicola Schneider, Florence Galmiche, Raphaël Voix, Adeline Herrou, Anna Poujeau

Géographie culturelle de la Corée. Introduction
Valérie Gelézeau, directrice d’études de l’EHESS
2e et 4e jeudis du mois de 10 h à 12 h, du 8 novembre 2018 au 23 mai 2019
Croisant le champ de la géographie avec celui des aires culturelles, ce séminaire prend la mesure de la nature fondamentalement plurielle de l’aire culturelle Corée, qui compte au total environ 80 millions de personnes, et que je qualifie de « méta-nation » : cohérente dans la longue durée, elle est aujourd’hui fragmentée en deux états (la Corée du Sud et la Corée du Nord), et une diaspora. Il entend surtout rompre avec le paradigme actuel des études coréennes en France et à l’étranger, qui produit une « schizo-coréanologie » focalisée sur l’étude de la Corée du Sud et peu consciente du fait que la plupart des faits sociaux et des perspectives pour les analyser sont en réalité formés, et informés, par le système de la division, donc polarisés soit au Nord soit au Sud. Il est donc impossible de se situer vaguement « en Corée » pour mettre en œuvre une recherche critique sur « la Corée » (terme qui, en coréen, est intraduisible sans situer explicitement et politiquement le discours au Nord ou au Sud).
Interrogeant l’espace comme construit social par des méthodes ethnographiques (une « micro-géograohie de terrain »), ce séminaire de géographie culturelle assume donc le caractère fondamentalement politisé de toute recherche critique sur la Corée et se définitn autant par des sujets à différentes échelles (la ville, les grands ensembles, la frontière) que par une posture située et engagée.
Le séminaire sera adossé cette année à une journée d’études sur la géographie coréenne qui aura lieu le jeudi 28 ou le vendredi 29 mars (date à préciser à la rentrée). La présence à la journée complète sera obligatoire pour la validation.
Histoire de la Corée moderne :
tempéraments historiens, modalités géographiques
Alain Delissen, directeur d’études de l’EHESS
Jeudi de 14 h à 16 h, du 8 novembre 2018 au 21 février 2019
Le séminaire s’attache à parcourir et interroger l’histoire bouleversée du monde coréen du XIXe au XXIe siècle, à partir de matériaux variés choisis à la marge de l’histoire établie et de ses genres canoniques. Il s’agit donc d’un séminaire de recherche portant sur l’histoire de la Corée moderne.
On part d’un constat : le travail des historiens coréens ne s’offre pas forcément sous la forme standardisée et refroidie de la monographie ou de l’article académique. En témoignent, dans les pages d’un journal et en feuilleton, les inflexions indignées d’un Sin Ch’aeho – père national fondateur de la discipline – en marge de la guerre russo-japonaise : pour des raisons de ton et de genre autant que de langue et de notions, il est difficile à saisir et traduire.
Au delà des catégories et lieux d’analyse usuels – nation, État, colonialisme, modernité ; genres et institutions historiques –, on s’efforcera aussi de saisir des tempéraments historiens. Quel est le sens produit par divers régimes d’écriture du passé « en mode charang (fierté) », « en mode kot’ong » (souffrance) », « en mode chŭlgŏum (plaisir) » ?
On tentera par ailleurs d’être sensible aux modalités géographiques marquées qui traversent la plupart de ces évocations historiennes du passé. Entre cartographie imaginaire et topographies savantes, villes dévastées et paysages rêvés, ils plantent un tableau inquiet des lieux du monde coréen moderne : place dans le monde, annexion, exil, division, destruction, instabilité…
Ont été travaillés les années précédentes, La Marche ferroviaire de Séoul à Pusan (Kyǒngbu ch’ǒltoga (norae)) de Yuktang Ch’oe Namsǒn – un texte de 1908 – ; les volumes que le poète contemporain Ko Un a consacrés dans Maninbo (Dix mille vies), en 2004, à la Guerre de Corée ; La figure de la « femme libre » (chayu puin) dans le cinéma sud-coréen des années 1950 et la série Webtoon (sur Naver) de Deniko des années 2010.
Histoire sociale contemporaine de la Corée
Marie-Orange Rivé-Lasan, maître de conférences à l’Université Paris-Diderot
dates et horaires communiqués ultérieurement
(Université Paris-Diderot, 5 rue Thomas-Mann 75013 Paris)
Analyse de textes et de vidéos de natures variées (articles scientifiques, documentaires historiques, archives, blogs, dossiers de presse, chronologies, cours en ligne, etc.) et d’origines différentes (sources coréennes et/ou occidentales) traitant de divers épisodes de l’histoire contemporaine de la péninsule coréenne, incluant la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il s’agira pendant le séminaire de confronter les différentes façons de concevoir et de formuler l’histoire contemporaine de la Corée en fonction des époques et des contextes de la production des discours coréens, asiatiques et/ou occidentaux, sur l’histoire.
En 2018-2019, le séminaire va porter sur l’histoire des anarchistes coréens et de l’anarchisme en Corée. En plus d’un rappel sur l’anarchisme du début du XXe siècle, on se posera la question de l’existence de mouvements anarchistes en Corée du Sud et sur les formes prises par l’anarchisme aujourd’hui chez les jeunes.
On insistera sur la description de parcours socio-politiques, de lieux de mémoires, de commémorations et sur l’écriture de l’histoire de l’anarchisme coréen en Corée du Sud et en Corée du Nord, et hors du territoire coréen.
Ce séminaire (code 44OE02KR ou 44RE02KR) dispensé au premier semestre à l’Université Paris-Diderot dans le cadre du master « études coréennes » est ouvert aux étudiants de M1 et M2.
Partitions territoriales : imaginaires et représentations
Anne Castaing, chargée de recherche au CNRS ( CEIAS )
Benjamin Joinau, maître de conférences à Hongik University (Séoul)
Delphine Robic-Diaz, maître de conférences à l’Université de Tours
2e et 4e vendredis du mois de 14 h à 17 h, du 11 janvier 2019 au 28 juin 2019
(salle A07_37, 54 bd Raspail 75006 Paris)
Le développement des Partition Studies dans différentes disciplines (histoire, sciences politiques, géographie, mais aussi histoire et anthropologie culturelles, études littéraires, études cinématographiques) invite à une réflexion globale sur les divisions territoriales et les effets, sociaux et culturels, des « longues » partitions, en Inde, mais aussi en Corée, au Viêt-Nam, dans l’ex-Yougoslavie, en Irlande, en Israël/Palestine, etc. Les importants travaux effectués en ce sens sur les productions culturelles permettent à la fois de tisser une histoire des « communautés imaginaires » que sont les nations, et de saisir le faisceau d’images et de représentations qui s’agrègent au territoire, à son morcellement ou, plus encore, à sa perte. En témoigne par exemple la volumineuse littérature « diasporique » ou « exilique », travaillée par un imaginaire de l’espace disparu, mais aussi les représentations genrées des nations partitionnées qui sillonnent leurs productions cinématographiques et littéraires, ou encore l’obsession des frontières qui caractérise les cinémas indien ou coréen. En dissociant leur réflexion des approches disciplinaires, les Partition Studies incitent à considérer les partitions comme « paradigmes » esthétiques (Anna Bernard), structurant en profondeur les imaginaires et leurs réseaux de représentation.
Ce séminaire vise ainsi à interroger les partitions et les divisions territoriales, récentes ou plus anciennes, d’un point de vue des représentations, comme témoin des assimilations imaginaires des ruptures communautaires et/ou nationales : littératures, cinémas, arts performatifs, arts plastiques seront les supports de nos réflexions.
Intelligences de la Corée. Séminaire pluridisciplinaire du Centre de recherches sur la Corée
Alain Delissen, directeur d’études de l’EHESS
Valérie Gelézeau, directrice d’études de l’EHESS
Isabelle Sancho, chargée de recherche au CNRS
2e et 4e vendredis du mois de 10 h à 12 h, du 9 novembre 2018 au 14 juin 2019
En mettant la recherche en perspective critique et historique, le but est d’introduire et de former aux disciplines, thèmes, auteurs, et problématiques des études coréennes telles que conçues et pratiquées par les sciences sociales et humaines.
Destiné aux mastérants et aux doctorants, le séminaire vise aussi à introduire à la variabilité de l’objet « Corée » ainsi qu’aux savoirs scientifiques situés qui les appréhendent.
Plusieurs types de séances seront donc proposés : 1) des séances de méthodes, de bibliographie et de documentation pour les études coréennes ; 2) des séances de discussion sur syllabus thématique ad hoc ; 3) des séances centrées sur les conférences des invités du CRC, dans des disciplines variées ; 4) des séances de travail presentant les travaux en cours tant des mastérants que des doctorants ; 5) des séances où les chercheurs confirmés présenteront leurs sources et l’état de leur recherche.
Dans le cadre du cycle de conférences – Professeur invité du Labex TransferS
« Les caractères d’imprimerie chinois en Asie orientale : Corée, Japon, Vietnam et royaume de Ryukyu »
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Les conférences se feront en présence d’un interprète du chinois vers le français


The Kyujanggak Institute for Korean Studies is the result of the merger in 2006 of the former Institute for Korean Studies and the Kyujanggak Archives. Kyujanggak itself has a history that can be traced back to 1776 when King Chŏngjo transformed Kyujanggak from a repository for the writings of kings into an academic research institute and incubator for young scholars. During his reign it functioned as one of the key political institutions, fostering scholars who would turn into officials loyal to him, and publishing and collecting books useful for his policies. After his demise, Kyujanggak retained only its function as a library and printing office. Following a brief revival under King Kojong, the Japanese abolished all royal institutions and transferred the collections to the Imperial University they had established in Seoul. At the end of the colonial period, all assets of the Imperial University were transferred to the newly established Seoul National University.
As for the Institute for Korean Studies, it had a long tradition as a venue for Korean Studies colloquia, symposia and other academic events on Korean Studies at Seoul National University. The merger with Kyujanggak was intended to further strengthen Korean Studies at Seoul National University, creating a platform that could not only bring together the university’s academic community regardless of their specialization, but also reach out to Korean Studies globally. Thus the valuable research materials held at Kyujanggak could be unlocked and made available for the global academic community; at the same time, by introducing new international perspectives, the Korean tradition and its modern transformations can be seen in a new light.
Practically, the Institute is organized into several sections, such as fundamental research, publications, education and outreach, and internationalization. The section in charge of internationalization, the International Center for Korean Studies, plays a vital role in linking various cultures and academic communities. Through its fellowship programs, it invites more than thirty students and scholars every year to carry out research in Kyujanggak. Through partnerships with various Korean Studies centers around the world, the Center also sends students, researchers and faculty from SNU for short or long term research visits across the globe. Furthermore the Center also organizes various academic events, including an annual symposium on Korean Studies, a “book talk” series in which overseas writers of books are invited to introduce their books to a Korean audience, as well as various other programs. The Center also publishes the Seoul Journal of Korean Studies, a biannual academic journal of Korean Studies.
Directeur du Centre International d’Études Coréennes (ICKS) à Kyujanggak

Collection Kalp’i – Études coréennes 3
de l’Institut d’études coréennes du Collège de France
Tél :01 43 26 00 37
Valérie Gelézeau, géographe, est directrice d’études à l’EHESS. Sur le terrain, à partir de l’expérience des habitants, elle questionne la société coréenne dans son rapport à l’espace. Elle a publié notamment Séoul, ville géante, cités radieuses (CNRS éditions 2003, aujourd’hui en OpenEdition), Séoul Mégapole (Autrement, 2011) et (avec Alain Delissen et Koen De Ceuster) Debordering Korea (Routledge, 2013). Elle a reçu en 2005 la médaille de bronze du CNRS (section Territoires, espaces sociétés) et été lauréate en 2008 du prix Culturel France-Corée.
Retrouvez Elisabeth Chabanol de l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO) pour une rencontre autour du livre « La Forteresse de Kaesong » publié par l’Atelier des Cahiers (2017) à la galerie librairie Impressions (17 rue Meslay Paris 3e) à 17h samedi 15 septembre. Elisabeth Chabanol, archéologue, nous parlera de son projet de fouilles archéologiques qu’elle mène depuis de nombreuses années en Corée du Nord (RPDC) et dont ce livre-catalogue dresse un premier bilan à travers une exposition qui a eu lieu à Pyongyang et Kaesong. Un témoignage unique à ne pas manquer !

CALL FOR APPLICATIONS FOR 9/2019-9/2020
DEADLINE: 15 SEPTEMBER 2018
The European Program for the Exchange of Lecturers (EPEL) is sponsored by the Korea Foundation. Every year AKSE draws up a comprehensive proposal and budget for future years. The AKSE proposal consists of proposals from individual universities. Lectures sponsored by this program should be an integral part of the curriculum of the institution where they are presented. The lecturers are reimbursed for their travel within European countries, accommodation expenses, and meals by the AKSE Treasurer, upon presentation of receipts, but lecturers are not paid a lecture fee. This program offers excellent opportunities for AKSE members to augment their institutional offerings and to meet and exchange ideas concerning both research and teaching.
Please send your proposal to the AKSE President by 15 September 2018. Your proposal must contain: the names of scholars, the titles of lectures, the dates of the lectures, a budget for transportation, hotel, and meals. All applications must be sent to the President of AKSE in Microsoft WORD. Lecturers will pay their own expenses and then request reimbursement by sending the correct form with receipts to the treasurer, Dr. Koen De Ceuster. All reports of lectures given have to be sent to the President of AKSE for report to the Korea Foundation. These reports are usually due in July of every year.
Further Guidelines for Applications to EPEL
Priority is given to applications from universities where there are few teaching staff. EPEL Guest Lecturers can assist teaching staff in replacing a limited number of teaching hours. EPEL lectures have to be a part of courses taught and not form a special seminar. The lectures have to offer academic credits or units and form a part of examinations. All applications must explain how these conditions are met. The AKSE President and Council will endeavour to secure adequate funding from the Korea Foundation to support EPEL applications, but the final funding decision resides with the Korea Foundation and only partial funding may finally be available to applicants. These circumstances are beyond the control of the AKSE President and Council. It is for these reasons that applicant universities are strongly encouraged to seek and secure alternative sources to support Guest Lecturers. Pour plus d’informations, voir le site de l’AKSE.

Nous voici déjà arrivés à mi-parcours du programme RESCOR 2 ! A cette occasion, nous avons déposé un bilan d’activité des membres du Réseau entre 2015 et 2018, et nous attendons le résultat d’évaluation de ce rapport.
Toute l’équipe est en train de préparer activement l’Atelier 2018 du RESCOR intitulé « L’essor des études coréennes : bilans et perspectives » qui se tiendra les 13 et 14 septembre prochain à l’Université Paris Diderot. Cet Atelier cherche à consolider les liens tissés lors de l’Atelier international 2015 du RESCOR et notamment à dresser un état des lieux des études coréennes en langue française, en réunissant les spécialistes des études coréennes francophones. En outre, la plupart des coréanologues en France ont contribué au Livre blanc des études coréennes qui sera présenté et remis au public lors de l’Atelier 2018.
Le RESCOR se réjouit des recrutements de quatre enseignants-chercheurs en études coréennes dans trois universités en France qui ont été achevés en mai et juin derniers : Kim Kyung-mi (Université Paris Diderot), Yun-Roger Soyoung (Université Paris Diderot), Chae Okyang (Université Bordeaux Montaigne) et Olivier Baiblé (Université Aix-en-Provence). Le dynamisme du Réseau et sa bonne visibilité permettent aussi d’envisager des possibilités de recrutement des enseignants-chercheurs en 2019.
Le RESCOR félicite également Valérie Gelézeau pour sa promotion en tant que directrice d’études à l’EHESS.
Enfin, le blog et le site du RESCOR comptent un nombre croissant d’utilisateurs et de nombreux comptes rendus ont été publiés au cours de ces trois derniers mois, ce dont nous nous réjouissons. Nous vous invitons également à aller voir nos interviews de coréanologues dont la dernière en date est celle de Sem Vermeersch, ainsi que de nouveaux matériaux pédagogiques, mis en ligne récemment sur notre site.
En espérant vous voir nombreux à l’Atelier 2018 du RESCOR en septembre prochain, toute l’équipe du Réseau vous souhaite un bel été !
CHOI Jiyoung.
Membre du Réseau des études sur la Corée
Maîtresse de conférences à l’INALCO
Télécharger le Bulletin n°19 du Réseau des études sur la Corée.
Pages