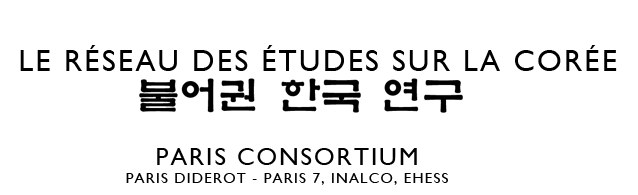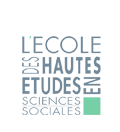La table-ronde, animée par Evelyne Cherel-Riquier (Université de La Rochelle), avait pour but de dresser le bilan et les perspectives de la coopération francophone tant dans la recherche que dans l’enseignement en études coréennes. Si elle a permis de souligner sans complaisance les manques et les limites que connaît le monde francophone des études coréennes faces au quasi-monopole des études anglophones, cette table-ronde a également démontré le dynamisme et l’ingéniosité mis en place pour faire vivre ces échanges.

Evelyne Cherel-Riquier (Université de La Rochelle). ©Le Réseau des Études sur la Corée
La première intervention était celle d’Assi Kimou (Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan) et s’est effectuée par Skype.

Interview par Skype entre Evelyne Cherel-Riquier(ULR), Assi Kimou et Hwang Hee-Young (Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan). Photo de fin de cours avec les étudiants ainsi que les professeurs Kimou et Hwang. ©Le Réseau des Études sur la Corée
Le programme commencé deux ans plus tôt à l’Université d’Abidjan par le professeur Hwang Hee-Young et lui-même a permis l’ouverture d’un Master en études coréennes composé de 15 étudiants formés par 5 enseignants-chercheurs permanents, 3 enseignants visiteurs volontaires et 2 professeurs invités. La collaboration internationale joue un rôle majeur dans le bon déroulement de ce master, à commencer par les échanges avec l’Université Paris-Diderot, en particulier les professeurs Yannick Bruneton et Kim Jin-Ok ; sans oublier l’Université d’Ajou – université sud-coréenne à vocation francophone – qui a permis de mettre en place des stages et des échanges universitaires pour les étudiants. Cependant, la filière est confrontée à des défis majeurs dans les domaines de la formation et de la recherche. Assi Kimou a d’abord souligné le manque d’enseignants de langue coréenne, assuré par deux bénévoles et sans professeur de niveau doctoral. Le système de bénévolat manque de pérennité et l’université est dépourvue de spécialiste en histoire moderne de la Corée. Ensuite, dans le domaine de la recherche, il a relevé le manque de coréanologues en Afrique de l’Ouest francophone. Dans cette situation, il est difficile d’offrir des perspectives aux cinq étudiants souhaitant poursuivre l’étude du coréen au-delà du Master. N’ayant fait du coréen que deux ans au lieu de cinq années par rapport aux étudiants des autres programmes d’études coréennes en France, il est complexe pour ces élèves de s’inscrire en doctorat, que ce soit par la voie de l’AKS (Academy of Korean Studies), du KGSP (Korean Government Scholarship Program) – dont les places sont limitées et qui donne la priorité aux ingénieurs – de l’université d’Ajou ou encore de Paris 7. L’avenir ne peut être envisagé que sous l’optique d’une coopération renforcée, via des signatures de conventions avec les institutions membres du RESCOR, l’AKS, le renforcement de l’échange des professeurs, des animations scientifiques (organisation d’une conférence internationale en Afrique de l’Ouest, co-direction de thèses etc.). En conclusion, Yannick Bruneton est intervenu pour proposer la solution du e-schooling, permettant de diversifier les enseignements. Assi Kimou a, par ailleurs, déclaré chercher à renforcer la coopération intra-africaine et il envisage la mise en place de cours de langue dès la licence dans le cursus langue et civilisation étrangère.
L’intervenante suivante était Elisabeth Chabanol, maître de conférences au bureau de Séoul de l’Ecole Française d’Extrême Orient (EFEO) ; centre créé en 2002 et qui dépend d’un seul enseignant-chercheur permanent.

Elisabeth Chabanol (EFEO). ©Le Réseau des Études sur la Corée
Le centre collabore, en outre, avec la Korea University depuis 2002 et les institutions nord-coréennes à Pyongyang depuis 2003. L’EFEO à Séoul accueille des étudiants en master 2, des doctorants et des post-doctorants, français, francophones mais aussi anglophones. Des échanges existent aussi entre les différents chercheurs et conservateurs de musées d’autres pays où l’EFEO est présent. En outre, depuis 2008, l’EFEO forme des historiens et archéologues nord-coréens en France et au Cambodge. C’est un programme qui fonctionne très bien et entre en résonance avec la mission archéologique à Kaesong lancée en 2003. En cela, le centre joue le rôle d’interface entre les chercheurs nord-coréens et le monde académique extérieur. A travers les publications du centre se pose la question de la francophonie dans la recherche. En effet, bien que l’EFEO s’efforce de garder une partie de ses publications en français, ses recherches sont également écrites en anglais, y compris par des chercheurs francophones, afin d’attirer l’attention du public sur ses avancées.
Le troisième intervenant, Stéphane Couralet, était présent en tant que représentant de la section coréenne de l’Université de Bordeaux Montaigne.

Stéphane Couralet (Université de Bordeaux Montaigne). ©Le Réseau des Études sur la Corée
Il a soulevé la question, relativement récente, du développement du réseau des études coréennes hors de Paris. Bien que la section ait ouverte en 2014, le coréen est enseigné depuis 1986 à tous les étudiants du campus bordelais qui le souhaitent, sous la forme de cours du soir. L’ouverture d’une formation de la Licence au Master doit interroger les formes que prend le développement des études coréennes aujourd’hui et leur intégration au réseau existant. La priorité pour la section de l’Université Bordeaux Montaigne est, actuellement, de développer ses coopérations en France et à l’international, afin de diversifier les échanges, non seulement en études coréennes, mais aussi dans les autres domaines de recherche. Ainsi, Stéphane Couralet insiste-t-il sur l’importance des enseignants-chercheurs situés à la périphérie de la recherche sur les études coréennes. A cette fin, l’Université Bordeaux Montaigne a développé un projet pédagogique d’échanges de professeurs spécialistes de la Corée1, qui bénéficie aux étudiants du domaine coréen, mais aussi de toutes les filières. Il s’agit également de répondre à l’inquiétude quant au caractère éphémère de la « vague » coréenne, qui empêche souvent les universités d’investir dans la filière. L’Université Bordeaux Montaigne, tout en étant active au sein du RESCOR, tient aussi à se distinguer des institutions parisiennes qui, longtemps, ont eu le monopole des études coréennes en France. Ainsi, collabore-t-elle avec l’Université de La Rochelle afin d’assurer un équilibre dans l’enseignement du coréen dans la région. Stéphane Couralet souligne que ce développement ne peut exister sans un soutien financier, par exemple celui de la Korea Fondation, obtenu en 2010 pour l’ouverture d’un DU à distance. En effet, la capacité d’enseignement en études coréennes de l’Université Bordeaux Montaigne est aujourd’hui dépassée, en témoignent les 700 dossiers de candidatures pour 40 places seulement proposées dans la filière LEA en licence. Cela a cependant permis de sélectionner avec soin des étudiants prêts à s’investir dans les études coréennes, et, créer, ainsi, une communauté d’élèves spécialistes de la Corée. Enfin, Stéphane Couralet insiste sur le fait que la coopération internationale repose sur ces étudiants français qui réalisent tout ou une partie de leur parcours académique en Corée et/ou y font carrière.
Suite à cette intervention Evelyne Cherel-Riquier est revenue sur la difficulté de convaincre les collègues non coréanologues de laisser des budgets pour créer des postes dans les études coréennes. Elle a, en outre, elle aussi, insisté sur le soutien important offert par des anciens collègues français partis en poste en Corée du Sud et qui sont le premier jalon du lien avec les universités coréennes.
Carl Young (University of Western Ontario) était le dernier intervenant de cette table ronde mais, n’ayant pu se déplacer, c’est Evelyne Cherel-Riquier qui s’est fait la voix de son intervention. A travers elle, il a appelé à « sortir de l’isolement et construire des nouvelles opportunités ».

Evelyne Cherel-Riquier présente le PPT de Carl Young (University of Western Ontario). ©Le Réseau des Études sur la Corée
Sa présentation commençait en soulignant la situation peu reluisante des études coréennes en Amérique francophone : au Québec, elles sont uniquement présentes à Montréal et seule l’Université McGill possède un programme plus développé, mais en anglais seulement. Carl Young a longuement insisté sur le monopole de l’anglais dans les études coréennes qui isole largement le maigre réseau francophone nord-américain. Faisant part de son expérience, il a mis en avant le rôle clef de l’AKSE ainsi que d’autres associations telles que l’EUKOPAC et le RESCOR dans l’organisation de rencontres entre collègues coréens et francophones et a tenu à relever le caractère crucial de ces conférences et colloques comme lieux d’échanges. Face à ce besoin, les obstacles sont le manque de moyens et la distance qui sépare les différents îlots d’études coréennes francophones. A noter également les différences dans les systèmes académiques et les attentes des personnels qui en découlent. Toutefois, même si la situation a beau être peu reluisante pour les études coréennes francophones en Amérique du Nord, la demande se fait de plus en plus pressante grâce à l’intérêt que suscite la culture populaire coréenne.Carl Young (University of Western Ontario), dernier intervenant de la table ronde, a appelé à « sortir de l’isolement et construire des nouvelles opportunités ».
En conclusion de cette table ronde, face aux difficultés des universités de province pour répondre à la demande toujours plus importante des bacheliers souhaitant entrer en études coréennes, les invités ont évoqué l’e-schooling. Evelyne Cherel-Riquier a néanmoins souligné qu’il ne peut en aucun cas remplacer le présentiel. Stéphane Couralet reconnaît ses limites, mais le considère comme une solution permettant d’élargir le champ des enseignements. Il a également souhaité coopérer avec Assi Kimou pour ouvrir la voie à une nouvelle coopération en études coréennes francophones entre les universités non-parisiennes et la Côte d’Ivoire.
Marion Delarche (RESCOR)