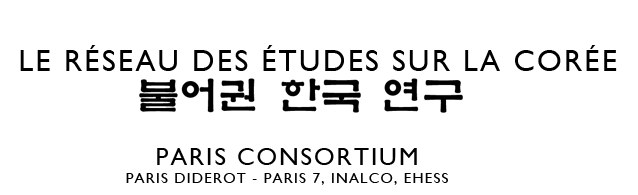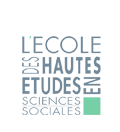Kim Dong-Choon, professeur de sociologie à l’université SungKongHoe (Séoul) et ancien membre de la commission « Paix et réconciliation », était l’invité de l’EHESS l’hiver dernier. Il a abordé la question de la démocratie en crise à l’occasion du séminaire de Sabina Loriga « Usages publics du passé ». Six questions ont servi de préambule à l’intervention de M. Kim :
- La démocratisation est-elle une garantie de démocratie ?
- Comment les mouvements prodémocratiques peuvent-ils conduire à une solide démocratie ?
- Comment les inégalités et le néo-libéralisme érodent-ils les fondements de la démocratie ?
- Les partis politiques peuvent-ils survivre au XXIème siècle ?
- Le capitalisme peut-il coexister avec la démocratie ?
- La démocratie est-elle une création de la culture occidentale ?
Elles composent le guide de réflexion que M. Kim a mise en pratique le 28 janvier dernier.
 Au cœur du système politique coréen, et ce depuis la colonisation, se trouve ce que Kim Dong-Choon qualifie de « war-politics » ou « politiques de guerre ». Il s’agit de l’intégration, dans tous les aspects politiques et sociaux du pays, d’un état de guerre caractérisé par une violence étatique, des coups d’État militaires, une surveillance généralisée et une doctrine anticommuniste. À travers des outils tels que la loi de sécurité nationale héritée du Japon, la répression cible l’ennemi intérieur, c’est-à-dire tout opposant politique.
Au cœur du système politique coréen, et ce depuis la colonisation, se trouve ce que Kim Dong-Choon qualifie de « war-politics » ou « politiques de guerre ». Il s’agit de l’intégration, dans tous les aspects politiques et sociaux du pays, d’un état de guerre caractérisé par une violence étatique, des coups d’État militaires, une surveillance généralisée et une doctrine anticommuniste. À travers des outils tels que la loi de sécurité nationale héritée du Japon, la répression cible l’ennemi intérieur, c’est-à-dire tout opposant politique.
Cependant en 1970 est entamé un lent processus qui en 1987 conduit à la mise en place du mandat présidentiel de cinq ans. M. Kim emprunte le terme développé par le théoricien italien Antonio Gramsci et parle d’une « révolution passive ». Les changements progressifs de la composition de l’Assemblée nationale ont permis l’entrée de nouveaux groupes, de nouveaux politiciens, qui ne modifient pas pour autant l’idéologie politique au cœur du régime. Cet immobilisme est compensé par la mobilisation de la société civile qui conduit à la démocratisation partielle du pays jusqu’en 1987. Les années 1986-1987 correspondent en Asie à un moment charnière de transition des régimes autoritaires vers des démocraties.
Comme c’est le cas après tout moment de démocratisation, plusieurs mouvements sociaux suivent la transition de 1987. La nouvelle élite de dirigeants politiques est formée d’anciens étudiants activistes. Pourtant les mouvements sociaux prodémocratiques n’aboutissent pas pleinement à la création d’un nouveau spectre politique. Le paysage politique est toujours largement limité à son aile droite, en conséquence de la division nationale et de la guerre froide. La war-politic, si elle a changé de visage, reste déterminante dans l’idéologie des partis. Et dix ans plus tard, l’année 1997 marque l’amorce du système néo-libéral capitaliste.
La crise du FMI est l’autre tournant majeur marquant le fondement de la Corée contemporaine. L’influence des chaebols est renforcée et limite les évolutions politiques. Il en va de même de l’influence et de la présence des E-U sur le sol coréen. Enfin, les anciennes élites politiques, issues de l’époque coloniale, restent soutenues par la bureaucratie économique qualifiée de mofia (Mosf étant le ministry of strategy and finance, associé au terme Mafia). Progressivement l’anticommunisme, au cœur du système des war-politics, devient synonyme d’individualisme dans un monde néo-libéral. Le soutien aux grandes entreprises annihile au passage la solidarité sociale. L’année 1997 marque l’avènement, selon M. Kim, du fondamentalisme de marché.
La question se pose alors, le néo-libéralisme est-il l’ennemi de la démocratie ?
Après 1997-1998, la densité d’union syndicale tombe de 20 % à 10 % en Corée du Sud en conséquence des réformes néo-libérales. Le rôle des syndicats dans le monde politique sud-coréen est limité au niveau de l’entreprise, et est dépolitisé. C’est un modèle hérité de celui que les États-Unis avaient imposé au Japon. Après 1998, la solidarité formée autour des mouvements de démocratisation a donc été rompue.
Pourtant en 2008 et 2016 les manifestations de masse, ou manifestation aux bougies (candlelight protests), semblent incarner la force de la démocratie sud-coréenne. En l’absence de violence policière, les citoyens ordinaires peuvent désormais prendre part aux rassemblements. Selon Kim Dong-Choon ce mouvement est tout autant le signe des manques du régime démocratique que de sa force. M. Kim souligne différents facteurs à l’origine de ces manifestations, notamment le manque de représentativité politique. Les deux partis majoritaires, tous deux issus de la droite, ne peuvent représenter l’intégralité des opinions politiques des citoyens. La haute centralisation du gouvernement ne permet pas non plus une grande représentativité. En Corée du Sud, ce sont les mouvements sociaux qui font avancer la démocratie. Ils forment la politique de la rue (street politics). Ainsi, remarque Kim Dong-Choon, si ces mouvements sociaux font de la Corée du Sud un pays hautement démocratique, ils expriment aussi le manque de représentativité, principale faille de sa démocratie.