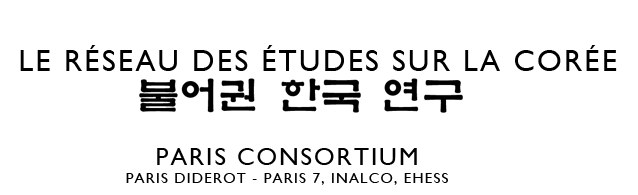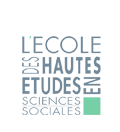Partie deux mois à Séoul pendant l’été 2018 grâce à une bourse du RESCOR, j’ai pu entreprendre, non sans appréhension, ma première enquête de terrain en anthropologie au sujet des tatouages en Corée du Sud. J’ai finalement concentré mes recherches à la ville de Séoul uniquement, car il était trop ambitieux de vouloir couvrir l’intégralité de la péninsule coréenne en si peu de temps. Afin de récolter un maximum de données, je me suis installée dans différents quartiers de la capitale : une semaine à Silim, puis trois semaines à Hongdae et enfin Myŏngdong. Ainsi, mon rapport rend compte du résultat de mes recherches de façon spatiale. Le but premier de ce terrain était de partir à la rencontre des tatoués, mais surtout des tatoueurs. Mon dernier voyage datant de 2016, c’est, dès mon arrivée, que j’ai pu constater une différence notable : l’augmentation des Séoulites arborant des tatouages, malgré l’interdiction des tatoueurs d’effectuer leur travail depuis 1992, suite au premier procès d’un tatoueur. L’article 27 de la loi des services médicaux (ŭiryobŏp) interdit aux tatoueurs de travailler en stipulant que seul un médecin reconnu est apte à pratiquer un acte médical. La loi coréenne définit, en effet, le tatouage comme un acte médical (ŭiryo haengwi) à cause du contact des aiguilles sur la peau (ce qui est aussi le cas de l’acupuncture).
J’ai d’abord séjourné dans la partie calme de Silim, près de l’Université Nationale de Séoul. J’en ai profité pour me remettre du décalage horaire en allant au tchimjilbang1 avec une Coréenne et commencer mes observations ethnographiques. J’y ai passé la nuit, et que ce soit dans les bains pour femmes ou dans la salle de repos mixte je n’ai rencontré aucune personne tatouée. Légèrement déçue, j’ai échangé avec mon accompagnatrice qui m’a alors indiqué qu’elle ignorait que l’acte de tatouer était illégal en Corée.
J’ai également eu l’occasion de faire une enquête par questionnaire que j’ai diffusée grâce à une amie et une tatoueuse. De cette enquête, j’ai récolté 163 témoignages de Coréens et Coréennes concernant l’aspect légal du tatouage. J’ai eu la chance d’avoir sept réponses de tatoueurs et tatoueuses, dont deux témoignages particulièrement pertinents : les deux tatoueurs travaillent tous deux à Séoul depuis 4 et 12 ans. Ils sont bien évidemment tatoués et ne le cachent pas à leur entourage. La première tatoueuse m’a expliqué la différence entre les termes munsin et t’at’u en précisant qu’ils signifient tous deux le mot « tatouage », mais que le premier est péjoratif, particulièrement pour l’ancienne génération tandis que l’utilisation du mot t’at’u est beaucoup plus neutre, voire positive. Les deux tatoueurs pensent qu’il n’est pas normal de devoir posséder une licence de médecin pour exercer légalement. Enfin, pour la tatoueuse, il est nécessaire qu’une législation soit faite pour que les tatoueurs et les clients soient protégés et tatoués dans de meilleures conditions. Quant au tatoueur, il ajoute que la situation actuelle s’explique par l’entêtement des médecins et du lobby médical. En effet, il existe dans les départements de dermatologie des hôpitaux coréens des dermatologues spécialistes du tatouage, ce qui rapporte beaucoup d’argent aux hôpitaux pour des actes médicaux peu risqués. Or, si le tatouage est légalisé, ils perdront cette mainmise sur la chirurgie esthétique du tatouage. Ces témoignages recueillis m’ont, ainsi, particulièrement aidé dans la compréhension de mon sujet d’étude.
J’ai très vite déménagé à Hongdae et eu l’occasion d’assister à une séance de tatouage où une amie m’avait convié dans un salon au troisième étage d’un immeuble à côté d’un café. L’entrée était surveillée, une caméra était disposée devant la porte. Nous avons dû sonner puis attendre qu’un tatoueur nous ouvre. L’endroit était gardé secret, rien ne laissait deviner qu’il s’agissait d’un salon de tatouage et le bruit si propre aux aiguilles grattant la peau était inaudible en dehors de l’appartement et de l’immeuble. Ce salon regroupait plusieurs artistes. Tout était parfaitement réalisé, rien ne dérogeait aux règles d’hygiènes que j’ai pu observer en France ou dans un autre salon à Séoul : le matériel était stérile, la tatoueuse portait des gants et chaque instrument était pourvu d’une protection plastique à usage unique. La salle où je fis mes observations n’était pas privée : en plus de la tatoueuse et de mon amie, il y avait une autre cliente accompagnée de sa tatoueuse et certaines personnes qui allaient et venaient pour observer l’avancement des tatouages.

© Nastassja Dumontet-Demarcy
J’ai profité de mes nombreuses journées à Hongdae pour étudier la journée et sortir la nuit afin d’observer dans les rues les personnes tatouées. Certaines nuits, je pouvais croiser plus de soixante individus tatoués. J’ai pu interroger certaines de ces personnes, dont un homme d’une trentaine d’années qui portait de nombreux tatouages sur les bras et les jambes. Il m’a indiqué que toutes ses pièces avaient été faites à Séoul entre Hongdae et Itaewon, car l’un de ses amis est tatoueur. J’ai demandé si ses parents étaient au courant et il m’a répondu que son père approuvait ses choix. Enfin il m’a affirmé qu’il s’est fait tatouer la première fois dans le but d’assouvir une curiosité qui s’est finalement transformée en addiction. Curieux, il nous a également demandé si, en Europe, les hommes tatoués étaient considérés comme virils.
Cette dernière phrase montre bien la dimension culturelle et de genre que comporte le tatouage. J’ai également rencontré une amie tatoueuse qui m’a affirmé que si la situation des tatoueurs coréens ne s’améliorait pas, elle essaierait de partir à Paris où elle pourrait exercer son métier en toute légalité. Toutefois, en traversant Hongdae, j’ai noté l’existence de salons de tatouages dont les enseignes et les devantures n’étaient pas cachées.
C’est à mon arrivée à Myŏngdong, que j’ai pu observer plusieurs stands de rue vendant des prestations de tatouages éphémères et de nombreux piercings. La vie nocturne étant presque aussi mouvementée qu’à Hongdae, j’y ai croisé un nombre important de personnes tatouées. J’ai également interviewé une étudiante tatouée, qui m’a aidé dans ma réflexion sur le tatouage en Corée : elle a 28 ans et étudie dans une université conservatrice. Elle m’a expliqué qu’elle ne pouvait pas montrer où parler de son tatouage (qui est à l’intérieur du bras). Elle m’a également précisé qu’elle savait que l’acte de tatouer était illégal seulement depuis une ou deux années. Elle compte continuer de se faire tatouer sans le dire à ses parents. Cependant, ses ami.e.s et son frère le savent et l’encouragent grandement. De plus, elle a découvert sa tatoueuse (Zihee) sur Twitter, ce qui montre que les différents réseaux sociaux sont utilisés par les tatoueurs pour faire la promotion de leur travail.
Enfin, j’ai fait de nombreuses observations à Itaewon, où la concentration de salons de tatouage est dense, notamment près de la Mosquée centrale de Séoul.

© Nastassja Dumontet-Demarcy
Malgré de nombreux problèmes, dont la perte de données conséquentes due à un problème informatique, beaucoup d’absences de réponses et des annulations de dernières minutes, j’ai pu collecter des données essentielles à la bonne réalisation de mon mémoire de seconde année.
Je tiens encore une fois à remercier le RESCOR de m’avoir octroyé cette bourse.
 Nastassja Dumontet-Demarcy
Nastassja Dumontet-Demarcy
- Sauna coréen, composé de bains et de salles de repos mixtes ou non mixtes