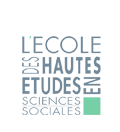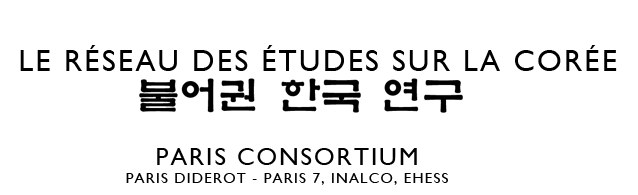Littérature Coréenne – Le numéro 39 de la web-revue Keulmadang vient de paraître.
Vous pouvez le consulter en ligne en cliquant ICI.
Actualités
Actualités
Appel à contribution pour le Séminaire « Villes Asiatiques » :
« Les nouveaux espaces partagés en Asie : l’évolution des formes et des pratiques face à la modernisation»
Organisateur : DSA Architecture et projet urbain (ENSA Paris-Belleville), en collaboration avec l’IPRAUS
Date d’échéance pour l’envoi des résumés (max. 300 mots) : 10 décembre 2016
Notification d’acceptation : 15 décembre 2016
Pour l’envoi des résumés, et pour toute question et demande d’information : Yang LIU (enseignante à l’ENSAPB, chercheuse associée à l’IPRAUS) liuspoon7@gmail.com
Lieu du séminaire : Salle 12, ENSA Paris Belleville, 60 bd de la Villette, 75019 Paris
Date du séminaire : 03 février 2017, 9h00 – 18h00
Le Séminaire « Villes Asiatiques » a lieu chaque année dans le cadre du DSA « Architecture et projet urbain» de l’ENSA Paris-Belleville. Il est organisé en lien avec le laboratoire IPRAUS et l’UMR AUSSER, dont l’un des principaux axes de recherche porte sur les villes asiatiques. Il offre une occasion de découvrir, comprendre, questionner les enjeux émergents dans cette région du monde, d’échanger entre étudiants, enseignants, chercheurs et praticiens, et de présenter de manière actualisée les spécificités et évolutions urbaines d’un territoire de manière à actualiser les spécificités des trajectoires urbaines des métropoles asiatiques.[1]
Le thème du séminaire de 2017 porte sur les « espaces partagés » en Asie, thème que nous préférons aux « espaces publics » et « espaces ouverts ».[2] Le langage peut-être en effet considéré comme un phénomène social à travers lequel nous interprétons les pensées d’une civilisation et d’une culture.[3] Le problème du choix des vocabulaires n’est pas seulement sémantique, mais bien lié aux particularités des espaces urbaines asiatiques.
Ainsi, le concept d’espace public est-il né dans le contexte urbain des villes européennes. Or cette notion est quelque chose de vraiment nouveau en Asie. Et ce n’est que très récemment que ces espaces se sont ouverts à une large palette d’activités spontanées et non programmées.[4] Les statuts « publics » ou « privés » ne concernent pas la totalité des espaces urbains asiatiques. L’existence des « espaces tampons » ou « espaces transitions » rend cette classification plus complexe. Pourtant, cette subtilité est une grande richesse[5] dans les villes asiatiques. Nous trouvons à Shanghai les espaces semi-privés des parties communes des Lilong à Shanghai, ou bien à Hanoï, les espaces semi-publics à l’interface de l’espace privé du compartiment et de la chaussée[6]. Ces espaces nuancés sont hiérarchisés de façon à ce que « de l’appartement à la grande avenue, on traverse dix ou quinze types d’espaces ». [7]
Nous ne préférons pas non plus le terme d’« espace ouvert » à celui d’espace public, celui-ci signifiant les espaces non-bâtis, et se référençant souvent aux formes les plus courantes des espaces urbains civils européens, c’est-à-dire les parcs, jardins et places. Or les espaces publics les plus anciens en Asie sont des espaces « couverts » ou « semi-couverts » – les temples et les marchés. Cette particularité historique des espaces publics asiatiques est en train de reprendre son importance aujourd’hui, comme le montre le développement croissant des centres commerciaux.
C’est pour cet ensemble de raisons que nous avons choisi le thème de « l’espace partagé », notion qui couvre plusieurs types d’espaces, qu’ils soient publics ou privés, ouverts ou couverts.
« L’espace partagé » est une conception contextuelle : il s’agit de préciser dans quelle délimitation physique (forme), par qui (l’usager) et comment (la pratique) l’espace est partagé. Au-delà de ces différents facteurs s’ajoute aussi la dimension temporelle. Les villes asiatiques « connaissent de profondes mutations liées à leur insertion accélérée dans les circuits de la globalisation. »[8] Les espaces partagés en Asie évoluent au cours du temps et reflètent les mutations urbaines et sociales. Nous partons donc de l’hypothèse que, si cette modernisation a profondément modifié la mode de vie de la population en Asie, alors les espaces partagés subissent une mutation similaire.
Ce séminaire vise à ouvrir des pistes d’investigations sur les nouvelles formes et pratiques mais aussi les nouveaux usagers des villes asiatiques en pleine mutation. Quels sont les nouveaux types d’espaces partagés ? A-t-on de nouveaux usages ou de nouveaux usagers qui émergent des pratiques de ces espaces partagés ? Dans quelle mesure la fonction de ces espaces répond-elle à une demande sociale ? Quelle est l’architecture de ces nouveaux espaces et de quels projets font-ils l’objet ?
[1] ENSA Paris-Belleville, plaquette DSA “Architecture et projets urbains”, 2016.
[2] Il s’inscrit aussi dans la réflexion engagée dans le cadre du séminaire organisé par l’axe « Architecture des territoires » de l’UMR AUSser sur le thème de l’espace ouvert. Deux séances auront lieu en novembre 2016 et 2017.
[3] Présentation de l’UMR AUSser, p39.
[4] Gaubatz Piper, Bardon Séverine. Les nouveaux espaces publics en Chine urbaine. In : Perspectives chinoises, n°105, 2008. Pp.78-90.
[5]Les nouvelles trames de l’espace chinois : compagnes, villes et métropolisation (entretien avec Pierre Clément dans la table ronde organisé par Thierry Sanjuan), In : Urbanité [en ligne], 2013. http://www.revue-urbanites.fr (consulté septembre 2016)
[6] Gibert Marie, Les espaces publics urbains vietnamiens face à la « modernité » HoChiMinh Ville : résistance et réinvention de la culture de rue, conférence internationale « architecture des villes d’Asie du Sud-Est : vers des expressions de la modernité en rapport avec des héritages ? », 2013
[7] Les nouvelles trames de l’espace chinois : compagnes, villes et métropolisation (entretien avec Pierre Clément dans la table ronde organisé par Thierry Sanjuan), In : Urbanité [en ligne], 2013. http://www.revue-urbanites.fr (consulté septembre 2016)
[8] Gibert Marie, op.cit., 2013
L’École française d’Extrême-Orient (EFEO) propose cet automne deux programmes de contrats postdoctoraux :

Ø La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’EFEO proposent des contrats de mobilité d’un montant mensuel de 1500 euros net, d’une durée de 3 à 6 mois, permettant à des post-doctorants affiliés à une institution française d’effectuer un séjour d’étude en Asie dans les Centres de l’EFEO. Seront soutenus des projets de recherche en sciences humaines ou sociales relatives aux civilisations des pays d’Asie. Les projets interdisciplinaires sont bienvenus. Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité post-doctorale de courte durée lancé par la FMSH et ses partenaires.
Durée de la mobilité : 3 à 6 mois
Prochaine date limite de candidature : jeudi 10 novembre 2016
Période du séjour : Entre janvier et décembre 2017
Nombre de mois-chercheurs disponibles pour cet appel : 12 mois
Critères d’éligibilité :
- Le candidat doit être titulaire d’un doctorat en sciences humaines et sociales et peut soumettre une candidature au maximum 6 ans après la date de soutenance de la thèse
- Le candidat doit être associé à une institution de recherche en SHS française
- Le candidat doit être ressortissant de l’Espace économique européen ou de la confédération Suisse et titulaire d’un compte bancaire en France à la date de l’établissement du contrat de travail
- Le candidat doit travailler sur un sujet nécessitant un séjour sur le terrain rattaché à l’un des Centres de l’EFEO
- Le candidat doit avoir une connaissance des langues correspondant aux recherches de terrain envisagées
Les candidatures sont déposées en ligne sur le site de la FMSH avant le 10 novembre 2016.
Voir : http://www.efeo.fr/base.php?code=636
![]() Ø L’École française d’Extrême-Orient a réservé une part de son budget 2017 à l’attribution de contrats postdoctoraux de courte durée (entre 4 et 6 mois). Seront soutenus des projets de recherche en sciences humaines ou sociales relatives aux civilisations des pays d’Asie. Les projets interdisciplinaires et/ou associant des centres et chercheurs de l’École française d’Extrême-Orient sont bienvenus. La mobilité n’est pas impérative.
Ø L’École française d’Extrême-Orient a réservé une part de son budget 2017 à l’attribution de contrats postdoctoraux de courte durée (entre 4 et 6 mois). Seront soutenus des projets de recherche en sciences humaines ou sociales relatives aux civilisations des pays d’Asie. Les projets interdisciplinaires et/ou associant des centres et chercheurs de l’École française d’Extrême-Orient sont bienvenus. La mobilité n’est pas impérative.
Montant de la rémunération mensuelle : 1500 euros net
Prochaine date limite de candidature : 10 novembre 2016
Période du contrat : entre janvier et décembre 2017
Nombre de mois-chercheurs disponibles pour cet appel : 21 mois
Critères d’éligibilité :
- Le candidat doit être titulaire d’un doctorat en sciences humaines et sociales et peut soumettre une candidature au maximum 6 ans après la date de soutenance de la thèse
- Le candidat doit être associé à une institution de recherche en SHS française
- Le candidat doit être ressortissant de l’Espace économique européen ou de la confédération Suisse et titulaire d’un compte bancaire en France à la date de l’établissement du contrat de travail
- Le candidat doit avoir une connaissance des langues correspondant aux recherches de terrain envisagées
- Le contrat de postdoctorant n’est pas compatible avec le statut de salarié
Les candidatures sont adressées à l’EFEO avant le 10 novembre 2016.
Voir : http://www.efeo.fr/base.php?code=861
Le fonds de ressources numériques du Réseau des études sur la Corée dispose de plus de 560 documents qui sont en accès libre (après inscription) sur son site Web. Le blog fait régulièrement un focus sur un chercheur membre du Réseau. Nous vous présentons aujourd’hui les publications d’Alain DELISSEN, historien et directeur d’études à l’EHESS, qui sont accessible dans ce fonds.
– « Carrefour historique, carrefours historiographiques : les nouveaux passés de la Corée du sud », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 88, octobre-décembre 2007, pp. 20-25.
– « La nouvelle bataille des Falaises rouges ? À propos du manuel commun Chine ? Corée ? Japon », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 94, avril-juin 2007, pp. 57-71.
– « Le retour des Ilche Chanjae/Nittei zanshi (relief de l’impérialisme japonais) en Corée du sud : de l’historiographie nationaliste à l’histoire citoyenne », Ebisu, n° 17, 1998, pp. 49-64.
– « Démocratie et nationalisme : le moment minjung dans la Corée du Sud des années 1980 », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 45, 1997, pp. 35-40.
– « Kyǒngsǒng chut’aek munje : Crise de la maison coréenne ou crise du logement colonial dans le Séoul des années 20 et 30 ? », Revue de Corée, vol. 29, n° 2, 31 décembre 1997, pp. 197-229.
– « Face à Séoul, les trente glorieuses de l’architecte Kim Su-gŭn », Revue de Corée, vol. 28, n°1, 30 juin 1996, pp. 34-59.
– « Kim et Tanaka, techniciens dans la Corée des années 1930, Modernisation et division coloniale du travail », Le mouvement social, n° 173, octobre-décembre 1995, pp. 97-111.
Pages