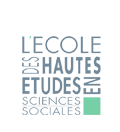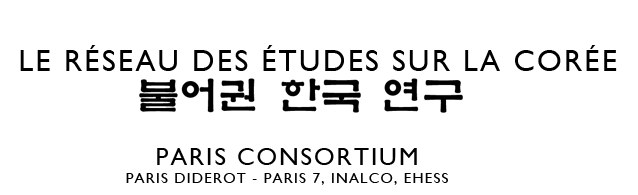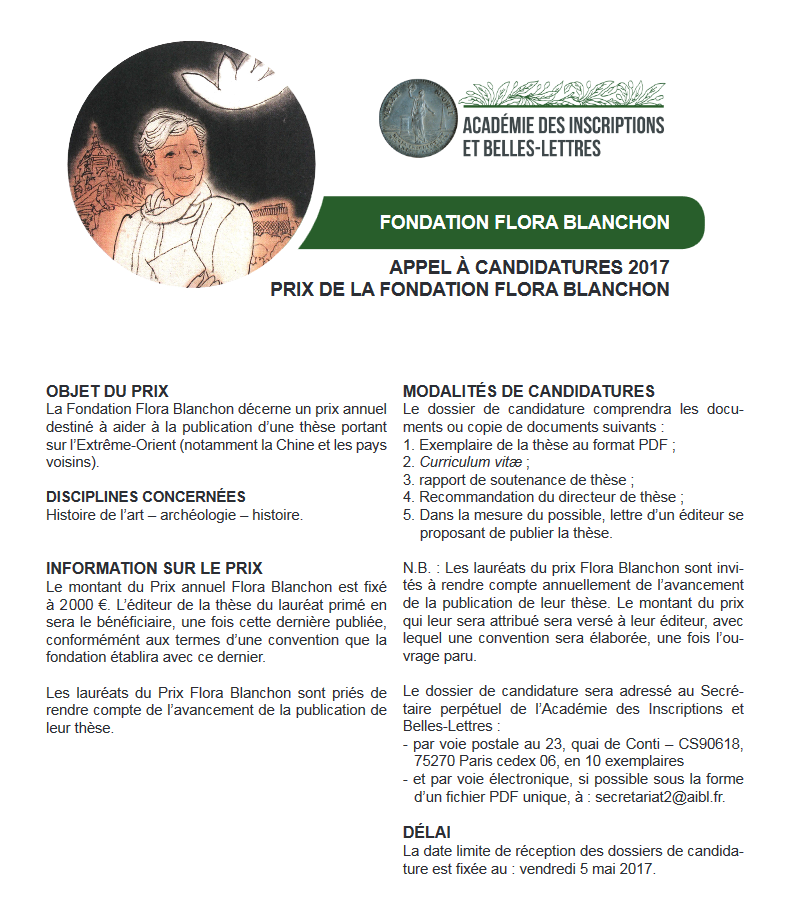Actualités
Actualités
Dans le cadre du séminaire Techniques, objets et patrimoine culturel immatériel en Asie Orientale (XVIe-XXIe siècle)
Seok-Kyeong HONG-MERCIER
(Université nationale de Séoul)
présente une conférence intitulée
« La question de la nouvelle masculinité et du métissage dans la Culture K Pop »
Jeudi 26 janvier 2017 de 11h00 à 13h00
EHESS
190 avenue de France 75013 Paris
Résumé
La Culture K-pop a sa singularité : le fandom étant majoritairement féminin, l’industrie culturelle répond au désir du public, en produisant des célébrités masculines ayant l’identité peu commune en Occident. Cette conférence analyse la dimension genrée du phénomène et son intersectionalité avec la question de la race, qui mènera la réflexion vers la question de l’identité asiatique dans le monde.
Source : EHESS
 « Empreintes du tantrisme en Chine et en Asie orientale : Imiginaires, rituels, influences »
« Empreintes du tantrisme en Chine et en Asie orientale : Imiginaires, rituels, influences »
Textes rassemblés et présentés par Vincent Durand-Dastès
Peeters, décembre 2016, 380 pages
Ce volume collectif se propose, à travers ses huit chapitres, de contribuer à délimiter un «domaine tantrique» dans le paysage religieux de la Chine et de ses voisins. Si le bouddhisme ésotérique est au cœur de son propos, on y aborde aussi des pratiques et des représentations qui s’en inspirent en s’en distinguant, qu’elles soient rattachables au taoïsme, au shinto ou témoignent d’une présence plus diffuse au sein de la culture populaire d’Asie orientale.
La première section, Imaginaires, se demande dans quelle mesure un «aspect tantrique» des divinités fut adopté par les peintures liturgiques servant à accompagner un important rituel commun au bouddhisme et au taoïsme, comment les romans en langue vulgaire des XVIe et XVIIe siècles s’inspirèrent des divinités indiennes représentées dans des poses lascives ou furieuses pour construire certaines figures de héros, ou comment le personnage du très populaire dieu-enfant Nezha fut façonné au fil des siècles grâce à l’importation progressive de mythes indiens par le truchement de textes du bouddhisme ésotérique.
La section Rituels explique d’abord comment une efficace prière sanscrite en vint à occuper une place de choix dans la vie religieuse des Chinois du XIe siècle, puis retrace la carrière chinoise d’une œuvre du bouddhisme ésotérique indien, le Chant des noms de Manjusri, avant d’aborder l’usage des musdra par les maîtres de rituels taoïstes de la Chine du Sud-Est.
La partie Contrepoints montre comment, au Japon, une école prétendument «ésotérique» put finir par compter plus de dix million d’adeptes et son imaginaire comme ses pratiques influer sur les secteurs les plus divers de la société, puis décrit comment en Corée, l’État impérial s’employa à construire et promouvoir des lignées de bonzes spécialisés dans les rituels divinatoires d’inspiration tantrique. L’ouvrage se clôt par un bref essai bibliographique sur les développements récents des études tantriques en contexte chinois.
Ce volume a pour modeste ambition d’apporter aux études sur le bouddhisme ésotérique la contribution de spécialistes de domaines très variés, mais extérieurs au domaine de la pure bouddhologie.
Il rassemble des textes de Brigitte Baptandier, Ester Bianchi, Yannick Bruneton, Vincent Durand-Dastès, Caroline Gyss, Lui Hong, François Macé et Meir Shahar.
 « Le bouddhisme coréen »
« Le bouddhisme coréen »
Rédaction par Vénérable Beopgwang et al.
Traduction par Yannick Bruneton
Relecture par Hyeon Ju Kim
Fondation pour la Culture Bouddhique Coréenne, octobre 2016, 356 pages
Alors que le bouddhisme coréen reste peu connu du grand public francophone pour avoir été traité de manière succincte dans la plupart des ouvrages généralistes sur le bouddhisme, la publication d’une présentation d’ensemble du bouddhisme de Corée du Sud vient opportunément combler un vide trop longtemps entretenu. La lecture de ce livre publié par l’Association des ordres bouddhiques sud-coréens suffit à confirmer combien injustifié fut un tel traitement. Car le bouddhisme coréen recèle, en plus d’une histoire remarquable par sa longévité, un patrimoine matériel et spirituel exceptionnels en Asie orientale. Ainsi, pour la première fois est proposée au public francophone un panorama vivant du bouddhisme de ce pays, abordé dans ses dimensions sociale, culturelle et historique. En des termes simples et abordables, cette présentation se veut avant tout une invitation à la rencontre avec une tradition religieuse demeurée dominante en Corée du Sud.
La relation directe avec le bouddhisme coréen est désormais possible en raison d’un village planétaire devenu étroit, mais aussi parce que, cette forme de bouddhisme connaît une ouverture et une extension internationale sans précédent. Par la pratique du Temple Stay, inaugurée il y a une vingtaine d’années, de grands monastères de l’ordre de Jogye, parmi les plus prestigieux et anciens, ont ouvert leurs portes à un large public. Le présent ouvrage est en partie le produit de cette expérience et du dialogue entre les religieux et un public divers, plurireligieux, national et international. Elle est aussi une clé pour comprendre comment, dans la Corée d’aujourd’hui, peut coexister autant de courants religieux et d’écoles de pensées. Le secret de la longévité et de la bonne santé du bouddhisme sur cette terre de Corée réside sans doute dans les tendances structurantes qui le caractérisent : pluralisme et décloisonnement, penchant pour la synthèse, rôle de protection de l’État, adhésion indéfectible et passionnée à la pratique du Sŏn. De même que les monastères bouddhiques de montagne font partie du paysage coréen, la culture du Sŏn et son style de vie, dans sa radicale simplicité, demeure profondément ancrée dans la culture de ce pays. Elle en est la face cachée mais prégnante.
Traduire le bouddhisme coréen et la culture du Sŏn reste une aventure et un défi. Le traducteur doit en permanence composer avec la dimension plurilingue du vocabulaire bouddhique contemporain : mots d’origine sanscrite, expressions en chinois classique, termes sino-coréens, lexique d’origine coréenne et anglais. Rédigé en langue coréenne, cette présentation a d’abord fait l’objet d’une traduction anglaise assez libre, publiée en 2009 et destinée à un public international. La présente version en langue française, traduite à partir du coréen, en constitue une forme à la fois réactualisée et adaptée, comportant de nombreux aménagements (glossaire et concordance, cartes et illustrations, indications chronologiques, choix de romanisation). Les lecteurs familiers du bouddhisme d’Asie orientale liront avec profit l’abondant glossaire, particulièrement utile dans un contexte où il n’existe pas de guide lexical et iconographique faisant véritablement autorité.
Yannick BRUNETON
Professeur des universités à l’université Paris Diderot

Croft Assistant Professor of Anthropology and Korean Studies
Closing Date: January 24, 2017
The Department of Sociology and Anthropology (http://socanth.olemiss.edu) and the Croft Institute for International Studies (www.croft.olemiss.edu) at the University of Mississippi invite applications for a Croft Assistant Professor of Anthropology and Korean Studies. This is a joint-appointment, tenure-track position supported by the Korea Foundation: start date, August 2017. We are seeking a cultural or linguistic anthropologist who will take a leading role in the development of Korean Studies on our campus. The successful candidate will be able to teach introductory and thematic courses for Anthropology and International Studies as well as upper-level and graduate courses with a focus on Korea. Candidates should have an active fieldwork program, a strong commitment to teaching, and the language proficiency to conduct original research in Korean. Ph.D. in Anthropology is required by the time of appointment. Tenure and promotion reside in the Department of Sociology and Anthropology. Teaching and service responsibilities will be divided equally between the Department of Sociology/Anthropology and the Croft Institute. The Department of Sociology and Anthropology offers BA and MA degrees in Anthropology and the Croft Institute, a signature program on campus, administers the major in International Studies within the College of Liberal Arts. Interested candidates should apply online at https://jobs.olemiss.edu by uploading a letter of application, curriculum vita, outline of current and projected research interests, evidence of teaching effectiveness, a writing sample, and names and contact information for three individuals who can be contacted for letters of recommendation. Use the appropriate links to attach these materials to the on-line application. Review of applications will begin when an adequate pool is established, but no earlier than November 10th, and will continue until the position is filled. Salary is competitive. Women and minorities are especially encouraged to apply. The University of Mississippi is an EOE/AA/Minorities/Females/Vet/Disability/Sexual Orientation/Gender Identity/Title VI/Title VII/Title IX/504/ADA/ADEA employer.
Source : Gis Asie / Réseau Asie & Pacifique
Pages