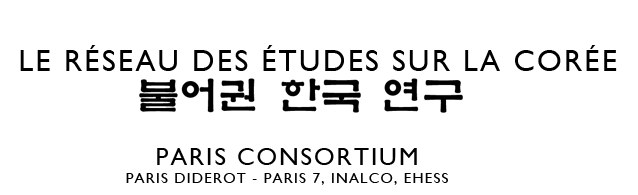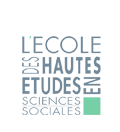L’atelier « Korean Archaeology and Cultural Heritage » organisé par Ariane Perrin (UMR 8173) le 17 mars 2017 dans le cadre du séminaire pluridisciplinaire du Centre de Recherches sur la Corée (CRC-UMR 8173) souhaitait faire se rencontrer plusieurs chercheurs travaillant sur une problématique commune pour faire le point sur les différents discours patrimoniaux passés et actuels liés à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel coréen.
L’atelier a débuté par deux interventions portant plus spécifiquement sur l’archéologie. Luis Botella (université de Malaga) a analysé la manière dont la première génération d’archéologues coréens s’est formée et constituée en un corps professionnel dans la période postcoloniale dans « Achieving Professional Credentials: South Korean Archaeology and University Degrees (1945-1979) ». Sa présentation s’est concentrée sur le département d’anthropologie et d’archéologie de l’université nationale de Séoul (1961-1979), le premier en son genre en Corée du Sud, et les différents réseaux académiques.
Titulaire d’un doctorat de l’université de New York, Kim Wŏnyong fut le premier directeur de ce département. Il travaillait depuis 1947 au Musée national de Corée en étroite collaboration avec Kim Chaewŏn (titulaire d’un doctorat allemand), le tout premier directeur coréen de cette institution. Les étudiants furent très tôt engagés sur des chantiers de fouilles où ils purent se former aux techniques de fouilles. Malgré tout, il y avait très peu de postes en archéologie. Il faudra attendre 1969 pour que le premier master en archéologie soit créé avec deux étudiants seulement. Au total, seuls 14 étudiants seront diplômés entre 1969 et 1979. Ceux qui souhaitaient étudier en doctorat durent partir se former à l’étranger avant que la première formation doctorale en archéologie ne soit créée en 1985 en Corée. L. Botella a souligné le rôle majeur de Kim Chaewŏn et de Kim Wŏnyong dans la formation et la promotion de la première génération d’archéologues et d’historiens de l’art coréens, leur trouvant des financements pour leur permettre de poursuivre leurs études à l’étranger. Les liens tissés durant les premières années de formation en Corée furent déterminants pour la suite de leur carrière, les insérant dans un réseau social influent.
S’agissant de la situation des femmes archéologues, L. Botella note qu’il y eut 16 étudiantes entre 1961 et 1971 sur un contingent de 89 étudiants, qui bénéficièrent de la même formation universitaire et sur les terrains de fouille que leurs condisciples masculins. Lee Nanyŏng, rattachée au Musée national de Corée, fut la première femme archéologue à entreprendre des fouilles avec ses collègues du département d’archéologie du Musée national de Corée.
Le département d’anthropologie et d’archéologie de l’université nationale de Séoul a joué un rôle central dans la professionnalisation de la discipline en créant un premier réseau académique et social d’entraide pour les archéologues coréens dans la période postcoloniale. Il serait opportun d’étendre l’étude de l’histoire de l’archéologie coréenne à d’autres universités telles que Yonsei ou Koryŏ.
Ariane Perrin a demandé quels étaient les enseignements dans les années 1960 et 1970. Les enseignements étaient partagés à part égale entre l’archéologie et l’anthropologie et il n’y avait pas beaucoup de sujets enseignés entre 1961 et 1965. C’était principalement l’archéologie occidentale et l’épigraphie. A partir de 1967, les cours portent sur l’archéologie coréenne, la préhistoire et la période des Trois Royaumes ; à partir de 1975, sur l’archéologie de la Chine et de la Sibérie.
Linda Gilaizeau (Mount Fuji World Heritage Center) s’est intéressée aux échanges entre les sociétés de la péninsule coréenne et celles de l’archipel japonais durant la protohistoire (périodes Yayoi et Kofun, entre les VIIIe et VIIe siècles avant notre ère et les VIe et VIIe siècles de notre ère) dans sa présentation intitulée « A Study of Korean and Japanese Interactions during Protohistory ».
Cette période détient les clés pour comprendre le développement des sociétés qui se mettent en place au cours de cette période. Elle voit l’arrivée de l’agriculture, la métallurgie du bronze et du fer, puis l’utilisation de chevaux, l’écriture et le bouddhisme dans l’archipel et enfin la formation du premier état centralisé. Bon nombre de ces éléments sont venus du continent au gré de contacts et d’échanges commerciaux et à la faveur de vagues migratoires. L. Gilaizeau entend inverser la tendance générale qui tend à souligner les apports du continent vers l’archipel pour se pencher d’une part, sur les éléments des sociétés de l’archipel qui ont été retrouvés dans le sud de la péninsule « coréenne », et d’autre part, plus largement, sur les phénomènes d’interaction entre ces différentes sociétés et cultures.
L’utilisation des substantifs « japonais » et « coréen » accolés au terme « archipel » et « péninsule » pose problème à une époque où les frontières n’étaient pas encore définies et où il n’était pas question de « nationalité ». Elle reflète les considérations nationalistes issues de l’historiographie contemporaine qui tentent de donner à tout prix un sens à des sources historiques anciennes. L’analyse des vestiges archéologiques à la lumière de ces sources s’en trouve faussée. Ainsi, la culture funéraire du nord de Kyushu du milieu de la période Yayoi est identique à celle du sud de la péninsule. Ce qui devrait être considéré comme une culture funéraire commune aux sociétés de part et d’autre du détroit est interprété come une influence « coréenne » sur les sociétés de Kyushu. Tout comme la découverte de tertres en forme de trou de serrure dans le bassin du fleuve Yŏngsan dans la province du Chŏlla est perçue sous l’angle d’une influence « japonaise » dans le sud-ouest de la péninsule.
Jusqu’alors, l’analyse des données archéologiques de cette région de l’Asie orientale, au lieu d’être considérée comme une seule vaste zone d’interaction, a souffert de la dichotomie et de l’opposition entre deux territoires, langues et identités distincts correspondant en fait à l’idée moderne de deux nations différentes, le Japon et la Corée.
Valérie Gelézeau (EHESS) a demandé si on a retrouvé des embarcations attestant de cabotage près des côtes de l’archipel. L. Gilaizeau a répondu par la négative, pas à sa connaissance. En revanche, au nord de Kyushu, sur Iki, Tsushima, la côte sud de la péninsule et la côte nord de la région de San’in (côte de l’archipel) on retrouve des objets similaires et des objets ayant voyagé d’une région à l’autre (notamment la céramique), surtout durant la période Yayoi.
Codruta Sintionean (université Babeş-Bolyai) a ensuite évoqué les pratiques de reconstruction du patrimoine architectural de la Corée dans sa communication intitulée « Searching for the ‘Original Form’: The Practice of Reconstruction of Architectural Heritage in South Korea ».
Au cours des quatre dernières décennies l’Administration du patrimoine culturel a consacré un budget important dans la restauration, en fait reconstruction, de monuments historiques partiellement endommagés (palais Kyŏngbok, enceinte de la ville de Séoul) auxquels l’Administration entend restituer la « forme originale » (wŏnhyŏng). Il manque encore à l’heure actuelle un consensus sur ce que l’on définit par cette formule.
La pratique de la reconstruction de monuments historiques est bien documentée depuis l’ère du président Park Chunghee (1962-1979) où bon nombre de bâtiments et sites associés à des événements historique glorifiant la patrie furent reconstruits. Le cahier des charges devait répondre à une double préoccupation : préserver la tradition et montrer la modernisation rapide de la Corée du Sud. Selon C. Sintionean, les reconstructions à grande échelle sous la présidence de Park Chunghee ont influé la manière de percevoir la gestion actuelle du patrimoine architectural, créant une tolérance aux pratiques de reconstruction.
Le manque de consensus sur ce sujet explique la grande variabilité et la tolérance aux pratiques de reconstruction, mais aussi les dissensions, comme le montre le cas de la reconstruction du palais Kyŏngbok et de sa porte Kwanghwa. La controverse principale a porté sur le bien fondé de reconstruire la porte Kwanghwa, déjà reconstruite en ciment en 1968. Lorsque l’Administration découvrit des vestiges des murs de fondation d’origine datant du XIVe siècle, elle fut critiquée pour ne pas les avoir utilisés dans la valorisation du site et de les avoir simplement recouverts.
La notion de l’authenticité d’un site fait encore débat entre les experts chargés de la protection du patrimoine à travers le monde depuis le « Document de Nara sur l’Authenticité » de 1994. De fait, les positions ont évolué grâce à l’UNESCO et à l’ICOMOS qui reconnaissent d’autres formes authentiques de patrimoine, celles intangibles qui peuvent faire l’objet d’une reconstitution. Cette plus grande tolérance des instances internationales expliquerait les reconstructions importantes de sites historiques en Corée et les demandes d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Alain Delissen (EHESS) a demandé en quoi la reconstruction d’un bâtiment représente un problème si l’on considère que les monuments font régulièrement l’objet de restauration. C. Sintionean remet en question les critères d’authenticité avancés par l’Administration du patrimoine culturel. Peut-on parler d’authenticité lorsqu’un bâtiment a été reconstruit ? Une autre question a porté sur les raisons qui poussent l’Administration à reconstruire à tout prix des sites historiques. Pour C. Sintionean ces tentatives s’inscrivent dans la volonté politique de promouvoir la culture et le patrimoine coréens à l’international.

Fig. 1 Gauche : Bodhisattva, époque Song, Dazu, Chine; Droite : Avalokiteshvara, époque Koryŏ, Pyongyang Central Museum of History 朝鮮中央歷史博物館 © Bryan Sauvadet.
Bryan Sauvadet (INALCO) a présenté les résultats de ses enquêtes de terrain en Corée du Nord en 2015 et 2016 dans sa communication intitulée « Religious Art in North Korea: The Missing Link in Korean Heritage Studies ». Après un rappel historique sur la géopolitique de l’époque, il a évoqué l’influence de la statuaire bouddhique chinoise des Song sur la statuaire du Koryŏ précisant cependant qu’il n’existait pas suffisamment d’œuvres de cette période pour en tirer des conclusions définitives. Pour illustrer son propos, il a montré deux exemples de statues du bodhisattva Avalokiteshvara (Cor. Kwanŭm) 觀音像, mis en parallèle avec une représentation similaire de bodhisattva d’époque Song dans la grotte de Dazu en Chine (fig. 1).
Une seconde source d’influence mieux documentée sur la statuaire de la fin du Koryŏ (1270-1392) est celle de l’art tibéto-mongol qui s’est développé sous la dynastie mongole des Yuan. Elle s’explique par les liens étroits entre la cour des Yuan et celle du Koryŏ à travers entre autre les mariages entre les rois de Corée et des princesses mongoles. Les sources historiques évoquent le mécénat de la cour à travers des commandes et offrandes faites dans les monastères des Monts de Diamant. Suivant un parcours chronologique, B. Sauvadet se demande si d’autres courants de pensée religieuse issus du taoïsme ou du chamanisme n’ont pas aussi modelé la production artistique du Chosŏn. Il évoque ainsi une possible influence chamanique notamment de la gamme chromatique sur la peinture du Dixième roi des Enfers五道轉輪大王. Pour conclure sa présentation il a montré une série peu connue de six peintures réalisées par Hyǒnjae Sim Sajŏng (玄齋 沈師正, 1707-1769) sur le thème des immortels, dont l’étude iconographique reste à faire.
Valérie Gelézeau a souligné l’importance pour les étudiants d’effectuer des terrains de recherche en Corée du Nord1. Elle a demandé où en était la recherche en Corée du Sud sur le patrimoine nord-coréen. B. Sauvadet a notamment cité les travaux de Chang Kyǒnghŭi en Corée du Sud qui a fait plusieurs séjours en RPDC au moment de la politique d’ouverture du « rayon de soleil » entre les deux pays. Les chercheurs sud-coréens dans le domaine patrimonial sont très intéressés, notamment par le patrimoine religieux, mais depuis que les relations intercoréennes se sont distendues, les travaux intercoréens dans ce domaine le sont aussi. Un travail d’historiographie de l’histoire de l’art coréen reste à faire car les chercheurs nord-coréens ne procèdent pas de la même manière qu’au Sud, principalement en termes de terminologie et de classifications des oeuvres.
Depuis quelques années des organisations d’État, des groupes civiques ou religieux se mobilisent en Corée du Sud pour faire rapatrier des biens culturels coréens qui ont été exportés illégalement principalement au cours du XXe siècle. Ariane Perrin (UMR 8173) revient sur ces actions dans son intervention « Repatriating Korea’s Lost Cultural Properties ».
L’une des demandes de restitution concerne la question très sensible du retour de la collection de l’homme d’affaires japonais Ogura Takenosuke (1870-1964) qui a possédé l’une des collections privées japonaises d’objets d’art coréens la plus importante pendant la période coloniale. Forte de 1034 pièces dont plusieurs sont désormais considérées comme des biens culturels importants du Japon, elle a été léguée par ses descendants au Musée national de Tokyo en 1982.
De fait, il existait en Corée coloniale un marché actif d’antiquités alimenté par tout un réseau de marchands et de collectionneurs privés essentiellement japonais et coréens. Le club d’art coréen Kyŏngsŏng (1922-1941) a ainsi organisé de nombreuses ventes aux enchères, tout comme la Société japonaise pour l’étude des antiquités coréennes (Chōsen kōgei kenkyūkai) a organisé des expositions-ventes en Corée et au Japon. Dans les années 1970 et 1980 avec le développement d’un marché international de l’art, un grand nombre d’objets d’art a disparu. On estime qu’entre 1984 et 1999 plusieurs centaines d’objets d’art bouddhique ont été volés dans des monastères coréens dont la majorité n’avait pas été recensée.
L’Administration du patrimoine culturel (Cultural Heritage Administration, 문화재청 文化財廳) a mis en place en 2012 une nouvelle structure sous sa tutelle, la Overseas Korean Cultural Heritage Foundation (국외소재문화재재단 國外所在文化財財團) à Séoul, chargée de recenser et d’étudier les collections d’art coréen conservées à l’étranger dans la perspective de faire rapatrier les biens culturels exportés illégalement. Deux musées américains ont ainsi rendu à la Corée en 2013 et 2016 deux peintures bouddhiques du XVIIIe siècle qui auraient été volées dans des monastères.
- Perrin a noté un nouveau phénomène qui s’accroît depuis quelques années, le vol d’objets d’art coréens dans des monastères au Japon. Les personnes arrêtées d’origine coréenne ont indiqué lors de leur procès qu’elles ne faisaient que rendre à la Corée ce qui lui revenait, sans tenir compte d’autres contextes possible d’exportation (cadeau diplomatique, commande, etc.) attestés par des sources historiques. Jusqu’à présent les demandes de restitution qui ont été couronnées de succès sont celles qui ont fait l’objet de négociations « privées » avec des institutions non gouvernementales et des collectionneurs.
- Sintionean a demandé en quoi consiste la convention de l’UNESCO de 1970. Cette convention internationale, créée pour lutter contre le commerce illicite de biens culturels, souhaite établir les bases d’une coopération internationale entre les pays signataires, en faisant une série de recommandations sur les bonnes pratiques en matière de protection du patrimoine culturel (inventaires nationaux, mesures de contrôle, campagnes d’information, etc.).
L’atelier s’est conclu par l’intervention d’Arnaud Nanta (CNRS-IAO) qui est revenu sur chacune des communications en soulignant certains points. Après avoir discuté l’intérêt de la conférence de Linda Gilaizeau sur les relations entre la péninsule et l’archipel durant la protohistoire, et de celle de Codruta Sintionean qui a montré d’intéressants cas d’invention de la tradition, A. Nanta a exprimé son intérêt pour le sujet présenté par Luis Botella sur les réseaux professeurs-étudiants dans le premier département d’anthropologie et d’archéologie créé en Corée du Sud en 1961. En tant qu’historien des sciences humaines et sociales japonaises, il a lui-même étudié les institutions japonaises en Corée coloniale et l’histoire de l’archéologie s’intéressant aux réseaux coloniaux et aux réseaux locaux. Il a aussi évoqué un aspect peu connu de la formation de chercheurs coréens dans la période coloniale, ceux qui, au lieu de se rendre au Japon ou d’étudier dans la colonie, ont fait le choix de partir étudier en Europe notamment en Allemagne ou en Autriche, tel Kim Chaewŏn ou bien To Yuhwa.
Il a ensuite indiqué l’importance d’inclure des données sur le patrimoine artistique situé en Corée du Nord. Revenant sur la question de l’influence, A. Nanta recommande de parler plutôt de style que d’influence et de relier l’étude iconographique des statues à l’histoire religieuse du Koryŏ. Les formes artistiques existent par elles-mêmes, et ne peuvent être pensées comme des formes dérivées de types « originaux » pensés comme « purs ».
Revenant sur la conférence d’Ariane Perrin à propos des demandes de rétrocession du patrimoine culturel coréen, il a souligné la dimension problématique de l’opposition légal / illégal pour la période coloniale. Pour certains chercheurs coréens, tel Yi Sunja, les fouilles conduites durant la colonisation étaient toutes illégales car imposées du fait de la domination coloniale ; alors que les autorités japonaises opposaient fouilles légales conduites en cohérence avec leurs recherches sur l’histoire de la péninsule coréenne et pillages illégaux2. A. Nanta est revenu sur le traité de normalisation des relations diplomatiques signé par le Japon et la Corée du Sud en 1965, qui a vu la signature de deux accords parallèles sur les compensations et sur le patrimoine. Concernant la compensation financière demandée par la Corée pour les Coréens enrôlés pour le travail en temps de guerre, il ne s’agissait pas d’un dédommagement pour préjudice subi (travail forcé) mais plus simplement de régler leurs salaires, ce qui a amené la Corée du Sud à reconnaître la légalité de l’opération concernée, sans quoi toute réclamation serait impossible. La position sud-coréenne vis-à-vis de la légalité des actions conduites durant la période coloniale n’est donc pas monolithique.
Historienne de l’art
L’atelier a bénéficié du soutien du Centre de Recherches sur la Corée [http://crc.ehess.fr/] et du Réseau des études sur la Corée (RESCOR) [http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr/].
Compte rendu de l’atelier « Korean Archaeology and Cultural Heritage », 17 mars 2017 (version PDF)
- N.d.e. Voir l’article de Valérie Gelézeau, « Le terrain en Corée du Nord ou la retombée en enfance des sciences sociales », Carnets du Centre Corée, 25 septembre 2015 [http://korea.hypotheses.org/8385].
- N.d.e. Voir l’article d’Arnaud Nanta, « Les débats au xxe siècle sur la légalité de l’annexion de la Corée : histoire et légitimité », Cipango, n°19, 2012, pp. 75-110 [https://cipango.revues.org/1676]