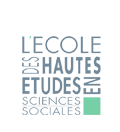Cette enquête de terrain a été menée à Séoul de novembre à décembre 2016, dans la ville d’Ansan, dans la province de Gyeonggi-do. Cette ville a été le lieu principal de mon observation et de rencontres, car une forte communauté étrangère y est présente y compris une communauté ouvrière cambodgienne qui a été l’objet de mon enquête.
Cette communauté ouvrière parlant très peu le coréen, fait souvent appel à des Cambodgiens venus faire leurs études en Corée du Sud. Il arrive donc à ces étudiants d’aider bénévolement ces ouvriers en s’occupant de leurs problèmes administratifs, mais aussi parfois en les accompagnant au tribunal. Étant moi-même étudiante, il m’a paru plus approprié d’essayer d’intégrer cette communauté d’ouvriers avec l’aide de ces étudiants. En effet, c’est par leur intermédiaire que j’ai pu entrer en contact avec mes premiers interviewés et donc, entamer mon enquête de terrain.
Dans le cadre de cette enquête, les lieux suivants ont fait l’objet d’une observation particulière. Le premier lieu sur lequel je me suis rendue pour optimiser mes chances de rencontrer ces ouvriers est la banque Kukmin située à Ansan. Il s’agit d’une banque coréenne qui permet d’effectuer des transferts de fonds à l’étranger. Elle se distingue des autres puisqu’elle est conçue principalement pour une clientèle cambodgienne. En effet, si le rez-de-chaussée accueille tous les clients (coréens et étrangers), le premier et le deuxième étage, quant à eux, sont conçus spécialement pour accueillir les clients cambodgiens. Au premier étage, des interprètes en langue khmère aident les clients à remplir des papiers. Ils sont ensuite dirigés au second pour se rendre au guichet où ce sont cette fois-ci des employés de la banque qui les prennent en charge avec l’aide d’interprètes cambodgiens.

Photo prise par l’auteur le 19 novembre 2016 à Kukmin Bank avant l’ouverture et présentant le premier étage où les clients cambodgiens sont accueillis
J’y suis donc allée le week-end car, en général, ce sont les jours de repos des ouvriers cambodgiens. J’ai pu ainsi les rencontrer et obtenir leurs numéros de téléphone afin de pouvoir les contacter ultérieurement pour des entretiens plus approfondis.
Je me suis ensuite rendue dans plusieurs restaurants à Ansan où les ouvriers cambodgiens aiment se rendre. Ainsi, j’ai eu l’occasion d’aller dans un restaurant thaïlandais dont la cuisine est appréciée par toute la communauté étrangère d’Ansan y compris la communauté cambodgienne. J’ai profité de la notoriété du restaurant pour aborder des Cambodgiens qui y déjeunaient. Je suis également allée dans un restaurant cambodgien où les ouvriers cambodgiens aiment passer du bon temps en faisant des karaokés tout en dégustant des plats traditionnels. C’est là que j’ai rencontré un ouvrier cambodgien qui m’a parlé d’un centre chrétien où des ouvriers cambodgiens se rassemblent tous les dimanches. Ce centre chrétien est en fait une église multiculturelle nommée le Onnuri M Center située elle aussi dans la ville d’Ansan.
Pour finir, je suis donc allée dans cette église multiculturelle où plusieurs communautés chrétiennes étrangères (chinoise, indonésienne, japonaise, cambodgienne…) ainsi que coréenne, se croisent et où les cultes sont célébrés dans la langue vernaculaire des fidèles. J’ai pu observer une communauté religieuse cambodgienne composée essentiellement d’ouvriers qui semblent être bien solidaires. Le fait de se retrouver ensemble deux fois par semaine, c’est-à-dire à l’occasion de la messe du dimanche mais aussi la veille (la plupart d’entre eux vivant assez loin d’Ansan il leur est permis de dormir dans l’église le samedi soir), leur permet de décompresser et surtout de reproduire ce qu’ils appellent une « seconde famille ».

Photo prise par l’auteur le 11 décembre 2016 à Onnuri M Center, église multiculturelle à Ansan, présentant une prière en glossolalie faite à l’attention d’un Cambodgien qui devait bientôt quitter la Corée pour retourner au Cambodge
À travers mon enquête de terrain, je cherchais à savoir dans un premier temps si le schéma de subordination des ouvriers cambodgiens à leurs patrons coréens sur leur lieu de travail se limitaient à la sphère professionnelle ou, au contraire, se reproduisaient dans leur vie quotidienne, c’est-à-dire dans leurs rapports quotidiens avec des Coréens. Cependant, mon enquête de terrain m’a permis d’observer qu’il n’existait quasiment aucune interaction entre les Cambodgiens et les Coréens en dehors du lieu de travail. Certains ouvriers justifient ceci par les difficultés à communiquer et d’autres disent que ce sont les Coréens qui ne veulent pas d’eux (discrimination et exclusions). J’ai pu donc constater que ces ouvriers cambodgiens ne restaient qu’entre eux, alors qu’ils travaillent dans des entreprises coréennes et fréquentent une Église protestante coréenne. Dès lors, je me suis retrouvée face à une communauté ouvrière cambodgienne fermée, ce à quoi je ne m’attendais pas.
En effet, je pensais qu’étant moi-même d’origine cambodgienne, je saurais mettre en confiance ces ouvriers et me faire accepter dans leur communauté assez rapidement. En d’autres termes, partager une langue et une culture commune aurait pu m’aider à intégrer cette communauté. Au contraire, je me suis heurtée à une communauté méfiante qui ne me considérait pas comme l’un des siens en raison de mon statut différent du leur. Ces ouvriers semblent donc avoir leur propre définition de ce que signifie être cambodgien en Corée du Sud, c’est-à-dire, pour eux, être ouvrier et venir d’un milieu plutôt rural. Bien qu’étant moi-même d’origine cambodgienne, mon statut d’étudiante et d’étrangère ne m’ont pas permis d’être acceptée comme leur égale. Par conséquent, j’ai été amenée à me demander si cette distance ne devait pas être encore plus grande entre les ouvriers cambodgiens et les Coréens, que tous mes interviewés considèrent d’ailleurs comme « malveillants », pour reprendre leurs propos.
Pourtant, ces ouvriers se retrouvent en Corée du Sud car le pays a réussi à se positionner comme une terre promise pour le Cambodge, notamment d’un point de vue économique. Effectivement, les résultats de cette enquête de terrain ont révélé le rôle important que joue la Corée du Sud dans la migration de ces ouvriers. Entre autres, elle joue d’un positionnement médiatique, avec des campagnes de recrutement diffusées à la radio et, religieux grâce aux missionnaires chrétiens qui confortent les Cambodgiens dans l’idée que la Corée est un pays accueillant. De plus, malgré les difficultés personnelles (difficultés de la langue coréenne, manque de la famille, se retrouver seul dans un pays étranger) et les conditions de vie difficiles de travail qu’ils doivent gérer au quotidien, ces ouvriers gagnent en un mois l’équivalent d’un revenu annuel au Cambodge.
Ainsi, à la question « pourquoi avoir choisi d’immigrer en Corée du Sud pour travailler », tous m’ont répondu que c’était le seul pays, à leur connaissance, qui offre un salaire attractif. De plus, la Corée du Sud a su attirer des Cambodgiens ruraux avec son système EPS (Employment Permit System) en lequel les ouvriers interviewés ont confiance et duquel ils sont satisfaits, contrairement à ce qu’ont peut lire dans les recherches faites à ce sujet.
En réalité, le premier objectif de ces ouvriers cambodgiens ne consiste pas tant à vivre durablement en Corée que de gagner suffisamment d’argent pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs proches restés au Cambodge. D’après les premiers résultats de mes interviews, à la fin de leur contrat de travail (qui peut durer jusqu’à quatre ans et dix mois), tous mes interviewés prévoient de retourner au Cambodge. Le salaire obtenu lors de leur séjour en Corée leur permet par exemple d’acheter des terres et des biens immobiliers dans leur pays d’origine et par la suite d’améliorer leur statut socio-économique. De ce point de vue, l’image que les Cambodgiens ont de la Corée du Sud au Cambodge contribue non seulement à la migration de Cambodgiens vers la Corée qui manque de main-d’œuvre, mais aussi à l’amélioration des conditions de vie des Cambodgiens lorsqu’ils retournent chez eux.
Cela m’amène à me questionner sur la volonté sud-coréenne de se positionner comme terre d’immigration, notamment pour les populations d’Asie du Sud-Est. De par mon enquête, j’ai découvert que tous mes interviewés partageaient un sentiment commun, à savoir qu’ils ne voulaient pas vivre en Corée du Sud. Dès lors, je peux m’interroger sur les raisons réelles qui poussent la Corée du Sud à se promouvoir comme terre d’accueil pour les populations d’Asie du Sud-Est, et notamment le Cambodge ; le pays cherche-t-il réellement à s’ouvrir au multiculturalisme ou agit-il plutôt poussé par des raisons économiques, au détriment de l’aspect social, à la simple recherche de combler le manque d’une main-d’oeuvre coréenne ?
 Maryline SUON-NGINN
Maryline SUON-NGINNÉtudiante en Master 2 de recherche en études coréennes à l’INALCO
Boursière de l’INALCO et du RESCOR en 2016/2017


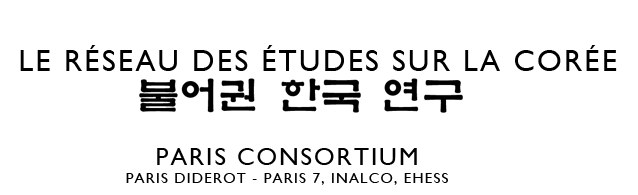




 Concert de la Troupe de musique folklorique du National Gugak Center de Corée
Concert de la Troupe de musique folklorique du National Gugak Center de Corée


 Maryline SUON-NGINN
Maryline SUON-NGINN