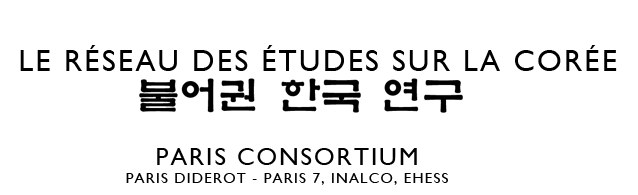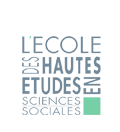Candidat pour une inscription en première année de doctorat à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), j’ai bénéficié d’une bourse du RESCOR qui a été pour moi l’occasion de me consacrer pleinement à la poursuite de la préparation de mon projet d’étude doctorale sur le Wŏrinch’ŏn’gang chi kok (月印千江之曲 ; WK). Ce dernier est une compilation de chants coréens retraçant un certain nombre d’épisodes de la vie du Bouddha (Śākyamuni) dirigée par le roi Sejong autour de 1447, soit quelques années seulement après la création de l’alphabet coréen. Je propose d’en faire une analyse textologique en confrontant sa narration et sa morphosyntaxe à celles des différents livres ayant inspiré son écriture, notamment le Sŏkpo sangjŏl (釈譜詳節) du prince Suyang (plus-tard roi Sejo), les biographies chinoises Shijiapu (釋迦譜) de Sengyou et Shijia shipu (釋迦氏譜) de Daoxuan et d’autres sources telles que le Huayanjing (Avataṃsaka Sūtra, 華嚴經), afin d’étudier le processus par lequel les compilateurs du WK sont passés pour (ré)écrire cette biographie du Bouddha et de tenter de montrer sur quels aspects elle diffère de celles de la tradition chinoise.
Au cours de ces deux mois, j’ai effectué un séjour en Corée du Sud qui m’a permis de me procurer sur le terrain un certain nombre de références bibliographiques qui sont encore aujourd’hui relativement absentes des bibliothèques et librairies françaises. Ces publications portaient sur le WK, notamment des traductions annotées et quelques études récentes, le roi Sejong et les lettrés de la cour de la dynastie Yi (acteurs de la compilation du WK), le bouddhisme (dont la méconnaissance peut être très handicapante dans la lecture et la compréhension de cette biographie du Bouddha) et la langue coréenne médiévale (langue de travail pour l’étude du WK et du Sŏkpo sangjŏl).

Quelques ouvrages parmi ceux acquis lors du terrain en Corée du Sud. ©Younès M’Ghari
Cette étape était décisive car elle me permettra de rédiger, au cours de cette première année de doctorat, la première version des fondements théoriques de ma thèse dédiée à la présentation :
- du WK en tant qu’objet d’étude (ayant été jusqu’ici presque exclusivement abordé à travers le prisme de la phonologie), de son histoire pendant et après sa compilation, des multiples origines de son contenu et des caractéristiques connues de ces dernières.
- des théories et outils (tels que ceux de la linguistique de corpus) que cette recherche nécessitera et des raisons pour lesquelles leur utilisation sera cruciale afin d’apporter dans le champ des études coréennes prémodernes de nouvelles connaissances sur le WK qui reste encore, dans certains domaines, un objet d’étude relativement peu commenté.
Ce séjour en Corée du Sud m’a également permis de rencontrer un certain nombre de spécialistes au sein des Archives royales de Jangseogak à l’Académie des études coréennes. J’ai, en effet, eu la possibilité d’échanger de manière informelle, à plusieurs reprises, avec le docteur Ahn Seung-jun qui a contribué à l’entrée du WK dans les collections de son institution1 et qui a, grâce à son expérience, pu me donner des idées de pistes à explorer dans mes recherches sur le WK. Il m’a notamment encouragé à m’intéresser davantage aux lettrés de la cour du roi Sejong en me recommandant certaines lectures supplémentaires. La rencontre fortuite avec d’autres chercheurs et chercheuses tels que le docteur Yun Jin-young a également nourri ma réflexion sur la façon de procéder pour « investiguer », comme il l’a fait avec brio dans ses propres travaux, sur l’histoire de la compilation et de la transmission du WK et m’a incité à contacter sans plus attendre des universitaires proches de feu le professeur Nam Gwang-U qui mentionne dans les annexes de son dictionnaire de coréen médiéval2 que des fragments du deuxième volume du WK auraient été retrouvés.
Il me reste aujourd’hui, dans le cadre de cette étude à la croisée de la philologie et de la linguistique sur l’écriture du WK et sur la relation de ce dernier avec les œuvres chinoises et coréenne l’ayant inspiré, encore un certain nombre de références bibliographiques à consulter et de spécialistes à rencontrer. Cependant, bien qu’ayant encore beaucoup à apprendre sur le sujet avant de me lancer dans la recherche systématique de motifs (patterns) narratifs et morphosyntaxiques récurrents d’un texte à l’autre pour tenter d’expliciter le processus de compilation du WK, j’ai pu, grâce à ce premier terrain, acquérir des ouvrages de référence et avancer dans mes premières recherches.

- Ahn, Seung-Jun [안승준] & Yu, Hak-Young [유학영] (2014). Wŏrin Ch’ŏngang chi kok-ŭi Puan Silsangsa sojang kyŏng’wi-wa kŭ chŏllae kwajŏng [월인천강지곡의 부안 실상사 소장 경위와 그 전래 과정 Les circonstances de la conservation du WK au Silsangsa et sa transmission] in Changsŏgak (vol.32), Séoul : Academy of Korean Studies, pp. 48-74.
- Nam, Gwang-U [남광우] (2017). Koŏ sajŏn [古語辭典 Dictionnaire de coréen médiéval], Séoul : Kyohaksa, 1614 p.