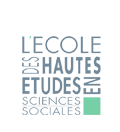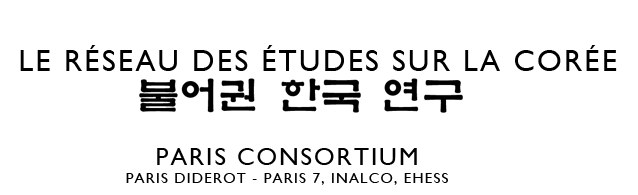Actualités
Actualités

a soutenue sa thèse de doctorat
Quand la reconstruction mammaire devient une affaire publique
agir et se mobiliser en tant que patientes atteintes d’un cancer du sein en Corée du Sud (2011-2015)
le mercredi 6 mai 2020
en visioconférence
La jury
- Philippe BATAILLE, directeur d‘études, EHESS (directeur de thèse)
Alain DELISSEN, directeur d‘études, EHESS (co-directeur de thèse) - Kyung-mi, KIM, maîtresse de conférences, Université de Paris Diderot
- Isabelle, KONUMA, professeure des universités, INALCO (rapporteure)
- Sébastien, LECHEVALIER, directeur d‘études, EHESS
- Vololona, RABEHARISOA, professeure des universités, MINES ParisTech (rapporteure)
Résumé
En 2012, en Corée du Sud, une association de patientes atteintes d’un cancer du sein organise une grève du silence devant la Cour Constitutionnelle pour dénoncer les inégalités d’accès à la reconstruction mammaire. Cette action collective inédite des patientes revendiquant un meilleur accès à la chirurgie questionne le lien entre l’émancipation et l’action collective. Cette étude examine dans quelle mesure l’action collective et le discours des patientes mobilisées pour revendiquer l’accès à la reconstruction mammaire sont émancipateurs et explore d’autres voies possibles d’émancipation.
Cette recherche repose sur une enquête ethnographique réalisée à Seoul pendant 7 mois entre 2013 et 2014 et une intervention sociologique d’une durée de trois mois menée en 2015. L’observation du quotidien des malades s’est déroulée au sein de l’association nationale de patientes et dans un hôpital public. Une soixantaine d’entretiens ont été réalisés avec les femmes et les professionnels qui travaillent auprès de patients atteints d’un cancer (du sein).
La thèse rend compte de la manière dont le cancer du sein s’introduit dans l’économie et la politique nationale welfariste tout en étant traversé par les normes sociales. L’analyse révèle les messages véhiculés par les femmes au nom de leur libération. Nous montrons que leurs messages nourrissent les tensions entre les patientes de profils sociodémographiques différents au lieu de les atténuer, tout en favorisant le conformisme aux normes sociales et à la culture biomédicale du cancer. Cette thèse révèle également comment l’expérience du corps des patientes ayant vécu le parcours de soins est à la base de leur capacité d’action face au corps médical.
Le 21 février dernier Holly Stephens, maîtresse de conférences (lecturer) à l’Université d’Édimbourg, a donné dans le cadre du séminaire « Intelligences de la Corée » une conférence intitulée « Rice Cycles and Price Cycles: Local Knowledge and Global Trade in Korea, 1870–1933 ».
Au XIXème siècle la Corée connaît une période de crise. Les mauvaises récoltes agricoles s’accompagnent de famines aux lourdes conséquences pour la population et l’état. La situation se complique encore en 1876, avec l’ouverture forcée des ports aux interactions étrangères. L’importation de nouvelles idées et de nouvelles technologies s’accompagne de conflits politiques internes aussi bien qu’externes. Ainsi, débutent des débats houleux au sein du gouvernement coréen sur la désirabilité de réformes et la rapidité avec laquelle elles devraient être mises en place.
En attendant, dans l’ombre, guettent les menaces d’impérialisme de la part du Japon, mais aussi de la Chine.
Holly Stephens explique comment cette ouverture des ports est analysée par les historiens comme le changement majeur marquant le début du monde moderne et capitaliste en Corée. L’agriculture commerciale exacerbe les conflits de classe préexistants et, tandis que les riches s’enrichissent, les pauvres s’appauvrissent. Selon cette lecture, l’embargo sur le riz prononcé par le gouvernement coréen est vu comme un acte de résistance face à l’empire japonais, vers lequel il devait être exporté.
Holly Stephens propose, elle, une approche fondée sur l’histoire locale et a analysé dans ses travaux la manière dont les producteurs ordinaires ont compris l’incorporation de la Corée dans les nouveaux modes de commerce international.
A l’origine de ses recherches, la découverte d’un texte original qui lui servira de source primaire au cours de son doctorat : Le journal de Sim Wŏn’gwŏn (심원권 일기 沈遠權 日記), tenu consciencieusement de 1870 à 1933.

Le journal de Sim Wŏn’gwŏn (심원권 일기 沈遠權 日記)
© The Korea National Heritage Online portal of Cultural Heritage Administration (문화재청 국가문화유산포털)
Fermier de la région d’Ulsan, Sim Wŏn’gwŏn naît en 1850 et meurt en 1933. Il est propriétaire d’un domaine agricole de taille moyenne, travaillant lui-même ses terres aux côtés de saisonniers. Sa particularité tient dans ce journal qu’il alimente tout au long de sa vie. Le texte suit un format classique et les entrées, précédées de la date, rendent compte de la météo, de ses activités, de ses rencontres ou encore du prix des marchandises au marché local. Ce qui le rend remarquable, sans aucun doute, c’est sa régularité et sa durée. Pour Sim Wŏn’gwŏn, son journal est un moyen de lire le monde qui l’entoure, mais aussi de se racheter de n’avoir su étudier correctement la culture lettrée. En enregistrant ainsi son présent il cherche à comprendre et à prévoir son avenir.
Mais comment considérer son journal comme une source de savoir ?
Au cours de sa vie, Sim Wŏn’gwŏn note de plus en plus consciencieusement les prix du riz recueillis au marché. Il tient également des bilans annuels, avec l’évolution des cours ou encore le nombre de jours de pluie. C’est ainsi qu’il développe sa vision économique, celle d’un équilibre perpétuel : kwich’ŏn. Cet équilibre s’exprime sous la forme de cycles prévisibles. Ainsi, Sim Wŏn’gwŏn met en pratique la théorie de kwich’ŏn pour prédire la météo, la négociation des prêts et de leurs intérêts et les prix du riz. Ce qui ne l’a pas empêché de se retrouver gravement endetté à quelques reprises.
Le journal permet donc aux historiens de connaître les évolutions du cours du riz tout au long de ces années. Holly Stephens a mis à jour dans son travail une forte augmentation des tarifs dans les années 1920, avant une chute conséquente en 1930. Et si Sim Wŏn’gwŏn ne trouve pas d’intérêt dans les longues tendances que connaissent les prix au cours de sa vie, l’historien peut, lui, faire sens de ces mouvements.
Ce qui intéresse l’agriculteur ce sont davantage les variations saisonnières, régulières de 1870 à 1933. Si elles étaient conséquentes avant l’ouverture des ports, elles diminuent considérablement par la suite. En effet, l’élargissement de la zone commerciale d’échange permet de pallier les mauvaises récoltes et de stabiliser la quantité de riz en circulation. Grâce à la proximité d’Ulsan avec Busan, et surtout son port, Sim Wŏn’gwŏn est familier des échanges qui existent entre la Corée et le Japon, et ce avant même l’ouverture des ports en 1876. Il considère l’import et l’export comme étant relativement symétriques et il n’a pas d’apriori négatif vis-à-vis de cette liaison commerciale. Il déplore cependant le manque d’informations sur les récoltes et les conditions météorologiques du pays voisin, car cela l’empêche d’appliquer sa théorie des cycles et de prédire les prix futurs. Il est, en cela, désavantagé par rapport aux plus grosses exploitations qui peuvent se tenir informées de l’état des récoltes au Japon par des canaux payants.
L’étude du Journal de Sim Wŏn’gwŏn, avec ceux de deux autres fermiers, a permis à Holly Stephens d’offrir un point de vue local à la lecture que les historiens font d’une période où les enjeux globaux ont tendance à éclipser cette perspective précieuse.
Cet article se trouve aussi dans les Ressources numériques de notre site.

ANNEE 2020-2021
APPEL A CANDIDATURE
Attaché temporaire de recherche et d’enseignement (ATER)
Objet : Recrutement d’un attaché temporaire de recherche et d’enseignement
Réf. : Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur
- PROFIL DU POSTE
Département d’études coréennes
Intitulé : ATER de didactique ou linguistique du coréen langue étrangère.
Profil de l’emploi :
Les candidatures des personnes présentant une forte expérience de l’enseignement du coréen langue étrangère et désireuses de développer des projets de recherche s’inscrivant dans le développement de la nouvelle mention « enseignement du coréen » du Master d’études coréennes et/ou de la pédagogie en ligne dans le cadre des cours de langue, mais également dans l’axe 2 de l’Equipe de recherche du PLIDAM, seront particulièrement appréciées.
Le ou la candidat(e) sera appelé(e) à assurer des cours en Licence et Master, notamment ceux de didactique des langues et du coréen.
Peuvent faire acte de candidature les personnes suivantes :
– Etudiant sur le point de terminer un doctorat et si le directeur de thèse peut attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d’un an.
Durée : 1 an maximum renouvelable une fois pour la même durée si les travaux de recherche le justifient.
– Titulaire d’un Doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) et engagement à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur.
Durée : 1 an renouvelable une fois pour la même durée.
– Moniteur de l’enseignement supérieur titulaire d’un doctorat, s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur.
Durée : 1 an renouvelable une fois, si l’intéressé est âgé de moins de 33 ans.
– Enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaire d’un doctorat ou d’un titre ou diplôme étranger admis en dispense du doctorat par la commission de spécialistes compétente. La dispense n’est accordée que pour l’année et le recrutement aux titres desquels la candidature est présentée.
Durée : 3 ans maximum renouvelable une fois pour une durée d’un an.
– Fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A inscrit en vue de la préparation d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches (HDR), ou déjà titulaire de l’un de ces deux diplômes et s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur.
Durée : 3 ans maximum renouvelables une fois pour un an.
- CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Le ou la candidat(e) travaillera en collaboration avec le responsable de chaque niveau et assurera un service annuel en présence des étudiants de 192 heures de travaux dirigés.
Recrutement prévu pour le 1er septembre 2020
- REMUNERATION : calculée sur la base de l’indice brut 513, soit 2 066,53 € bruts mensuels.
- DOSSIER DE CANDIDATURE
Merci d’envoyer le CV avec un projet de recherche avant le 1er juin 2020. Les candidats pré-sélectionnés seront auditionnés à partir du 15 juin 2020
Ce dossier doit être adressé de préférence par voie électronique
A l’attention de M Stéphane THÉVENET
Directeur du Département d’études coréennes
Pages